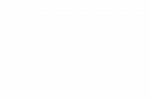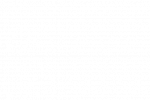Barack Obama s’invite dans le débat sur le Brexit
Barack Obama s’invite dans le débat sur le Brexit
Par Eric Albert (Londres, correspondance)
A la demande de Downing Street, le président américain arrive jeudi au Royaume-Uni pour exprimer son opposition au Brexit.
Mais qu’est-il donc allé faire dans cette galère ? Barack Obama arrive, jeudi 21 avril au soir, pour une visite de deux jours et demi au Royaume-Uni, pendant laquelle il doit exprimer son opposition au Brexit. Allant à l’encontre des protocoles diplomatiques habituels, le président américain s’immisce dans un débat politique interne explosif à seulement deux mois du référendum britannique du 23 juin pour rester dans l’Union européenne (UE) ou en sortir.
La date de la visite est d’autant plus inhabituelle que M. Obama n’a pas de raison officielle de se rendre à Londres ou de dossier urgent à régler avec le premier ministre britannique. « L’explication est simple : David Cameron lui a demandé de venir », décode Heather Conley, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank sis à Washington. Il s’agit donc d’un service rendu à M. Cameron par le président américain, qui accepte de faire ce geste parce qu’il craint de voir son premier allié européen s’éloigner de l’UE.
D’après David Laws, un ancien secrétaire d’Etat britannique (libéral-démocrate), M. Obama avait conseillé il y a quelques années à M. Cameron de ne pas organiser le référendum sur l’appartenance à l’UE. Faute d’avoir été entendu, il va maintenant s’exprimer directement.
Une présence dans l’UE bonne pour le libre-échange
« Le Royaume-Uni a exercé une influence disproportionnée dans le monde depuis des siècles […] et nous estimons qu’il continuera à jouer ce rôle de façon plus efficace s’il reste dans l’Union européenne », expliquait le 14 avril Charles Kupchan, directeur des affaires européennes à la Maison Blanche. Selon lui, le Royaume-Uni est plus écouté à l’international en tant que membre de l’UE et son économie est plus solide. Londres a aussi aidé à pousser une vision plus anglo-saxonne des Vingt-Huit, tournée vers le libre-échange et ouverte à l’élargissement au pays de l’est de l’Europe. Enfin, M. Kupchan ajoute un dernier point : face aux graves crises que traverse l’UE (réfugiés, zone euro…), il craint qu’un Brexit « endommage » encore plus le club européen.
La visite de M. Obama débute réellement vendredi, avec un déjeuner au château de Windsor avec la reine d’Angleterre, qui vient de fêter ses 90 ans. Le président américain doit ensuite rencontrer dans l’après-midi M. Cameron, et donner une conférence de presse conjointe avec le premier ministre britannique, avant de dîner avec le prince William et sa famille. Le point d’orgue du séjour sera enfin un grand discours samedi.
Cette visite à Londres a provoqué de très vives réactions dans le camp des militants du Brexit. Il y a quelques semaines, Liam Fox, un ancien ministre de la défense conservateur, avait remis à l’ambassade des Etats-Unis à Londres une lettre signée d’une centaine de députés britanniques, demandant à M. Obama de renoncer à son déplacement. En vain. Aujourd’hui, il taxe le président américain d’hypocrisie, estimant que les Etats-Unis n’accepteraient jamais de céder leur souveraineté à une institution supranationale. « Quand les Américains auront une frontière ouverte avec le Mexique et une cour qui pourra annuler les décisions de leur Cour suprême et quand le Congrès n’aura pas le dernier mot pour les lois fédérales, alors peut-être que nous les écouterons », explique Liam Fox. « Obama fait [ce déplacement] parce que Cameron s’est mis à genoux et lui a demandé : “s’il te plaît, aide-nous à faire pression sur les Britanniques dans cette prise de décision” », ajoute Iain Duncan Smith, ancien ministre de la sécurité sociale, qui a démissionné avec fracas le mois dernier.
Risque de faux pas
Le paradoxe est que les partisans du Brexit sont aussi, la plupart du temps, les plus atlantistes. L’un de leurs arguments clés est que le Royaume-Uni, « libéré » de l’UE, pourrait se tourner vers le reste du monde, et notamment le grand frère américain. En particulier, il serait possible, selon eux, de signer des accords de libre-échange directement avec d’autres pays, au lieu de passer par Bruxelles.
L’administration américaine rejette fermement cet argument. En octobre 2015, Mike Froman, représentant américain pour le commerce, l’avait dit sans ambages : « Nous ne sommes pas particulièrement sur le marché des accords de libre-échange avec des pays seuls. » Dans une lettre opportunément publiée mercredi dans le Times, huit anciens secrétaires américains au Trésor – dont Larry Summers et Timothy Geithner, qui ont servi sous Barack Obama – ont renforcé cet argument. « Notre expérience des négociations commerciales le prouve, il est difficile de négocier et d’approuver de nouveaux accords [de libre-échange], et les risques d’un accident sont réels », dit le texte.
Pour M. Cameron, ce soutien arrive à point nommé. Les sondages indiquent que l’avance du camp pour rester dans l’UE s’est réduite ces dernières semaines. Mais pour M. Obama, le risque de commettre un faux pas, à l’effet contre-productif, est réel. « L’idée [pour les Etats-Unis] est d’avoir du poids dans le débat sans en faire partie, sans exacerber les tensions autour du référendum, analyse Mme Conley. Je ne suis pas sûr que le président y parviendra. »