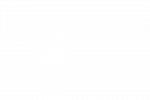Les députés brésiliens se prononcent pour la destitution de Dilma Rousseff

Les députés brésiliens se prononcent pour la destitution de Dilma Rousseff
Par Claire Gatinois (Sao Paulo, correspondante)
Les députés ont voté à la majorité des deux tiers en faveur de la destitution de la présidente, qui a désormais peu de chances de terminer son second mandat.
Jusqu’aux dernières heures, elle y a cru. Rappelant que 54 millions d’électeurs l’avaient élue pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2018. Pas un jour de moins. Dilma Rousseff, première femme présidente de l’histoire de la démocratie brésilienne, dauphine de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), réélue de justesse en octobre 2014, a désormais peu de chances de terminer son second mandat.
Cette fille d’un avocat communiste d’origine bulgare, travailleuse et déterminée, a mis un pied hors du palais présidentiel dimanche 17 avril après le vote des députés en faveur de son « impeachment » (destitution). Prévu entre fin avril et début mai, le vote du Sénat devant l’éloigner du pouvoir pendant cent quatre-vingt jours prend désormais des allures de formalité. Il restera ensuite une étape, plus incertaine : le vote final d’une majorité des deux tiers du Sénat visant à la chasser définitivement de Brasilia.
« S’opposer à moi, me critiquer fait partie de la démocratie. Mais démettre une présidente élue de façon légitime, sans que celle-ci ait commis un quelconque crime (…) n’est pas le jeu démocratique. C’est un coup d’Etat », avait-elle encore affirmé la veille du scrutin.
Le terme de « golpe » (coup d’Etat), fruit d’un marketing politique efficace, a permis de mobiliser une foule de partisans pour la soutenir. La présidente a toutefois fait les frais d’un dispositif prévu dans la Constitution brésilienne et « a eu recours à tous les instruments juridiques pour se défendre », reconnaît-on au Planalto, le siège de la présidence. Sans le succès escompté.
Mais quel « crime » la présidente a-t-elle commis ? Le motif de l’impeachment se fonde sur les « pédalages budgétaires », une astuce à laquelle elle a eu recours pour masquer, un temps, l’ampleur du déficit public. Une ruse dont ont usé tous les présidents, bien que dans une moindre ampleur. Un prétexte, donc.
Contrairement à Fernando Collor de Mello, démis en 1992, la corruption qui exaspère tant la société brésilienne n’est pas non plus à l’origine de sa disgrâce. La présidente appartient au Parti des travailleurs (PT, gauche) sali par les affaires, et en particulier par l’enquête Lava Jato, qui a mis au jour le scandale tentaculaire lié au groupe pétrolier public Petrobras. Ministre des mines et de l’énergie de 2003 à 2005 et présidente du conseil d’administration du géant pétrolier, la présidente peut difficilement plaider l’ignorance.
Lassitude des classes moyennes
Mais elle n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune investigation témoignant d’un enrichissement personnel. Ce qui n’est pas le cas du possible futur vice-président, Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés, à l’origine du lancement de l’impeachment, accusé de corruption et de blanchiment d’argent. La grande majorité des députés qui ont sanctionné Mme Rousseff sont eux aussi suspectés, voire accusés de charges bien plus lourdes. Ainsi de Paulo Maluf, du Parti progressiste (PP, droite), ancien maire et gouverneur de Sao Paulo, recherché par la justice américaine, condamné en France et fiché par Interpol depuis 2010.
Si ce n’est ni pour cavalerie financière ni pour corruption, Dilma Rousseff paie pour ses erreurs. Des fautes diplomatiques, économiques et politiques qui ont contribué à faire d’elle la chef d’Etat la plus impopulaire de l’histoire de la jeune démocratie brésilienne. Arrivée après un Lula qui a sorti de la misère des dizaines de millions de Brésiliens faisant naître de nouvelles attentes, elle a lassé, entre autres, les classes moyennes, cette petite bourgeoisie que le PT a délaissée.
Celle que Lula avait qualifiée de « mère du peuple » a aussi et surtout dû affronter une crise économique largement sous estimée lors de sa campagne. Le « champ de roses » qu’elle a promis n’a jamais pu se concrétiser, laissant aux électeurs un arrière-goût de trahison. Incapable de juguler la récession et la montée du chômage, cette admiratrice de Jean-Paul Sartre, des maquisards vietnamiens et de Fidel Castro a apporté des remèdes micro et macroéconomiques que l’économiste Gesner Oliveira qualifie de « désastreux » : une politique budgétaire expansionniste à contretemps, une manipulation des calculs des excédents primaires suscitant la défiance, un contrôle artificiel des prix de l’électricité et du pétrole, qui contribueront après coup à faire galoper l’inflation.
Le « tournant de la rigueur » adopté malgré elle au début de son second mandat lui attirera aussi l’animosité des puristes de gauche, sans amadouer les milieux d’affaires. Et pour faire passer les mesures impopulaires et les réformes nécessaires, Dilma Rousseff ne parviendra jamais à rallier le Congrès, auquel elle n’a pas su parler. Celle que l’on décrit comme cassante et arrogante n’a pas le talent de son mentor, Lula, pour l’« articulation » politique, comme disent les Brésiliens. Un art indispensable dans un système politique où cohabitent 26 partis au Congrès (sur 35 au total). « Si Dilma avait été Lula, elle aurait résisté malgré la crise, et malgré Lava Jato », souffle Chico Alencar, député du Parti socialisme et liberté (PSOL, gauche), contre l’impeachment.
Certains soulignent que l’une de ses premières erreurs a sans doute été, paradoxalement, sa brutalité visant à « mettre fin à l’impunité qui protège les corrompus ». En 2011, tout juste élue, elle démettra elle-même sept ministres soupçonnés de corruption et est reconnue comme la première présidente qui laissera la justice poursuivre ses investigations jusqu’au sommet de l’Etat.