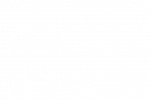« Les juridictions suprêmes sous l’emprise du jeu politique »

« Les juridictions suprêmes sous l’emprise du jeu politique »
En France, comme aux États-Unis, les nominations au Conseil constitutionnel ou à la Cour suprême sont de plus en plus politisées. La faute en incombe à des exécutifs qui prennent refuge derrière le juridique.
Par Jean-Eric Callon
Le débat aux États-Unis sur l’équilibre politique à la Cour Suprême, comme la prochaine nomination de Laurent Fabius au Conseil Constitutionnel, ou la volonté de reprise en main du Tribunal Constitutionnel en Pologne, sont des signaux très clairs pour les observateurs de la volonté des pouvoirs exécutifs de reprendre en mains les juridictions suprêmes, qui sont dans nos systèmes juridiques les gardiens de nos libertés fondamentales, rien de moins.
La nomination des juges est un enjeu politique et démocratique. Il s’agit bien évidemment d’évolutions très disparates, mais à chaque fois le pouvoir exécutif et/ou législatif tente de contrôler, avec plus ou moins de subtilité la majorité au sein des juridictions suprêmes et ainsi leur décision. Aux États-Unis la Cour suprême est composée de neuf juges, dont un président. Le décès le 13 février du juge Scalia – nommé par le président Reagan – conduit à un équilibre au sein de la Cour suprême entre quatre juges nommés par un président démocrate, et 4 juges nommés par un président républicain. La nomination du 9e juge est ainsi un enjeu pour le contrôle de la majorité de la Cour suprême, cette nomination est si emblématique qu’elle constituera sans doute un des thèmes principaux de la prochaine élection présidentielle américaine.
Homme politique proche du pouvoir en place
En Pologne, le parlement a partiellement adopté une loi en décembre 2015 modifiant le fonctionnement du Tribunal constitutionnel et pouvant conduire à sa paralysie. La France elle poursuit une tradition contestable de nomination à la présidence du Conseil constitutionnel d’un homme politique de premier plan, proche du pouvoir en place. Laurent Fabius, homme d’état, et ancien membre du Conseil d’Etat, a évidemment toutes les qualités juridiques et morales pour remplir cette fonction, mais la question n’est pas là.
Cette volonté a pour objectif de contrôler directement ou indirectement une jurisprudence qui pèse de plus en plus sur des enjeux de sociétés, y compris sur des débats qui peuvent paraître très techniques ou juridiques. En effet les gouvernements sont persuadés qu’aux yeux de l’opinion une décision n’est légitime et morale qui si elle est juridiquement fondée. Dans cette hypothèse deux solutions se présentent : respecter l’Etat de droit tel qu’il est et assumer le risque d’une censure, ou peser sur le juge pour qu’il confirme la constitutionnalité de la décision.
C’est exactement le débat actuel sur la révision de la constitution concernant la question de la déchéance de nationalité. Le président de la République pourrait parfaitement assumer ses responsabilités en posant le principe, quitte à prendre le risque d’une censure, il est en effet possible de soutenir dans un Etat de droit démocratique comme la France qu’une décision est légitime sans se préoccuper de sa légalité. Mais le président de la République préfère modifier la Constitution pour éviter une remise en cause juridique, et nomme dans le même temps un proche comme président du Conseil constitutionnel.
Cette reprise en main est la conséquence de deux mouvements distincts.
Le premier est sans doute celui né de la volonté du juge constitutionnel de s’insérer dans les débats de société, de peser sur les choix faits, de prendre position par des décisions marquantes sur des questions telles que le mariage des homosexuels, la fin de vie, l’interruption volontaire de grossesse, la peine de mort, la question de l’immigration, la laïcité, le port des armes… Les exemples sont nombreux et le sont d’ailleurs de plus en France depuis l’instauration de la question prioritaire de constitutionnalité. Ce fut ainsi le cas du conseil constitutionnel Français, mais aussi des Cours suprêmes américaine ou Israélienne par exemple, qui décidèrent de trancher des débats de société ou fondamentalement politique. En intervenant ainsi de manière franche et directe sur ces questions, le juge a clairement signifié au pouvoir exécutif les limites de son champ de compétence, quelques fois peut-être au-delà du nécessaire.
Le second est indubitablement celui du pouvoir exécutif d’éviter que ces décisions puissent être censurées par un juge a posteriori, et ce, alors même que les décisions des cours suprêmes sont largement médiatisées même auprès de la presse grand public, et ont ainsi un écho au-delà du cercle des juristes ou des constitutionnalistes. Ce fut par exemple le cas des décisions courageuses de la cour suprême israélienne, lors de la présidence de 1995 à 2006 du juge Aharon Barak, qui renforça considérablement son contrôle juridictionnel, provoquant des débats de fond, et aussi par la suite la volonté du pouvoir exécutif de réduire l’influence de la juridiction.
Autrement dit face à un pouvoir incontestable des juridictions suprêmes, les pouvoirs législatifs et exécutifs, plutôt qu’assumer la possibilité de prendre des décisions dont la légalité pourrait par la suite être contestée - mais qu’il estime être d’intérêt général - préfèrent se réfugier derrière un droit constitutionnel dont ils tentent de s’assurer du soutien, pour valider la légitimité de leur politique au seul motif qu’elle serait légale.
Une telle situation limite la possibilité de prendre des décisions légitimes mais pour autant illégales et peut à terme réduire à néant la séparation des pouvoirs.
Jean-Eric Callon est maître de conférences en droit public à l’université de Paris Sud XI – Paris Saclay