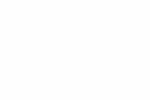« On est les champions », par Jean-Jacques Vanier

« On est les champions », par Jean-Jacques Vanier
LE MONDE SPORT ET FORME
Dans sa chronique, l’acteur et humoriste raconte sa phobie des grands rassemblements post-victoires de l’équipe de France
Le 12 juillet 1998, après la victoire de l’équipe de France lors de la finale de la Coupe du monde, des milliers de Français sont descendus dans les rues pour célébrer le 3-0 contre le Brésil. | RABIH MOGHRABI / AFP
Didier Deschamps vient de communiquer la liste des joueurs français sélectionnés pour l’Euro 2016 et, pour peu que nous soyons champions d’Europe (vous remarquerez que je me suis forcé à utiliser le « nous » et non pas le « ils »), des hordes hystériques envahiront les Champs-Elysées pour aller y crier leur joie et je m’enfermerai chez moi.
Le 27 juin 1984, j’étais à Strasbourg, je venais d’installer mon camp de base pour l’ascension du Ballon de Guebwiller par sa face nord (la plus rude). Je rentrais à Paris retrouver ma fiancée, ma couette et nos lectures : Lettres à un jeune poète, de Rilke, et, sur ses recommandations : Madame Marie Grubbe et Niels Lyhne, du Danois Jacobsen, c’est dire si j’étais heureux de rentrer à la maison.
Je descendais vers la gare de Strasbourg. Platini et Bellone venaient d’offrir à la France le titre européen. A Strasbourg, comme dans tout le pays, une foule, mâle à 99,9 %, envahissait la cité, et remontait la rue en route vers le cœur de la ville pour y hurler sa joie.
Un mec qui descend, une foule qui remonte, qui a la priorité ?
« Eh ! On est champions, on dirait que t’es pas content. T’aimes pas le foot. T’es un pédé. Ben, si t’es content, bois une bière. Prends de la bière.
– Merci, je ne bois pas à la bouteille, en plus elle est entamée, et je sais pas trop qui a bu avant, alors euh…
– Platini, il a niqué les Espagnols. Bois une bière ou c’est nous qu’on te nique. »
La bière se transsubstantiait en sueur et en sang de joueurs. Le football entrait en religion. Les fidèles communiaient au goulot. La joie de vaincre remplaçait la joie de vivre. Dieu devenait palpable et remplaçable. Dieu prenait son carton rouge, souffrait de crampes. Dribbler, lober, tirer des coups francs, marquer des buts, le nouveau Dieu peut tout faire − battre l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne, le monde entier.
« On est les champions. » Par cette petite phrase magique, tu devenais une part de Dieu et tu pouvais t’auréoler de sa gloire, te gorger de ses mérites, sortir de ta vie, et à ton tour défier le monde. En s’agrégeant, la foule devenait Dieu. « On est les champions », clamait-elle alors de plus en plus fort, de plus en plus hors d’elle.
J’ai juré ce soir-là de ne plus jamais traîner dans la rue un soir de finale, quelle qu’elle soit, et aussi de ne jamais mettre les pieds dans un stade, même pas pour un seizième de finale, encore moins pour un dix-septième.
J’ai tenu bon très longtemps mais, le 1er mai 2007, je suis allé à Charléty, le stade de la porte de Gentilly à Paris. Oui ! Pour l’élection présidentielle. Oui ! Pour le meeting de Ségolène Royal. Oui ! C’était très bon enfant, j’ai même réussi à avoir un autographe de Jean-Marc Ayrault, un de Yannick Noah et un d’Yvan Le Bolloc’h pour mes enfants.
Oh ! Divine surprise, dans les tribunes, assis à ma droite, avec Jack Lang intercalé, se tenait mon idole, un joueur de l’équipe de France de football, pas n’importe lequel, mon joueur préféré, toutes époques confondues. Plus talentueux que Bixente Lizarazu, mais moins payant au scrabble. J’allais quémander un autographe quand il s’est penché vers moi par-dessus la momie qui nous séparait et, avec le sourire du mec qui vient de marquer dans les minutes supplémentaires, il m’a dit : « J’adore ce que vous faites. »