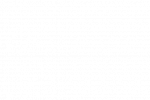Le « salut les copains » de Paul McCartney

Le « salut les copains » de Paul McCartney
Par Bruno Lesprit
A bientôt 74 ans, l’ex-Beatle tient la forme avec un tour de chant de près de trois heures le 30 mai à l’AccorHotels Arena.
Pour faire vivre leur catalogue de chansons, un des plus conséquents de l’après-guerre, Bob Dylan et Paul McCartney ont opté pour deux lignes opposées : le premier travaille dans la déconstruction dadaïste, quitte à ce que le fidèle ne reconnaisse ses œuvres que dans leurs dernières mesures ; le second préfère le remake depuis son retour à la scène en 1989, ses concerts devant d’abord être une célébration de son génie au sein des Beatles. Entre ces deux pôles, les Rolling Stones ont pris une voie médiane. Si l’on associe ces trois légendes vivantes, c’est parce qu’elles vont être pour la première fois réunies à l’affiche d’un festival, en octobre à Coachella (Californie) pour les deux week-ends de l’autoproclamé « concert du siècle », auxquel s’ajouteront les Who, l’ex-Pink Floyd Roger Waters et Neil Young.
L’événement constituera pour McCartney une extension de sa tournée « One on One », qui passait lundi 30 mai par l’AccorHotels Arena, à Paris. Moins d’un an après le concert de l’ancien Beatle au Stade de France de Saint-Denis, le 11 juin 2015. Il avait alors difficilement rassemblé 50 000 fans sur la pelouse et les gradins dyonisiens. La salle du 12e arrondissement, qui en accueille près de trois fois moins, affiche logiquement complet. McCartney rappelle la proximité des dates pour évoquer le 13 novembre 2015 : « Vous avez traversé des moments douloureux et ce soir vous allez passer du bon temps. Vous le méritez. »
Aigus déchirés
Pourquoi le bassiste gaucher enchaîne-t-il ainsi les shows, au menu copieux puisque quarante (!) chansons sont interprétées sur une durée springsteenienne, approchant les trois heures ? Peut-être parce qu’il sait qu’à bientôt 74 ans, ce plaisir est menacé. Le chanteur a reconnu récemment avoir eu quelques soucis avec ses cordes vocales. Cela se vérifie quand cet admirateur de Little Richard se mesure au rock furieux d’I’ve Got a Feeling. Ses aigus se déchirent, quand ils s’enflammaient sur Let It Be, l’album des Beatles.
McCartney fut longtemps et miraculeusement épargné par les erraillements et les errements qui ont affecté les performances d’un Roger Daltrey ou d’un Dylan ; c’est moins vrai aujourd’hui. Il peine avec l’arabesque mélodique et les vicieux changements de tonalité d’Here, There and Everywhere, curieusement accompagnée au piano. Plombée surtout par des sons programmés de claviers qui dénaturent cette sublime ballade en lui infligeant un traitement de thé dansant, façon Las Vegas. De même, les cuivres et le solo de saxophone samplés pour Lady Madonna sonnent kitsch. Ce seront les rares fausses notes d’un concert généreux et joyeux, en forme de bilan artistique, une célébration du songwriter qui débute dès la fausse première partie : un DJ remixe les œuvres du maître. Le son qui précède McCartney ne saurait être que de McCartney.
Les Beatles et les Wings
Le groupe qui l’accompagne est inchangé depuis plus d’une décennie : Brian Ray pour le doubler à la quatre-cordes ou la six-cordes, le guitariste Rusty Anderson, le claviériste et multi instrumentiste Paul « Wix » Wickens et le cogneur Abe Laboriel Jr. Seul ce dernier pose problème en faisant regretter l’humilité et la subtilité de Ringo Starr. Le dernier album, New (2013), n’est pas vraiment défendu, réduit à trois extraits, mais l’ami de Rihanna et de Kanye West s’offre le luxe de donner une version supérieure à l’original de FourFiveSeconds, le titre qu’il a co-écrit en 2015 avec des deux stars américaines. Ces nouveautés sont perdues dans un tour de chant voué aux Beatles (plus de la moitié de l’ensemble) et aux Wings. McCartney veut rendre justice à son deuxième groupe et il y parvient en revisitant des raretés comme Nineteen Hundred and Eight-Five, qui a acquis tardivement un statut de tube après avoir été initialement relégué en face B du single Band On The Run, ou encore Temporary Secretary (1980) tiré de son album solo McCartney II, à l’électro proche de Kraftwerk.
Il n’avait jamais chanté A Hard Day’s Night sans John Lennon, il le fait dès l’ouverture, quitte à s’approprier la voix principale de son partenaire, toujours présent dans les esprits puisque le public l’incitera plus tard à reprendre quelques mesures de Give Peace of Chance. Le survivant est cerné de proches disparus et multiplie les hommages : Here Today pour Lennon, Something pour son « frérot » (en français dans le texte) George Harrison, Maybe I’m Amazed pour sa première épouse Linda. S’ajoute désormais And I Love Her pour le producteur des Beatles George Martin, mort le 8 mars.
Tour Eiffel et Moulin Rouge
Mais l’ambiance est à la fête et non au requiem. McCartney reste fidèle à lui-même en mêlant dérision british et cabotinage. Il amuse d’emblée la galerie – à moins qu’il ne s’en amuse – avec son « salut les copains ! » initial, puis en chantant Michelle sur fond de Tour Eiffel et de Moulin Rouge, avant de fredonner Sur Le Pont d’Avignon, puis de lancer un Ob-La-Di-Da, guère éloigné de La Compagnie créole. ll aurait pu se dispenser d’inviter un couple à monter sur scène pour une demande de mariage. Après s’être cru à « Tournez manège ! », le spectateur a un temps l’illusion d’être au Stade de France quand le supporteur d’Everton revient pour les rappels, un drapeau tricolore en main. Son initiative déclenche une Marseillaise dans la salle, sans doute une première dans un concert de ce genre depuis Serge Gainsbourg.
Il y a, bien sûr, ces classiques attendus et interprétés en toutes circonstances (le brelan Let It Be-Hey Jude-Yesterday), connus par cœur et dont on ne se lassera jamais. Mais on retiendra plutôt la séquence la plus innovante et enthousiasmante du concert, un set acoustique de sept chansons : lui à la guitare sèche, parfois seul, Wickens à l’accordéon, et Laboriel convié à se calmer avec des balais et un tambourin. Un retour aux racines de sa culture musicale, le skiffle pour In Spite of All the Danger, toute première chanson enregistrée, en 1958, par ceux qui s’appelaient alors les Quarrymen, le son des studios Sun de Memphis, l’héritage de Buddy Holly... Même Love Me Do, avec son harmonica, emporte le morceau, après une sorte de masterclass fascinante : McCartney explique comment il a composé You Won’t See Me, à partir d’une simple phrase musicale. S’il ne peut plus s’égosiller comme avant, sa reconversion est toute trouvée : l’unplugged – le « débranché ».