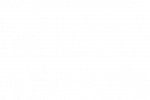Vidéo et lacrymo : leurs vies de reporters en manif

Vidéo et lacrymo : leurs vies de reporters en manif
LE MONDE ECONOMIE
Le mouvement contre la loi travail connaît une couverture inédite, où les reporters indépendants disputent l’espace aux médias traditionnels. Des « preneurs d’images » toujours plus nombreux, qui revendiquent l’immersion. Au point de risquer l’affrontement avec la police.
Depuis le début de la contestation contre la loi travail, des grappes de caméras et de smartphones fleurissent dans les cortèges. Dans le no man’s land qui sépare la ligne des CRS et les premiers manifestants, les preneurs d’images sont toujours plus nombreux et forment désormais une sphère aux profils divers. Certains sont de toutes les manifestations, casques sur la tête parfois surmonté d’une petite caméra GoPro, avec lunettes et masques à gaz. La plupart sont jeunes, certains sont photographes ou vidéastes pour des agences ou des sites indépendants, certains ont été militants, d’autres ont des liens avec les médias traditionnels.
En première ligne, ils se sont imposés au fil du mouvement. Et revendiquent l’immersion comme méthode de travail. Chez Taranis News, un site d’information centré sur les mouvements sociaux, on ne produit que des reportages longs, parfois jusqu’à 20 ou 30 minutes. Depuis le début de la mobilisation, Taranis News a dépassé les 4 millions de vues sur la plateforme Youtube. Pour Gaspard Glanz, le fondateur, âgé de 29 ans, le format long s’impose : « J’en ai tellement marre de ces sujets de télé ou tout est verrouillé politiquement : en une minute trente, il y a une seule analyse, s’agace-t-il. Nous, on montre ce qui s’est passé, en plans longs, sans commenter. Ce sont vos yeux et vos oreilles qui vous donnent l’info. »
Et de là, rien de plus simple pour Gaspard Glanz que de balayer d’un revers de main les accusations de « militantisme » qui lui collent à la peau, notamment en raison de ses engagements passés contre le « contrat première embauche » puis à l’université Rennes-2. Lui se place en « journaliste ». « Je fais mon maximum pour montrer les violences des deux côtés, précise son complice de terrain Alexis Kraland, fondateur de la chaîne Youtube Street Politics. Et finalement, à part les syndicats policiers, il y a peu de gens pour me traiter de propagandistes d’extrême-gauche ».
Dans une manifestation contre la « haine anti-flic » organisée par le syndicat policier Alliance le 18 mai dernier, le secrétaire général de l’UNSA-police Philippe Capon a dénoncé les « pseudo-reporters, ennemis déclarés du camp de la paix publique qui relaieront outrancièrement le geste malheureux d’un collègue excédé ». En retour, les concernés assurent que la police les « vise » délibérément.
Les journalistes, « des cibles identifiées » ?
Les actions des forces de l’ordre touchent d’ailleurs tous types de preneurs d’images, qu’ils soient amateurs, indépendants ou affiliés à des grands médias. « On a aujourd’hui atteint un degré de violence inédit envers les journalistes », regrette Olivier Laban-Mattei, photographe qui a travaillé sur le mouvement pour Le Monde. « Notre matériel ne se distingue pas de celui des autres. Difficile de faire la différence entre un observateur qui travaille pour un média ou un blog et un manifestant qui est dans une démarche d’activisme », raconte-t-il. Tout en soulevant cette question : « Les policiers confondent-ils les journalistes avec les manifestants qui filment ou sommes-nous devenus des cibles identifiées ? »
Vendredi, les syndicats de journalistes SNJ, du SNJ-CGT et de la FIJ/FEJ ont clairement dénoncé des « violences » policières, dans un communiqué commun.
Car sur ce point, tous ne tarissent pas d’exemples : le 2 juin, à Rennes, plusieurs journalistes indépendants et affiliés, notamment à Ouest-France et Libération ont été pris à partie par la police. Mais il y a aussi cette image du photographe « Nnoman » visé par un lanceur de balles de défense (LBD) au cours d’une Nuit Debout. Ou cet appareil photo que l’on tente d’arracher à Simon Guillemin, photographe, qui filme la scène avec une GoPro fixée sur son casque. Ces multiples coups de matraque sur des casques siglés « TV » ou « presse ».
Les images de violences font « bondir » l’audience
Certains ont connu un baptême du feu. « La première fois que j’ai pris un éclat de grenade de désencerclement dans la jambe, je ne savais même pas ce que c’était », avoue Pierre Gautheron, un photographe de 20 ans qui a signé pour Streetpress un reportage « au coeur du black bloc ». « Vous le sentez pendant quelques jours », abonde Rémy Buisine, 25 ans, qui n’était pas du tout habitué aux manifestations. S’il a commencé à filmer le mouvement Nuit debout en direct avec son smartphone, c’est plutôt comme spécialiste des réseaux sociaux : le jour, il est « community manager » pour Voltage et Ado FM.
Celui dont les « live » avec l’application Periscope sont suivis par 10 à 80 000 internautes interviewe longuement des manifestants mais constate que les violences font toujours « bondir » l’audience. Dans les « têtes de cortèges », certains s’en prennent au mobilier urbain ou à ce qu’ils considèrent comme des symboles du capitalisme. Rémy Buisine se tient alors un peu à l’écart car il filme au téléphone, mais aussi par « sécurité », en raison des « intimidations » de manifestants.
« Ceux qui nous disent d’arrêter de filmer sont les premiers à réclamer des images quand il y a des violences policières, en tant que preuves », remarque Rémy Buisine. Ce dernier, ainsi qu’Olivier Laban-Mattei, ont été témoins de la scène où un manifestant a été gravement blessé à la tempe après un lancer de grenade de désencerclement, le 26 mai à Paris. Taranis a également « fait acquitter » un manifestant grâce à une vidéo. De son côté, Mediapart a publié, le 31 mai, une compilation de violences policières. Aucune image n’est issue d’un média traditionnel.
Usant et peu rémunérateur
Les relations entre les grands médias et les vidéastes embedded dans les défilés sont distantes mais existent : ces derniers se retrouvent parfois à jouer « l’office du tourisme de la manif » pour des journalistes de chaînes d’info en continu, chambre Gaspard Glanz, avec une pointe de morgue. Les télévisions et sites web de presse reprennent régulièrement des images d’indépendants ou d’amateurs, comme celles de la voiture de police brûlée à Paris. L’AFP achète parfois des images repérées en ligne. Mais malgré ces succès ponctuels, suivre le mouvement rapporte très peu d’argent à ces reporters indépendants. « On a travaillé à perte jusqu’à mi-avril », explique M. Glanz, qui n’a pas de carte de presse et dont l’agence est notamment financée par les vues générées sur Youtube.
Malgré l’investissement physique consenti depuis trois mois, les preneurs d’images combattent l’usure. Trouver des façons de renouveler son travail est un autre défi. « C’est un mouvement assez hétéroclite et intergénérationnel, raconte Raphaël Yaghobzadeh, collaborateur régulier du Monde. Il y a beaucoup de choses à photographier. » « Les manifestations ont évolué vers des formes nouvelles, avec des occupations de lieux et des manifestations spontanées de nuit », complète « Nnoman ».
Dans un témoignage très relayé sur Facebook, Pierre Gautheron explique : « C’est très formateur un mouvement social pour un jeune photojournaliste ». Il y médite sur la difficulté de rester « neutre » ou de ne pas céder aux réflexes de la « meute » de journalistes. Avant de saluer la fraternité nouée sur les pavés au printemps : « On se répète au fil des semaines ’Le jour où ça se termine, on se voit tous ensemble et on fait la fête’ . »