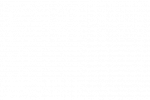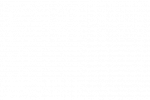L’AFRIQUE INTIME Comment j’ai parlé de (son) sexe à ma fille

L’AFRIQUE INTIME Comment j’ai parlé de (son) sexe à ma fille
Par Axelle Jah Njiké (chroniqueuse Le Monde Afrique)
Plaidoyer de notre chroniqueuse sur la nécessité d’un dialogue avec ses enfants. Pour que la sexualité cesse d’être un tabou qui engendre de la violence sociale.
Dans le camp de Tindouf, situé au sud de l’Algérie, en mars 2016. | © Zohra Bensemra / Reuters / REUTERS
Je n’ai jamais parlé de sexe avec mes parents. Pour une raison simple : je n’ai pas grandi auprès d’eux. J’ai grandi avec mes deux frères aînés, qui étaient, aux yeux de la loi, mes tuteurs légaux. Etre une petite fille éduquée par deux grands frères n’était pas très courant à l’époque – et je ne suis pas certaine que ça le soit davantage aujourd’hui. Aucun de mes deux frères ne m’a jamais parlé de sexualité, d’amour ou de couple. On n’abordait pas ces sujets-là dans la maison, ni ailleurs. L’essentiel était les études et ma conduite à l’extérieur.
L'AFRIQUE INTIME : faut-il parler de sexe à ses enfants?
Durée : 11:34
Pourtant, dans les placards fermés à clé de l’appartement dans lequel j’ai grandi, dont j’avais très vite appris à crocheter les serrures, des numéros de Playboy, d’Union et des cassettes vidéo porno (oui, j’ai grandi à une époque où il n’existait pas de DVD ni d’Internet !) ne laissaient pas le moindre doute sur l’intérêt pour la chose de la part des hommes de la maison.
Devenir un sujet sexuel
J’ai regardé à 10 ans mon premier porno avec circonspection, en ne comprenant pas très bien ce que cette fille américaine faisait avec le goulot de cette bouteille de Coca introduit dans son vagin. J’ai lu en cachette Union et Playboy avec la même curiosité que je lisais la Bibliothèque rose et les aventures de Fantômette. Ces lectures (et bien d’autres, que j’ai par la suite su dégoter dans les rayons des bibliothèques municipales ou à la librairie de la presse en bas de chez moi), ont pallié un manque absolu de parole sur les relations sexuelles sous le toit où je grandissais, et m’ont appris que le sexe ne servait pas qu’à avoir des enfants.
Elles m’ont permis de penser ma sexualité avant de la vivre dans la chair, puis de mettre un mot sur le processus physiologique d’excitation qui se manifestait chez moi à la lecture de Vénus Erotica, Emmanuelle, La Bicyclette bleue, Sexus ou L’Amant de lady Chatterley.
Ces ouvrages ont excité mes sens et fait de moi un sujet sexuel, en mesure de réfléchir, de penser, de verbaliser mon désir. Ils m’ont aussi enseigné que le sexe entre adultes consentants était un territoire de liberté absolue.
Cette éducation autodidacte à la sexualité par la littérature, le témoignage – j’ai préféré d’emblée la lecture à l’image, plus charnelle, vivante, jubilatoire – m’a dotée d’un imaginaire érotique et sensuel sans pareil, qui m’a permis de prendre possession de mon désir. D’en connaître l’existence, les manifestations, les mécanismes. Grâce à lui, je n’ai jamais mis les pieds dans le lit d’un partenaire sans être en mesure d’énoncer, de montrer, de confier ce qui pouvait me faire envie. Jamais l’idée ne m’a traversé l’esprit que ma jouissance était moins légitime que la sienne, et son expression, inconvenante.
En construction permanente
Sans doute parce que je déplorais n’avoir jamais pu poser la moindre question sur le sujet aux deux adultes qui avaient la charge de mon éducation, je mis un point d’honneur, devenue mère, à aborder ouvertement le propos avec ma fille. Parler d’une sexualité qui n’était pas uniquement centrée sur l’aspect sanitaire de la prévention des grossesses non désirées et des maladies, pour lui permettre de faire ses choix. Car du sexuel découle le social, puis le politique. Particulièrement pour les femmes, dont la sexualité est associée à la honte, de la même façon, partout dans le monde.
Tenir un discours sur les relations intimes, en rapport avec le plaisir, l’estime de soi, le relationnel, ne m’apparaissait pas comme une incitation à la promiscuité sexuelle, mais une nécessité dans une société où, selon l’enquête Contexte de la sexualité en France de 2007, 59 % de femmes victimes de viol ou de tentative de viol avaient été agressées pour la première fois alors qu’elles étaient mineures.
Informer ma fille sur son sexe (sa vulve, son clitoris, son vagin, son utérus), c’était lui permettre d’envisager sa sexualité comme un projet personnel en construction permanente, une part de son identité, un élément fondamental de ses relations intimes qu’elle développerait, définirait et négocierait tout au long de sa vie.
C’était aussi l’instruire sur son droit à dire non. A ne jamais se faire violence pour rien. Ni tolérer d’être forcée à une pratique ou à une autre.
Il m’était intolérable en tant que femme, amante et mère, que rien ne puisse jamais lui avoir été dit sur son droit à une vie sexuelle et au plaisir. D’autant plus si elle devait un jour, en dépit de toute notre vigilance de parents, faire partie des 59 % de ces mineures agressées.
La vie sexuelle de ma fille avait moins de chances, me semblait-il, de débuter dans le non-dit, la contrainte et la violence, si je lui apprenais à dire oui, à être sujet de son désir et à refuser qu’on lui impose des rapports intimes qu’elle n’aurait pas souhaités.
Partager avec elle une vision du plaisir, de la sexualité, très positive, simple et émotionnelle, c’était lui affirmer qu’un rapport sexuel était un acte privé entre deux individus consentants.
Il s’agissait de lui donner non seulement la permission d’apprécier le sexe, mais aussi celle d’avoir confiance en elle, en son corps, dans l’image que ce dernier renvoyait, dans sa capacité à donner et à recevoir du plaisir.
Combat de tous les jours
Aujourd’hui encore, je crois qu’il est de notre responsabilité, en tant que parents et citoyens, de parler de sexualité, d’intimité, de plaisir avec nos enfants, nos adolescents. C’est dans les messages qu’elle envoie à ses enfants qu’une société en dit plus sur ses valeurs et sur ses objectifs, sur ses motivations et sur ses interdits. Ne pas être en mesure d’aborder avec eux la façon dont nous nous développons sexuellement, dont nous nous attachons à l’autre, dont nous parlons de l’amour et nous adonnons aux plaisirs du corps, revient à dire que le sexe est un problème. Qu’être parents empêche d’être amants.
L’amour que nos enfants éprouvent pour nous et le regard bienveillant que nous portons sur eux nécessitent de répondre à leurs inquiétudes sur la normalité du corps. Leur confier que les qualités les plus appréciées chez un partenaire ont beaucoup plus à voir avec une forme d’attention et de saine communication qu’avec la taille de son sexe ou la durée des rapports.
Dans notre monde où les inégalités sont encore très (trop) présentes et font l’objet d’un combat de tous les jours pour bon nombre d’entre nous, combattre certaines d’entre elles requiert de faire évoluer le discours sur nos relations intimes, sur le couple, sur la parentalité.
Nous sommes seuls en mesure de replacer la sexualité dans son contexte, qui n’est pas celui d’une performance, mais d’un partage. Et cela passe par la parole. Une parole sur l’intime, autorisant explicitement nos jeunes à incarner une sexualité solaire, vibrante et reliée à leur prochain.
Une parole sur le plaisir disant à nos filles que leur corps leur appartient, que leur épanouissement sexuel est un besoin naturel et existentiel tout aussi légitime que celui de leurs frères, et enseignant à nos fils le consentement, le respect de soi et de l’autre au cœur des valeurs de la rencontre sexuelle.
A défaut, l’intime continuera à être synonyme dans la majeure partie de nos sociétés, d’outrages, de violences, d’abus et de domination. Et les violences faites aux femmes, le reflet de cet état de fait.
Axelle Jah Njiké est écrivaine, entrepreneuse et administratrice au sein de la fédération GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants).