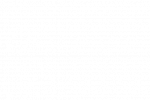« Une nouvelle année » : chronique d’une séparation

« Une nouvelle année » : chronique d’une séparation
Par Mathieu Macheret
Adapté d’un roman d’Alexandre Volodine, le film de la réalisatrice russe Oxana Bychkova observe la dissolution du lien unissant un couple de jeunes Moscovites.
Une nouvelle année fait partie de ces petits films qui se nichent discrètement au creux d’un été de sorties ternes et vous cueillent sans crier gare. Non parce qu’il serait un chef-d’œuvre, mais par sa nature même, inégale, vacillante, inaboutie, qui parvient à force de persévérance à faire naître une émotion profonde et inattendue, de celles dont le scintillement éclaire à rebours son cheminement incertain.
De la persévérance, il en faut, justement, pour entrer dans ce cinquième long-métrage et premier à sortir en France de la réalisatrice russe Oxana Bychkova, adaptation actualisée d’un roman du dramaturge Alexandre Volodine (1919-2001), l’un des disciples de Tchekhov. Celle-ci se présente comme la radiographie d’une séparation, celle d’un couple de jeunes Moscovites d’aujourd’hui. Séparation qui avance masquée, comme une suite de microfissures imperceptibles qui enrayent, puis bientôt défigurent le cours du quotidien.
Deux lignes de vie opposées
Lui, c’est Igor, une grande asperge timide et renfrognée, qui, la nuit venue, fait le taxi clandestin parce qu’il ne trouve pas d’autre emploi, et d’ailleurs n’en cherche plus. Elle, c’est Zhenia, un petit lutin joufflu et sautillant qui fait ses débuts de graphiste dans un magazine en vogue. Ils sont mariés, vivent dans un humble appartement et peinent à joindre les deux bouts. Dès les premières scènes, ils semblent marcher sur deux lignes de vie opposées : Igor se couche quand Zhenia se lève, elle s’épanouit au grand jour quand lui se recroqueville dans l’anonymat nocturne. Elle évolue dans un milieu branché, tandis que lui croupit dans son complexe de provincial déraciné, qui ne souhaite pas se laisser altérer par les rythmes et les modes de la capitale russe.
La jalousie ne tarde pas à pointer le bout de son nez et, avec elle, son lot de crispations, de vexations, de dérapages. Pourtant ces deux-là s’aiment, quand, dans les pauses de leur séisme intime, leurs corps se rejoignent et s’étreignent fiévreusement.
Moscou sous un jour inattendu
Ces situations, il nous semble les avoir croisées maintes fois. Rien, du réalisme sans effet de la mise en scène au mode narratif de la chronique, égrenant au rythme des jours des événements issus de la plus franche banalité (faire des courses, organiser un repas, aller au travail), ne leur confère ici un relief particulier. Si Moscou nous apparaît sous le jour inattendu d’une urbanité moderne, on s’agace que l’érosion du couple soit trop systématiquement assimilée à une question de milieux (en être ou pas), ou cède à l’opposition un peu facile entre l’artificialité de la « branchitude » et l’authenticité du cœur.
Pourtant, il y a un certain courage à s’arrimer ainsi à deux personnages ordinaires, sans s’appuyer sur des traits hors norme ou spectaculaires. L’attention que leur prête la caméra, la patience avec laquelle elle les observe, et qu’elle exige en retour du spectateur, ont pour vertu de les rendre infiniment proches. Celles-ci brillent particulièrement dans les nombreuses scènes de groupe (repas, fête, soirée), où l’un des partenaires semble à chaque fois perdu, déphasé, à contre-courant des autres. On comprend alors que la maladie du couple, c’est un rapport grippé entre l’intérieur et l’extérieur, entre la volonté utopique de ne faire qu’un et le besoin vital de se frotter aux autres.
La suite logique, fidèle à la loi d’entropie amoureuse, serait celle des cris et des larmes, des règlements de comptes et des crises de nerfs à n’en plus finir. Il n’en sera rien. Au contraire, le film prend un nouveau tour dès qu’il sanctionne la séparation effective de ses personnages, à l’occasion d’une scène splendide : Igor et Zhenia, qui n’arrivent pas à se haïr malgré toutes leurs dissensions, rompent dans la joie et pouffent de rire au nez du fonctionnaire qui valide par tampon leur acte de divorce.
Ce que le film a de plus beau, et qui advient alors, c’est qu’il ne considère pas la rupture comme un terme : on suit encore les personnages dans de nouvelles configurations d’existence, par un montage parallèle qui les réunit dans leur distance même, comme si leur relation n’en finissait jamais de finir – et l’on comprend alors qu’elle n’en finira jamais.
Une confidence terrassante
Ainsi l’amour n’est pas perçu comme le moment d’une inexorable séparation ; c’est au contraire la séparation qui est comprise comme un moment de l’amour, et sans doute le plus intense, tant elle contient son épreuve de vérité suprême. Pas à pas, et en partant de la réalité la plus prosaïque, Une nouvelle année installe donc une forme d’eschatologie amoureuse, percevant dans l’acceptation des forces corrosives qui déchirent le couple le secret même de son éternité.
Dans une dernière scène d’une grande beauté, qui voit Igor au chevet d’une Zhenia en proie au délire, celle-ci lui glisse dans l’oreille le souffle d’une confidence terrassante : le monde ne suffira pas à leur confisquer le vertige d’une caresse, qui pourra bien tout emporter avec elle. Et cette pure bouffée d’ivresse désirante et d’abandon souverain, fondue dans un regard de tendresse déchirante, valait bien la peine d’en arriver jusque-là.
Film russe d’Oxana Bychkova. Avec Nadya Lumpova, Alexey Filimonov, Natalya Tereshkova. (1 h 47). Sur le web : www.norte.fr/