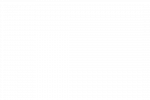En Égypte, les professeurs déplorent le déclin de la langue arabe

En Égypte, les professeurs déplorent le déclin de la langue arabe
Par Aziz El Massassi (Contributeur Le Monde Afrique, Le Caire)
Les universités du pays délaissent pour la grande majorité l’enseignement de l’arabe littéral au profit de l’anglais
Wael Fate soupire un long moment après avoir commandé un expresso. Attablé à la terrasse d’un petit café de Zamalek, un quartier branché du Caire, ce jeune interne en médecine se plaint d’avoir une nouvelle fois échoué à son examen final d’arabe. « L’arabe c’est la langue de ma femme de ménage, du petit peuple, s’enorgueillit Wael Fate en levant les yeux au ciel. Je n’aime pas cette langue, je suis Egyptien mais je préfère parler l’anglais. J’ai fait toute ma scolarité dans cette langue et aujourd’hui on me demande de maîtriser l’arabe ? »
Phare mondial de la langue arabe, l’Egypte ne délivre plus un enseignement de qualité à ses propres enfants. Alors que, en ce milieu d’été, les étudiants étrangers ont déserté le pays, les professeurs déplorent la régression persistante du niveau des Égyptiens en arabe littéral, le fous’ha, qui se distingue de l’arabe parlé dans la rue, le dialecte égyptien appelé ‘ammeya. Langue du pauvre selon l’élite anglophone, celle du Coran pour les Coptes et langue des religieux aux yeux des libéraux, le fous’ha reste la langue officielle de l’Egypte.
« L’arabe littéral n’est plus que la langue de la littérature, de l’administration et de la religion, constate presque sans amertume Fehr Shakir, vice-président du Centre de langue et culture arabe de l’Université du Caire, un établissement public. Parce que l’anglais est devenu la langue usuelle dans le monde entier, les étudiants estiment qu’il devient inutile de connaître l’arabe. Il reste encore certains jeunes qui s’inscrivent ici car ils se destinent à l’enseignement, au journalisme, aux métiers de la justice ou parce qu’ils s’intéressent particulièrement à la religion ».
Après vingt-six ans d’expérience, Hala Fouad, professeure d’arabe littéral, dresse un constat accablant : « Dans les écoles publiques, le niveau est catastrophique. À cause du manque de moyens et des fraudes généralisées aux examens, beaucoup d’étudiants sortent du système sans maîtriser véritablement l’écriture et la lecture de l’arabe. Nos étudiants seront amenés à occuper des postes dans la fonction publique, où l’arabe littéral est omniprésent. Certains partiront travailler dans les pays du Golfe, où l’Égyptien n’est pas aussi bien compris qu’on ne le pense ».
Les écoles internationales accusées de mépriser l’arabe
Désormais directrice du département d’arabe à Malvern College, une prestigieuse école britannique qui accueillera ses premiers étudiants égyptiens à la rentrée prochaine dans un luxueux campus encore en chantier, Hala Fouad déplore également l’absence de régulation des écoles internationales, accusées de mépriser l’enseignement de l’arabe alors que le ministère de l’Éducation l’impose à tous les établissements.
« Il est assez édifiant de voir l’attachement des étudiants étrangers à leur langue maternelle, contrairement à nos jeunes Égyptiens qui rechignent à maîtriser parfaitement l’arabe, s’émeut cette professeure très concernée. Il est vrai que nos programmes sont anciens et les méthodes inadaptées au monde d’aujourd’hui. Dans nos librairies, la littérature étrangère est par ailleurs plus riche et intéressante. Nous n’avons plus, dans le monde arabe, de publications aussi passionnantes que par le passé ».
Mais même pour cette jeunesse des écoles internationales qui ne fréquentent que les restaurants dont les menus sont exclusivement rédigés en anglais, la méconnaissance de l’arabe peut devenir un handicap. « Je suis confronté à ce problème au travail, reconnaît Wael Fate, l’air plus contrit. Je parle et comprends tout ce que j’entends bien sûr, mais c’est très difficile pour moi de le lire et surtout de l’écrire. »
Il en voit les conséquences tous les jours. « A l’hôpital, il m’est arrivé plusieurs fois de commettre des fautes et des erreurs dans des rapports ou des ordonnances, se souvient-il. Heureusement que les infirmières me relisent toujours, elles me connaissent bien maintenant et vérifient ce que j’écris, en se moquant gentiment de moi ».
Réputation mondiale des établissements religieux
Connues pour leur rigueur dans l’apprentissage de la langue du Coran, les établissements religieux se targuent quant à eux d’un niveau d’excellence qui fait leur réputation mondiale. A la célèbre université Al-Azhar, des milliers d’étudiants égyptiens et étrangers sont inscrits, principalement pour des raisons religieuses, à la faculté de langue arabe.
Son doyen, Mohamed Al Marahsawy, estime que tout le système scolaire égyptien gagnerait à s’inspirer d’Al-Azhar. « Les écoles et les instituts devraient n’enseigner que dans la seule langue arabe, préconise-t-il. Les jeunes n’aiment plus l’arabe classique car les médias qui s’adressent à eux utilisent majoritairement le dialectal. Il est donc indispensable que les professeurs soient formés pour raisonner nos élèves et leur faire comprendre que l’arabe littéral est aussi une langue usuelle ».
Devenu l’un des instituts privés de langue arabe les plus réputés, avec plusieurs antennes en Égypte et en Turquie, le Centre Fajr revendique également une imprégnation religieuse - Fajr, qui signifie l’aube en arabe, est la première des cinq prières quotidiennes en islam. Le responsable pédagogique du centre, Fate Atteya considère que seul l’arabe littéral permet d’élever les esprits. « Que l’on souhaite parler le ‘ammeya ou le fous’ha, le but n’est pas le même, juge cet ancien professeur d’arabe.
« On utilise le ‘ammeya pour faire du commerce, pour converser dans la rue ou regarder des séries à la télévision, continue-t-il. Si l’on veut accéder aux livres et comprendre le Coran, on choisit la voie du littéral. Et cette aspiration me semble autrement supérieure à la première ».
« Je me demande de quoi je devrais être fier ? »
Musulman non pratiquant, peu intéressé par les livres, Wael Fate a construit son rapport à la langue arabe en l’associant au contexte politique et social de la région. « Je me demande de quoi je devrais être fier ? s’interroge-t-il alors lorsque ses amis le raillent sur ce désintérêt pour sa propre culture. Je comprends que les Français ou les Italiens soit fiers de leur langue parce qu’ils peuvent se vanter de leur culture, de leur mode de vie, de leur ouverture ; mais regardez ce qu’il y a autour de nous : la misère, l’intolérance et la violence. Rien de tout cela ne me rend fier ».
Partageant jadis ce sentiment, George Shaker, étudiant en commerce international, confie que la révolution a été le déclic qui a « tout changé ». « Avant je n’écoutais même pas les chansons égyptiennes, raconte ce jeune mélomane en raccordant le oud [le luth oriental] qu’il tient dans ses bras. Au moment de la révolution, j’ai découvert toute une culture que j’ai volontairement ignorée pendant mon adolescence. Depuis, je me suis pris de passion pour la musique et la poésie arabe. Rien ne me rend plus heureux que de pouvoir chanter dans cette langue lorsque je joue de cet instrument ».