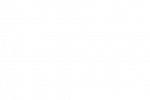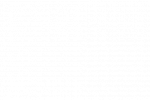Les banques minées par le futur

Les banques minées par le futur
Editorial. Si en 2009, les banquiers savaient ce qu’il fallait faire pour sauver leurs établissements en perdition après des années de dérégulation et de prises de risque insensées, aujourd’hui, c’est leur métier même qui est remis en cause.
Banque Unicredit à Milan,en Italie, le 2 août. Beaucoup de banques ont vu leur action chuter suite à la série de tests réalisée fin juillet par l’Autorité bancaire européenne (ABE). | Antonio Calanni / AP
Editorial du « Monde ». Sur les rives ensoleillées du lac de Côme, en avril, François Pérol avait résumé tout le drame du secteur bancaire : « Je suis beaucoup plus inquiet que je ne l’étais en 2009 », avait expliqué l’ancien conseiller économique de Nicolas Sarkozy et actuel président du directoire du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), lors du forum Ambrosetti en Italie.
Ce paradoxe se comprend : à l’époque, en pleine crise financière, les banquiers savaient ce qu’il fallait faire pour sauver leurs établissements en perdition après des années de dérégulation et de prises de risque insensées. Aujourd’hui, c’est le métier de banquier même qui est remis en cause. « Les banques vivent des transformations fondamentales dans un environnement incroyablement difficile en raison des taux d’intérêt négatifs », avait précisé M. Pérol.
Chute en Bourse
Les investisseurs partagent cette opinion : ils ne croient guère en leurs banques, comme en atteste la chute en Bourse des valeurs bancaires après la publication, fin juillet, de tests de résistance décevants concernant les 51 principales banques européennes. Dans cette troisième série de tests réalisée depuis la crise par l’Autorité bancaire européenne (ABE), les banques devaient résister à un recul par rapport aux prévisions de 7,1 % du PIB européen et à une baisse de 20 % des revenus d’intérêts. Les résultats montrent un secteur convalescent, mais l’avenir reste très incertain.
Le souci majeur porte sur les taux d’intérêt négatifs. Les banques doivent désormais payer lorsqu’elles déposent des fonds à la Banque centrale européenne (BCE). Pis, les taux de marché à long terme sont désormais négatifs ou dérisoires, comme en atteste l’effondrement à 1,7 % des taux des prêts immobiliers en France. A long terme, cette politique monétaire censée éviter la récession sera très pénalisante pour les banques.
Deuxième souci, justement, la crise économique. Sans rebond de l’activité, pas de reprise du crédit ni de vrai redressement des banques. Sur ce point, l’inquiétude vient d’Italie. Ses établissements sont minés par des créances douteuses. En cause, notamment, la croissance anémique qui s’éternise sur la Péninsule mais aussi sur le reste du continent. Dans ce contexte, les investisseurs s’inquiètent d’une crise bancaire italienne qui contaminerait le reste de l’Europe, d’autant qu’il existe d’autres maillons faibles : les banques grecques et portugaises n’ont même pas été testées par l’ABE, tandis que la Deutsche Bank ne cesse d’inquiéter les investisseurs.
Troisième sujet, l’assainissement des bilans bancaires a été beaucoup trop lent. Les banques se plaignent aussi des exigences européennes de capitalisation, censées éviter toute faillite mais qui pèsent sur leur rentabilité et leur compétitivité par rapport aux banques américaines.
Incertitudes sur l’avenir de la City
Quatrième défi, l’évolution du métier. Les établissements classiques, avec leurs cohortes d’agences, sont en passe d’être « ubérisés ». Pourquoi ne pas choisir un simple porte-monnaie électronique, comme le fait l’entreprise de télécoms Orange en Afrique, plutôt qu’une banque, qui ne rémunère pas les dépôts et factures des frais de tenue de compte croissants ?
Ajoutons-y les graves incertitudes liées au Brexit et celles sur l’avenir de la City, véritable centre financier offshore de la zone euro, qui risque de paralyser le secteur. Les banques ne sont pas affaiblies par le passé. Elles sont malades de leur avenir.