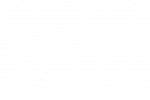Loi travail : après l’adoption, les syndicats veulent multiplier les recours contre le texte

Loi travail : après l’adoption, les syndicats veulent multiplier les recours contre le texte
Par Sarah Belouezzane
Sept syndicats appellent à manifester jeudi contre le texte, promulgué en août. Ils continuent à demander son abrogation, ou, du moins, en empêcher l’application.
Jean-Claude Mailly (FO) et Philippe Martinez (CGT), en juillet 2016. | GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP
Comment continuer le combat quand le vainqueur est déjà déclaré ? C’est la question complexe que vont devoir résoudre syndicats et opposants à la loi travail en cette rentrée. Car le texte a été bel et bien promulgué en août en dépit des grèves et autres manifestations organisées à un rythme effréné entre février et juillet. Et l’ultime – du moins pour l’instant – mobilisation prévue jeudi 15 septembre dans toute la France à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires, de l’UNEF, de l’UNL et de la FIDL ne devrait pas y changer grand-chose. Pourtant, les contempteurs de la loi n’en démordent pas : il faut continuer à demander son abrogation pure et simple, ou du moins en empêcher l’application.
« Ce projet de loi n’était pas bon au printemps, la loi n’est pas bonne à l’automne et, donc, il faut continuer à se mobiliser », a déclaré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, au micro d’Europe 1, lundi 12 septembre.
Comme FO, son alliée de circonstance dans la lutte contre le texte, la centrale de M. Martinez souhaite désormais porter l’estocade sur le terrain juridique.
Mais Fabrice Angeï, secrétaire confédéral responsable du suivi de la loi travail à la centrale, prévient : « Nous sommes encore en phase préparatoire pour savoir exactement de quels recours nous disposons et auprès de quelle juridiction nous allons les porter. Nous savons que ce sera un long processus. » « La loi a beau être promulguée, nous allons mobiliser tous les moyens en notre possession », ajoute le responsable.
Même discours chez FO, qui devait réunir mercredi 14 septembre les responsables de son service juridique ainsi que ses avocats pour établir un plan de bataille. « Il va falloir porter le combat sur tous les fronts possibles. Quelques fois, il vaut mieux utiliser le Conseil constitutionnel et, d’autres fois, plutôt l’Organisation internationale du travail (OIT) ou même la Cour de justice européenne », confirme ainsi Didier Porte, secrétaire confédéral chargé des questions juridiques.
« Nous allons invoquer une rupture d’égalité entre les salariés »
Pour les deux organisations syndicales, le premier angle d’attaque ne fait aucun doute : il s’agira des questions prioritaires de constitutionnalité. Saisi par des parlementaires en juillet, le Conseil constitutionnel n’avait censuré que des dispositions secondaires de la loi. Et il ne s’était pas exprimé sur deux des questions qui ont le plus cristallisé l’opposition au texte (l’inversion de la hiérarchie des normes en matière de temps de travail et le licenciement économique), laissant la porte grande ouverte aux QPC.
« Nous allons particulièrement nous intéresser à l’inversion de la hiérarchie des normes et au licenciement économique, affirme M. Angeï. Dans les deux cas, nous allons invoquer une rupture d’égalité entre les salariés d’une même branche. »
Car, explique le responsable syndical, si un accord d’entreprise prime sur un accord de branche en matière de temps de travail, les salariés d’une même filière n’auront pas les mêmes conditions de travail. Idem pour le licenciement économique où le critère, pour chaque société, sera différent en fonction de la taille. « Les salariés ne seront donc pas logés à la même enseigne », insiste M. Angeï.
Mais, les syndicats le savent, pour déposer les QPC, il faut attendre que la loi soit en vigueur et qu’une de ces dispositions s’applique en particulier à des travailleurs. Ils ont donc décidé de « centraliser le processus et de prendre en charge les recours ». « Nous veillerons à soutenir tous les recours des salariés et toutes les questions soulevées par des représentants syndicaux », explique M. Porte, de FO. A la CGT, on veut aussi rédiger un guide pratique de recours possibles contre la loi. « Ça nous permettra d’agir de façon coordonnée et d’être à l’offensive », assure M. Angeï, de la CGT.
« Ils vont se casser les dents sur des articles inattaquables »
Outre le Conseil constitutionnel, FO envisage, pour sa part, de porter la question auprès de la Cour de justice européenne, arguant du fait que la loi contrevient à des directives européennes, notamment celle sur le temps de travail, en matière de santé et de sécurité.
Mais c’est sur l’OIT que tous les regards se portent. Les syndicats veulent attaquer la loi auprès de l’institution des Nations unies au motif qu’elle « contrevient à la liberté syndicale ». Dans leur viseur, deux récriminations : ils estiment d’abord ne pas avoir été vraiment consultés au moment de l’élaboration de la loi, ce qui « viole la convention de l’OIT de 1998 », explique-t-on à la CGT. Ensuite, la disposition contenue dans le texte sur la possibilité d’avoir recours à un référendum d’entreprise contournerait, selon eux, directement la liberté syndicale et violerait les conventions. Tous ont en tête la plainte déposée à l’OIT contre le contrat nouvel embauche en 2006. Un an plus tard, l’organisation onusienne l’avait déclaré contraire au droit international, ce qui avait conduit à son abrogation, en 2008.
Faut-il s’attendre à un tel scénario en 2017 ? « Ce sera très difficile, relève une source au ministère du travail. L’OIT n’a aucun intérêt à s’aliéner la France et le sujet est plus complexe que celui du CNE. » Quant aux QPC, Patrick Thiébart, avocat spécialisé en droit social au cabinet Jeantet, rappelle qu’elles ne sont pas directement transmises au Conseil constitutionnel. Elles passent d’abord par le Conseil d’Etat, ce qui risque de prendre beaucoup de temps : « De plus, ajoute-t-il, ils vont se casser les dents sur des articles inattaquables comme celui sur l’inversion de la hiérarchie des normes. »
Dans l’entourage de Myriam El Khomri, ministre du travail, on se dit en tout état de cause « sereins ». « Nous travaillons le sujet depuis des mois et nous nous sommes assurés que tous les articles, ainsi que les décrets que nous allons rédiger, sont conformes. » L’issue de la bataille pourrait ne finalement pas être connue avant plusieurs années.