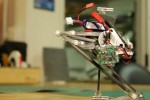Des Français pour évaluer l’impact du futur plus grand barrage d’Afrique

Des Français pour évaluer l’impact du futur plus grand barrage d’Afrique
Par Vincent Defait (contributeur Le Monde Afrique, Addis-Abeba)
L’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan sont parvenus à un accord alors que le Grand barrage de la renaissance éthiopienne est en construction depuis 2011.
L’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte ont choisi deux entreprises françaises pour mener des études d’impact du Grand barrage de la renaissance éthiopienne, en cours de construction sur un affluent du Nil Bleu. A moins d’un an de la fin des travaux.
Il leur aura fallu près de deux ans pour s’entendre sur ce point : mardi 20 septembre, l’Egypte, le Soudan et l’Ethiopie ont fini par signer un accord déléguant à deux entreprises françaises, BRL et Artelia, le soin de mener des études d’impact du Grand barrage de la renaissance éthiopienne (GERD). A moins d’un an, officiellement, de la fin des travaux, à quoi peut bien servir une étude qui nécessitera onze mois pour être réalisée ? « A restaurer la confiance entre les trois pays », a répondu le ministre éthiopien de l’eau, de l’irrigation et de l’énergie, Mutuma Mikasa, de retour à Addis-Abeba.
Ambitions industrielles
Les trois pays riverains du Nil Bleu reviennent en effet de loin. Depuis le premier coup de pioche, en 2011, le projet envenime leurs relations. Depuis ce jour où Addis-Abeba a commencé de bâtir, dans l’ouest du pays, à une vingtaine de kilomètres de la frontière soudanaise, le futur plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique. Sans publier d’études solides sur les possibles impacts du barrage, ni en avertir ou consulter personne.
En aval de l’affluent du Nil, l’Egypte s’était habituée à jouir de la totalité des eaux du fleuve depuis la signature de traités avec l’ancien colon britannique en 1929 et en 1959. Sans le Nil et le lac Nasser, l’Egypte n’est rien, ou presque. Son agriculture et son industrie en dépendent quasiment à 100 %. A l’époque en pleine révolution, Le Caire avait trop à faire sur la scène nationale pour convaincre Addis-Abeba de repenser ses ambitions. Quatre régimes politiques plus tard, l’Egypte s’est résolue à entretenir des relations cordiales avec l’Ethiopie, qui n’a, de toute façon, jamais eu l’intention de cesser les travaux. En 2015, les chefs des trois Etats avaient signé un premier accord de coopération, ouvrant la voie à une éventuelle gestion commune des eaux de la région.
Le chantier, financé à hauteur de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros) sans aide extérieure, a été confié sans appel d’offres à la société italienne Salini Impregilo, habituée des grands projets hydrauliques en Ethiopie. Avec une puissance théorique de 6 000 mégawatts (MW), soit l’équivalent de six petites centrales nucléaires, le GERD devrait compléter une kyrielle d’autres barrages plus modestes qui permettront à l’Ethiopie de produire assez d’énergie pour nourrir ses ambitions industrielles. Et exporter de l’électricité chez ses voisins.
Précieux revenus
Le groupe français Alstom a été choisi pour fournir huit des seize turbines du barrage. Ce sont donc deux autres entreprises françaises qui se joignent au projet afin d’établir le « modèle des ressources en eau » et d’évaluer « les impacts socio-économiques » du barrage, d’après le ministre éthiopien Mutuma Mikasa. Et si les études françaises venaient à contrecarrer les plans éthiopiens ? « Les trois pays se mettront d’accord », a tenté de rassurer le ministre.
Le dilemme, à l’heure actuelle, réside essentiellement dans le nombre d’années que les Ethiopiens sont prêts à prendre afin de remplir le réservoir de 79 milliards de mètres cubes. Le remplir trop vite peut assécher le fleuve en aval. Trop tarder revient à repousser le jour où le barrage produira enfin à sa pleine puissance.
C’est qu’Addis-Abeba a besoin d’énergie pour maintenir sa croissance et générer de précieux revenus en vendant son électricité à ses voisins. Le Soudan et Djibouti sont déjà raccordés au réseau éthiopien. Le Kenya et la Tanzanie devraient l’être prochainement. « Il est important de connecter les pays. Cela contribue à la paix et la stabilité régionale », a poursuivi, ressassant la ligne officielle, le ministre de l’eau.