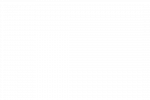Zep : « J’ai failli arrêter la bande dessinée »

Zep : « J’ai failli arrêter la bande dessinée »
Propos recueillis par Pascale Krémer
Le père suisse de Titeuf, Philippe Chappuis, grand prix de la ville d’Angoulême en 2004, délaisse parfois le gamin à mèche auquel il doit son succès pour des œuvres plus réalistes. La dernière, « Un bruit étrange et beau », vient de sortir en librairie.
Je ne serais pas arrivé là si…
… s’il n’y avait pas eu la peur. Par un hasard de calendrier, je suis né à la mi-décembre, donc je suis entré directement en deuxième année de maternelle et j’avais presque un an de moins que les tous les autres élèves. Le premier jour où mon père m’a traîné à l’école, un peu de force, j’ai fichu le camp ! J’avais l’impression qu’il m’avait lâché chez les géants.
C’est parce que le vrai monde me flanquait la trouille que je me suis inventé un monde imaginaire, rigolo. L’humour me rassurait, il me donnait une place auprès des autres, moi le timide, le pas bon en sport. C’est inconscient mais j’ai gardé ce mécanisme : pendant longtemps, je n’ai fait que de la BD d’humour.
C’est donc à l’école que vous avez commencé à dessiner ?
Non, à la maison, je recopiais déjà mes « Astérix », mes « Blueberry », mes « Tintin ». J’avais gravé la cavalerie des « Tuniques bleues » sur le bois du lit des mes parents avec la pointe d’une ceinture. Je me suis fait engueuler, mon père a scié la partie vandalisée.
A l’école, je me suis rendu compte que mon crayon me donnait le pouvoir de désamorcer la violence. Quand j’avais 9 ans, deux copains avaient annoncé qu’ils allaient se taper à la récré. Je les ai dessinés sur un ring, ils ont rigolé, ils ne se sont pas battus.
Je dessinais sur mes cahiers et sur les pupitres. Le grand jeu, avec mon voisin, c’était de gribouiller des trucs obscènes sur le bureau et de les transformer en quelque chose d’acceptable en trois traits de crayon, au dernier moment. Le sexe devenait un éléphant.
Je dessinais aussi de petits journaux que je reliais et que je faisais circuler dans la classe. Vers 11-12 ans, j’ai créé le journal Zep, en hommage au groupe de rock Led Zeppelin. Les copains ont fini par m’appeler comme ça.
Vous n’étiez pas franchement passionné par les cours, donc ?
J’avais envie que ça passe. C’était interminable ! Je n’étais pas mauvais élève (sauf en gym), je donnais le change pour qu’on me laisse tranquille. J’étais fou de BD, de Spirou, Pif, Pilote, je savais que je voulais faire ça quand je serais grand. Mais on ne me prenait pas au sérieux.
A l’époque, c’était un métier invisible, les auteurs de BD n’étaient pas médiatisés. Mes parents voyaient ça comme une lubie enfantine. Je serais prof de dessin, j’aurais un vrai métier. Ils n’avaient pas une image vraiment top des artistes. J’ai appris plus tard que mon grand-père paternel, qui était peintre, était alcoolique et avait abandonné sa famille.
Et puis la BD avait assez mauvaise presse. De la sous-littérature… Au primaire, on avait dit à mes parents qu’il était inquiétant pour mon développement que je ne lise que des BD. Achille Talon m’a sauvé. J’ai eu le premier prix de français de la région grâce à la richesse de son langage. J’écrivais des compositions incroyables !
Titeuf, Manu, Nadia… Vos personnages, ce sont les copains de classe qui vous les ont inspirés ?
Mon meilleur copain, c’était bien Manu, mais il n’avait pas cette tête-là. Alors que Nadia, oui, tout à fait, et tous les gars étaient vraiment amoureux d’elle ! Les premières histoires de Titeuf sont comme un journal intime. Avec ma classe, mes copains, ma cité…
Titeuf, c’est moi avec un crâne d’œuf et une mèche – parce que je trouvais les cheveux trop longs à dessiner. Moi en plus téméraire, aussi. Je lui fais faire ce qu’à son âge je me contentais d’imaginer. J’avais cette envie de mettre à l’épreuve la parole des adultes. Je faisais tout un tas d’expériences pour tester sa véracité.
Vous avez grandi dans une cité en banlieue de Genève...
Avec mon père, qui était policier, ma mère, qui était couturière, nous vivions dans des « immeubles de corporations » des années 1960 où une moitié des locataires étaient chauffeurs de bus, l’autre moitié des policiers. A l’école, je ne pouvais pas dire « Si tu m’embêtes mon père vient t’arrêter » parce qu’on me répondait « Mon père t’empêchera de monter dans son bus… »
Et dès 14 ans, vous bifurquez vers les Arts décoratifs…
J’y ai passé quatre années que j’ai aimées, qui ont ouvert mon regard. L’histoire de l’art ne commençait pas en 1958 avec Franquin ! C’est à cette époque que j’ai commencé à publier une première BD (Victor) dans un hebdo (La Femme d’aujourd’hui), qui supprimait sa page tricot.
En sortant de l’école, j’ai envoyé des projets de BD à autant de magazines spécialisés que je pouvais payer de photocopies couleurs. Ils ne m’ont pas répondu, ou alors une lettre type.
J’ai dessiné des affiches de spectacles, des sets de table pour les restaurants (contre quelques repas). Et même l’indice Nikkei pour la rubrique économie d’un journal suisse ! La rédaction était à 60 kilomètres de chez moi, il n’y avait pas Internet, il fallait se débrouiller. Un jour on m’a commandé un dessin sur la chute de l’indice Nikkei. Aucune idée de ce que c’était. J’ai dessiné un samouraï qui se transperçait la poitrine avec une courbe de graphique…
J’ai tout de même été publié chez un éditeur suisse. Notamment une BD sur la votation pour l’abolition de l’armée que je tournais en ridicule. Cela ne se vendait pas. Je publiais dans des fanzines, on me prenait un strip par-ci par-là. A 23 ans, j’étais encore chez mes parents, qui étaient un peu inquiets, je gagnais l’équivalent de 500 euros par mois. J’ai failli arrêter la BD.
Vous êtes sauvé par « Titeuf », en 1992. Comment apparaît-il ?
Il est né le jour où j’ai retrouvé mon enfance. Mon atelier était au premier étage, il surplombait une cour d’école. A l’heure de la récré, il y avait tellement de bruit que je ne pouvais plus me concentrer.
Un jour, je me suis mis à observer et écouter les gamins qui se bagarraient, qui inventaient des mots, et toute mon enfance est revenue. La peur, l’odeur des couloirs avec le produit de nettoyage du concierge, les cours où j’avais tellement envie de dormir que je devais empêcher ma tête de tomber sur le pupitre… C’était comme une révélation, une vision, je me suis dit qu’il fallait que je note vite avant que la « porte » ne se referme. En trois heures, j’avais cinq pages de story-board de « Titeuf ». C’était jubilatoire, je ne réfléchissais pas, j’étais en écriture quasi automatique.
Je l’ai fait pour moi, avec le sentiment de boucler la boucle : j’arrêterais la BD après le journal qui racontait cet âge où j’avais décidé d’en faire mon métier. Mais je me suis relu, et rendu compte qu’il y avait une authenticité, que c’était plus habité, plus libre parce que ce n’était pas fait dans l’idée de plaire.
C’était le journal de mon enfance mais pas sur le mode de la BD enfantine, des « Boule et Bill » ou « Spirou », espiègles mais gentils. Dans l’enfance, des choses très violentes se jouent, il y a de la cruauté. Moi-même j’ai été victime et bourreau.
Et cette fois-ci, les éditeurs accrochent ?
Non, au départ, cela paraît juste dans un fanzine de copains sous le titre « Souvenirs de mômes ». Mais un jour, Jean-Claude Camano, des éditions Glénat, m’appelle pour me dire qu’il a envie de me publier. Moi je suis persuadé qu’on me fait une farce. Je dis « Très drôle », et je raccroche. Heureusement il rappelle, il croit qu’on a été coupés. Je suis tellement persuadé que ce sera « non » au final que j’hésite à faire le voyage à Paris. Il faut payer le train et l’hôtel...
« Titeuf » a immédiatement trouvé son public, les ventes doublant à chaque album, au point de devenir un phénomène d’édition (23 millions d’exemplaires vendus) et d’améliorer grandement vos finances…
J’avais envie de succès, mais je n’avais jamais imaginé que le succès en BD pouvait faire gagner beaucoup d’argent. Il m’a fallu du temps pour choisir ce que je voulais sur la carte du restaurant, ou acheter un disque sans passer trois fois devant la boutique… Mais franchement, c’est beaucoup moins difficile que d’apprendre à être pauvre. Ce qui a changé, grâce à Titeuf, c’est que j’habite une maison du XVIIIe siècle dans la ville de Genève, dans laquelle Rousseau a séjourné.
Quelles sont vos idoles, en BD ?
Franquin, Morris, Uderzo. Et Gotlib, qui garde un côté très punk. On se fait des blagues par Internet, on s’envoie des dessins crétins. J’admire la façon dont Uderzo dessine la nourriture, ces banquets où l’on a envie de manger du sanglier. Il est aussi très fort pour le jeu des personnages. Comme Franquin qui, selon moi, a inventé ce métier. Gaston qui court dans les feuilles mortes… En une image, on comprend tout son côté régressif.
Vous publiez aussi des BD réalistes, comme « Une histoire d’hommes » ou « Un bruit étrange et beau ». N’est-ce pas acrobatique de passer du monde de Titeuf à celui des adultes ?
J’adore jongler entre les deux, l’un nourrit l’autre. Titeuf, c’est mon lien à l’enfance. Parfois, je suis un peu lassé de dessiner sa classe, les pupitres. Mais j’arrête deux jours, puis je suis content de le retrouver. Si je me mets à le dessiner, ça vient. Je suis le premier surpris que ça dure aussi longtemps. Peut-être que la « porte » ne se refermera pas ? Si elle se referme, cela laissera plus de place au reste. Il y a des histoires que je ne peux pas raconter avec Titeuf.
Le sexe est très présent dans votre œuvre. Vous avez même écrit le scénario d’une BD érotique dessinée par Vince, « Esmera » (éditions Glénat, 2015)...
Le sexe, c’est le terrain de jeu des adultes. Je suis désespéré de voir qu’il est laissé à la pornographie, toujours mis en scène de la même manière, pas très érotique. Et que le cinéma s’en empare aussi peu.
Dans les années 1970, il y avait du sexe décomplexé même dans les films familiaux. Il n’était pas relégué aux émissions sur la santé. J’ai grandi avec cette idée que le sexe serait une fête, et j’ai eu 16 ans au moment du sida. Le sexe devenait dangereux, mortifère. Il y a une idée de paradis perdu… J’ai envie d’en refaire quelque chose de joyeux.
L’album qui vient de paraître a pour personnage principal un moine. Dieu aussi, vous voulez le rendre joyeux ?
J’ai suivi deux années de cours de théologie comme auditeur libre, à une époque où j’espérais peut être que Dieu fasse tomber du ciel un éditeur. C’était les années 1980, les années yuppies, je ne m’y retrouvais pas.
Plus tard, j’ai effectué des retraites dans un monastère pour décompresser après un livre, faire le vide, le silence. Je ne suis pas bon en méditation, les pensées se déchaînent quand elles ont la place. Mais ces expériences m’ont marqué. J’ai la chance d’être libre, mais pas autant que William, le moine de l’album. Je dois communiquer.
Dans « What a wonderful world ! », le blog que vous tenez sur Lemonde.fr, vous avez dessiné la mort de Titeuf poussé à l’exil par la guerre. Vous vous sentiez le devoir de sensibiliser au sort des migrants ?
Il y a eu énormément de réactions. Certains lecteurs m’ont dit qu’ils avaient pleuré, d’autres qu’ils avaient utilisé le strip avec leurs élèves. C’est assez paradoxal, car ce sont les mêmes personnes qui sont impassibles devant un flash info (moi compris). La BD a un pouvoir d’identification, donc on se fait tuer en tant que personnage. Cela a restauré un petit bout d’humanité qu’on a tendance à perdre.
En Suisse, on « bouffe » la période électorale française. On entend des discours affolants. Ça me rend triste. Le titre de mon blog, What a wonderful world ! (Quel monde merveilleux !), n’est pas ironique. Je vois des signes d’espoir chez les jeunes. Alors qu’ils ont été élevés dans le consumérisme le plus sauvage, ils sont nombreux à s’engager, à chercher des solutions pour ne pas bousiller l’environnement.
Dans la nature humaine, il y a un truc intrinsèque de l’ordre de la fraternité. On n’a pas d’autre choix que d’être liés. Il est tout de même inquiétant de se dire qu’on est la première espèce animale qui a réuni tous les moyens pour détruire son habitat.
« Un bruit étrange et beau » (éditions Rue de Sèvres, 84 pages, 19 €) est sorti le 5 octobre.
Retrouvez tous les entretiens de la Matinale ici