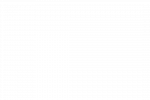Statistiques ethniques : soyons réalistes !

Statistiques ethniques : soyons réalistes !
Editorial. L’occultation ou le déni sont les plus mauvaises manières de comprendre et d’agir. Une mesure précise de la diversité permettrait de mieux appréhender les mécanismes de discrimination qui minent la société française.
Editorial du « Monde ». L’enquête du Monde et celle, très approfondie, sur les Prisons de France (Robert Laffont, 684 pages, 23,50 euros) que vient de publier le sociologue Farhad Khosrokhavar, dont nous avons longuement rendu compte dans notre édition du 21 octobre, repose sans détour la question des statistiques ethniques. « C’est une schizophrénie bien française : on vous interdit de faire des statistiques, mais quand on avance prudemment une approximation entourée de tous les conditionnels », en l’occurrence sur le pourcentage de détenus issus de l’immigration ou de détenus de confession musulmane, « on vous affirme que vous avez tort », affirme le sociologue.
De fait, le sujet déclenche instantanément des polémiques incandescentes. On l’avait notamment constaté en 2007 lorsque le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait voulu légaliser les statistiques ethniques. La bataille entre partisans et adversaires d’une telle possibilité de mesurer la diversité des origines des personnes avait partagé la communauté scientifique autant que la classe politique. Les uns jugeaient ces statistiques indispensables pour mieux comprendre les mécanismes de l’intégration ou de la discrimation. Les autres protestaient contre la mise en cause d’un principe républicain fondamental. Le Conseil constitutionnel avait donné raison aux seconds, en rappelant que la République française « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Des études fouillées sont menées depuis belle lurette
D’ailleurs, la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés interdit la collecte et le traitement de « données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ». Elle prévoit, certes, des dérogations pour des chercheurs ou des instituts de sondages qui souhaitent introduire des critères ethniques ou religieux dans leurs enquêtes ; mais ces autorisations sont délivrées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés au cas par cas, en fonction de la finalité de l’étude, de l’institution qui la réalise, de l’accord des personnes sondées et de l’assurance que les données restent anonymes.
Ainsi, les grandes enquêtes de l’Insee ou de l’INED (Institut national d’études démographiques) comportent, depuis une quinzaine d’années, le pays de naissance des parents, outil précieux pour mesurer la situation des enfants d’immigrés. De même, des études fouillées sont menées depuis belle lurette sur les populations scolaires pour mieux comprendre la trajectoire et la performance des élèves en fonction de leur milieu d’origine.
Faut-il aller plus loin ? Faciliter, voire généraliser de telles enquêtes ? Il nous semble que oui. L’exemple des prisons le démontre : l’absence de données précises sur l’origine ou la religion des détenus favorise les approximations, les fantasmes et, au bout du compte, l’instrumentalisation politique de la réalité. L’occultation ou le déni sont les plus mauvaises manières de comprendre et d’agir. Au-delà de « statistiques ethniques » trop étroitement corrélées à l’origine de la personne, une mesure précise de la diversité et de son caractère multidimensionnel (familial, social, géographique…) permettrait de mieux appréhender les mécanismes de discrimination qui minent la société française. Et d’évaluer l’écart qui sépare l’idéal républicain de sa réalité. C’est une question de lucidité, autant que de réalisme.