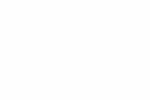La France met un terme à « Sangaris » dans une Centrafrique toujours en crise

La France met un terme à « Sangaris » dans une Centrafrique toujours en crise
Par Cyril Bensimon
Le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian est attendu dimanche à Bangui pour clore l’opération de l’armée française sous mandat de l’ONU lancée en 2013.
Lorsqu’une nouvelle fois son avion s’approchera de l’aéroport de Bangui-M’Poko, Jean-Yves Le Drian ne pourra pas ne pas apercevoir depuis les cieux les centaines de tentes qui bordent encore la piste d’atterrissage. Comme un symbole d’une République centrafricaine (RCA) toujours en proie à des flambées de violence, près de 25 000 personnes demeurent réfugiées dans ce camp de misère avec l’espoir d’y bénéficier d’une protection des forces internationales et de l’assistance des humanitaires.
L’opération « Sangaris » avait été lancée sous mandat de l’ONU en décembre 2013 dans une Centrafrique en pleine guerre civile opposant les combattants de l’ex-Séléka, qui avaient arraché le pouvoir en mars au président Bozizé, aux miliciens anti-balaka. Elle s’achève trois ans plus tard sans que le pays n’ait retrouvé la paix. Devant l’Assemblée nationale, le ministre de la défense avait pourtant estimé, le 19 octobre, que « cette opération a été un succès ». « Nous avons évité des massacres de masse (…), permis un processus de réconciliation intercommunautaire, la reconstitution de l’Etat centrafricain, une élection présidentielle, des législatives », déclarait-il lors d’un débat sur les opérations extérieures de la France. Pour nuancer son propos, M. Le Drian concédait que ce départ intervient « même si la stabilité n’est pas totalement revenue ».
Vent de colère contre les casques bleus
« Sangaris » a vécu, mais les soldats de l’ex-puissance coloniale, dont les effectifs ont été portés à 2 500 hommes au plus fort de la crise, garderont un pied en RCA. Que ce soit au sein de la Mission de stabilisation des Nations unies (Minusca), où des drones fournis par Paris doivent venir appuyer la force onusienne en matière de renseignement, ou bien en tant que formateurs d’une nouvelle armée centrafricaine. Les avions de chasse déployés au Tchad voisin sont également susceptibles d’être mobilisés, comme ils l’ont déjà été, pour frapper les groupes armés toujours actifs sur ce territoire aussi vaste que la France et la Belgique réunies.
Cependant, la clôture de l’opération militaire française, dont le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, avait défendu au moment de son lancement le principe en invoquant un « risque de génocide », intervient alors que la Centrafrique connaît un grave regain de tensions et que la réconciliation reste dans les limbes. Depuis la mi-septembre, une centaine de personnes a trouvé la mort dans des violences que les casques bleus ne parviennent pas à endiguer. « Il y a un problème avec certains contingents qui, lorsque le commandement unifié [de la Minsusca] leur demande d’intervenir sur le terrain, appellent aussitôt leur pays pour savoir ce qu’ils doivent faire », rapporte un observateur sur place.
A Kaga Bandoro, la tentative de vol d’un groupe électrogène d’une radio locale par une bande de miliciens de l’ex-Séléka a suffi à mettre le feu aux poudres. Après la mort d’un des leurs, les sicaires du général Al-Khatim ont lancé, le 12 octobre, des représailles meurtrières dans cette petite sous-préfecture du centre du pays contre un camp de déplacés, ciblant les représentants de l’Etat et pillant les ONG. Bilan : 45 morts et « des actes qui pourraient être qualifiés de crimes contre l’humanité », selon Parfait Onanga-Anyanga, le patron de la mission onusienne. Les soldats de la paix des Nations unies sont cette fois intervenus, tuant 12 assaillants selon la Minusca, mais leur incapacité à protéger les populations civiles a suscité un vent de colère à Bangui, capitale toujours prête à s’enflammer. Le 24 octobre, lancé à l’appel d’un « collectif de la société civile », une journée « ville morte » pour demander le départ des casques bleus s’est achevée par la mort de quatre personnes. La garde du chef de l’ONU sur place est accusée d’avoir ouvert le feu sur des manifestants mais plusieurs sources avancent que celle-ci a répondu à « des tirs de provocation » et que ce mouvement de mécontentement a été poussé par des personnalités politiques locales. Vingt jours plus tôt, l’assassinat d’un officier centrafricain dans le quartier du PK5, dernière enclave musulmane de la ville, avait entraîné des actes de vengeances contre des éleveurs peuls. Bilan : onze morts.
Derrière cette nouvelle vague de violences, une source haut placée au sein des Nations unies voit la main des anti-balaka. « Ce sont eux qui sont à l’attaque. Ils nous accusent d’être incapables de protéger les populations, mais c’est normal puisqu’ils allument le feu partout. Leur objectif est que nous fassions la guerre à leur place et que nous réduisions à néant la Séléka », accuse ce haut fonctionnaire international qui considère que le retour au pays de Jean-Francis Bozizé, le fils et ancien ministre de la défense de François Bozizé, n’est pas étranger à ces tensions. « Une bonne partie des anti-balaka est constituée de soldats fidèles à Bozizé. Le retour de son fils a certainement regonflé le moral des troupes qui se cherchent un leader politique », décrypte un homme d’affaires centrafricain. La date de la clôture de l’opération « Sangaris », annoncée depuis des mois, avait également été inscrite à l’agenda des deux parties toujours en conflit. « Les seuls qui font peur à nos hommes, ce sont les soldats français. Tout le monde attend leur départ pour repasser à l’action », prévenait il y a quelques mois un général de l’ex-Séléka.
Equation complexe
De fait, la Centrafrique demeure aujourd’hui coupée en deux. L’est du pays est sous la férule des ex-Séléka qui s’y sont repliés et continuent de brandir la menace d’une partition tant que la communauté musulmane ne sera pas mieux protégée et que leur place dans la future armée ou dans les institutions ne sera pas assurée. L’ouest du pays est lui principalement sous le contrôle des anti-balaka, mais ceux-ci sont régulièrement confrontés à des groupes de défense des Peuls, population transhumante qui a perdu dans le conflit l’essentiel de son bétail, sa principale richesse.
Dans ce contexte, l’autorité du président élu en début d’année, Faustin-Archange Touadéra, ne dépasse pas, au mieux, les barrières marquant la sortie de Bangui et ce ne sont pas ses maigres ressources – le budget du gouvernement avoisine les 350 millions d’euros, soit approximativement le même que celui de la ville du Havre – qui lui permettent de lancer de grands projets. Autant dire que la conférence des donateurs prévue le 17 novembre à Bruxelles est attendue avec impatience.
Reste que, sept mois après son investiture, le chef de cet Etat effondré semble toujours hésiter sur la conduite à tenir vis-à-vis des groupes armés. Il faut dire que l’équation à résoudre pour ce professeur de mathématiques est complexe. Deux options s’offrent à lui : négocier une paix sans justice qui offrira, comme par le passé, des postes à des chefs de guerre, ou lancer les hostilités contre ceux qui refusent de déposer les armes sans en avoir les moyens et alors que l’ONU n’est pas prête à s’engager dans un tel combat.