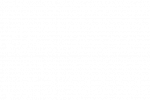Le Liban, une leçon de survie dans l’adversité

Le Liban, une leçon de survie dans l’adversité
Editorial. L’élection, lundi, de Michel Aoun à la tête du pays est une bonne nouvelle et il faut souhaiter, sans trop d’illusions, qu’elle marque un renouveau de la présence de l’Etat dans un pays qui en a besoin.
Une affiche représentant le nouveau président du Liban Michel Aoun, au nord de Beyrouth le 2 novembre. | JOSEPH EID / AFP
Editorial du « Monde ». Depuis deux ans, le Liban connaissait un vide institutionnel quasi total : pas de président, un gouvernement et un Parlement intérimaires. Il semble enfin sorti de cette longue parenthèse, qui a contribué à mettre le pays en faillite, avec l’élection par les députés, lundi 31 octobre, du général en retraite Michel Aoun à la tête de l’Etat. C’est une bonne nouvelle et il faut souhaiter, sans trop d’illusions, qu’elle marque un renouveau de la présence de l’Etat dans un pays qui en a besoin.
Les Libanais le méritent, à plus d’un titre. Ils sont à peine plus de 4 millions et, depuis le début de la tragédie syrienne, ils ont accueilli un million et demi de réfugiés venus de leur malheureux voisin. On n’ose imaginer pareille situation quelque part en Europe ! Les Libanais sont d’autant plus exemplaires que l’aide internationale est faible et que leur pays est divisé selon des lignes de fracture qui ressemblent à celles de la Syrie. Le risque est quotidien de voir le drame de la Syrie s’étendre en pays libanais.
Mais les Libanais « tiennent ». Plus exactement, la société civile libanaise « tient ». Comme si ses douze à quinze années de guerre civile à la fin du siècle dernier prémunissaient le Liban contre un retour de la violence et de la guerre. Sagesse admirable à ce jour et qu’on ne salue pas assez, tant elle est singulière dans le chaos moyen-oriental.
Un affaiblissement du camp sunnite
La désignation de M. Aoun, elle, est moins brillante. Elle est avant tout le reflet du rapport de forces régional dans l’affrontement en cours entre, d’un côté, un camp sunnite (la branche majoritaire de l’islam), regroupé derrière l’Arabie saoudite, et, de l’autre, un camp chiite (la branche minoritaire) piloté par la République islamique d’Iran. Le premier veut la défaite du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, et le second, son maintien au pouvoir.
Au Liban, régime parlementaire, la tradition veut que le président soit un chrétien maronite, le chef du gouvernement un musulman sunnite et le président de la Chambre des députés un chiite. Agé de 81 ans, Michel Aoun, ex-chef d’état-major, est à la tête du plus grand parti chrétien. Après avoir longtemps guerroyé contre la Syrie et ses alliés libanais, il a finalement pactisé avec eux, notamment avec ce mini-Etat dans l’Etat qu’est le parti chiite Hezbollah – à la fois formation politique libanaise et puissante milice, armée par l’Iran et déployée en Syrie au service de Bachar Al-Assad.
Sans l’appui du Hezbollah, M. Aoun n’aurait pas eu les voix requises. Il a aussi fallu le « revirement » du camp sunnite, jusque-là opposé à M. Aoun et qui, de guerre lasse, a accepté une forme de compromis : le premier ministre devrait être Saad Hariri. Ce geste traduit un certain affaiblissement du camp sunnite au Liban, qui voit son lointain protecteur, le royaume saoudien, délaisser quelque peu le théâtre libanais dans sa bataille avec l’Iran pour la prépondérance régionale. On ne s’y est pas trompé à Téhéran, où l’on a salué l’élection de M. Aoun comme une « victoire » pour les amis de la République islamique dans la région.
Pour les Libanais, la priorité, c’est la remise en route de l’appareil étatique, sa mobilisation au service d’une économie défaillante, bref un retour à une sorte de « normalité » gouvernementale. Le reste, on verra demain, comme on dit souvent à Beyrouth, dans un mélange de sagesse et de fatalisme qui est une leçon de survie dans l’adversité.