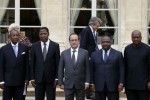Batailles d’influences pour la maîtrise de l’Union africaine

Batailles d’influences pour la maîtrise de l’Union africaine
Par Joan Tilouine
La Commission de l’institution panafricaine doit élire en janvier 2017 son nouveau président. Cinq prétendants se disputent le soutien des chefs d’Etat du continent.
C’est une élection parmi les plus importantes du continent africain que les cinq candidats en lice préparent sans tambour ni trompette. Fin janvier 2017, les chefs d’Etat africains éliront à Addis-Abeba (Ethiopie) l’homme ou la femme qui succédera à la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma à la présidence de la Commission de l’Union africaine (UA). Depuis plusieurs mois, cette élection, qui devait se tenir en juillet à Kigali et a été reportée, donne lieu à des négociations feutrées dans les palais présidentiels ou les coulisses de sommets internationaux. Elle se prête à des alliances inédites et à des ruptures tout aussi inattendues, à des déclarations enflammées et à des coups bas. Et pour cause : en jeu, la direction de l’organe le plus stratégique de l’organisation panafricaine.
L’offensive kényane
Cinq candidats se présentent : quatre ministres des affaires étrangères du Tchad, du Kenya, de Guinée équatoriale et du Botswana ainsi qu’un diplomate intellectuel sénégalais. Et en ce mois de novembre, la machine diplomatique kényane est mobilisée pour promouvoir la candidature de sa ministre des affaires étrangères, Amina Mohammed. Nairobi dit vouloir renoncer au poste de vice-président – qui lui revient depuis plusieurs années – et claironne avoir déjà recueilli les promesses de vote de vingt Etats d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. Pourtant, les quinze ministres des affaires étrangères de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) ont rappelé en octobre soutenir une autre candidate, la ministre des affaires étrangères du Botswana, Pelonomi Venson-Moitoi.
Avec empressement et enthousiasme, la communication du gouvernement kényan n’hésite pas à annoncer que même l’Algérie, le Nigeria et la Sierra Leone s’apprêteraient à voter pour Amina Mohamed. A Marrakech, en marge de la COP22, le chef d’Etat kényan Uhuru Kenyatta n’a cessé de vanter les qualités de sa ministre. Son vice-président, William Rutto, a, lui, reçu un accueil mitigé lors d’une récente tournée de campagne en Afrique occidentale et centrale, notamment au Tchad qui, contre toute attente, a son propre candidat.
La surprise tchadienne
Le 21 octobre, le ministre tchadien des affaires étrangères, Moussa Faki Mohamet, a en effet annoncé sa candidature. Au dernier moment, ce diplomate expérimenté est venu bouleverser l’équilibre de cette campagne et amoindrir les chances déjà faibles de son homologue équato-guinéen, Agapito Mba Mokuy, candidat issu de la même sphère géographique. L’Afrique centrale a désormais deux candidats, même si Malabo n’exclut pas un compromis de dernière minute avec N’Djamena.
Mais c’est en Afrique de l’Ouest que la candidature inopinée du chef de la diplomatie tchadienne a vraiment surpris. A commencer par le Sénégalais Abdoulaye Bathily qui pense pouvoir compter sur la majorité des chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest, à l’exclusion de la Gambie de Yayah Jammeh, hostile à Dakar. Intellectuel respecté, ancien ministre et représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique centrale, cette figure panafricaniste de gauche qui a ses entrées sur le continent avait cru sur parole le président tchadien Idriss Déby lorsque ce dernier l’avait assuré de son soutien. Par ailleurs, la Guinée, le Ghana et le Nigeria, trois poids lourds de la région, n’ont pas encore fait connaître leur choix.
La soudaine apparition du chef de la diplomatie tchadienne sur la liste des prétendants à la présidence de la Commission de l’UA laisse apparaître des germes de division en Afrique francophone. Ainsi, au Niger, le président Mahamadou Issoufou est confronté à un choix difficile : privilégier son ami de longue date, Abdoulaye Bathily, ou son allié, voisin et sauveur, le Tchadien Idriss Déby Itno qui avait accepté en juin de mobiliser près de 2 000 soldats pour combattre Boko Haram sur le sol nigérien.
Si le président tchadien a fini par présenter l’un de ses proches à la dernière minute, c’est, selon plusieurs sources, sur pression d’une puissance africaine redoutée dans le Sahel : l’Algérie.
L’Algérie et le Maroc s’affrontent indirectement
Pour Alger, la candidature d’Abdoulaye Bathily, adoubé par le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, est perçue comme un montage et un cheval de Troie du Maroc. Rabat est déterminé à reprendre sa place au sein de l’organisation panafricaine qu’elle avait quittée en 1984 après l’admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).
Sensible au rôle de l’Algérie dans les luttes pour les indépendances qu’il a accompagnées, Abdoulaye Bathily pâtit des positions maladroites de son chef d’Etat. Macky Sall a plaidé, lors du 27e sommet de l’UA à Kigali, en juillet, en faveur d’une exclusion de la RASD et a cornaqué le groupe de 28 Etats ayant signé une motion pour « réclamer la suspension des activités de la RASD » au sein de l’organisation. Aucun pays francophone de la zone Sahel n’a pris le risque de soutenir cette initiative qui reviendrait à trahir l’Algérie, dont les diplomates dirigent depuis sa création le Conseil de paix et de sécurité de l’UA. Des émissaires algériens se sont discrètement rendus à Abuja, au Nigeria, en octobre, pour tenter de dissuader le président Muhammadu Buhari de convoiter le poste de commissaire à la paix et à la sécurité. En vain.
C’est l’autre élection cruciale du 28e sommet de l’UA, prévu fin janvier 2017 à Addis-Abeba. « Il faut comprendre qu’on est pris à la gorge par les Algériens dont les services peuvent déstabiliser le septentrion de nos pays », confie un diplomate sahélien. En marge du sommet de l’UA sur la sécurité maritime qui s’est tenu en octobre à Lomé (Togo), le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait du mal à contenir sa colère lors d’un entretien sur la situation du nord de son pays avec le premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, et le ministre des affaires étrangères, Ramtane Lamamra, diplomate parmi les meilleurs d’Afrique, un temps pressenti pour briguer la présidence de la Commission de l’UA. Les rencontres de l’ombre se sont multipliées : les Algériens ont échangé avec Macky Sall et Abdoulaye Bathily pendant qu’Idriss Déby Itno présentait Moussa Faki Mohamet à ses homologues de Guinée, du Congo ou du Kenya.
« L’UA tiraillée entre pragmatisme et idéologie »
Le roi Mohammed VI, lui, n’a cessé de donner des gages de son africanité ces derniers mois. Il a consacré la moitié de ses investissements directs à l’étranger au continent où il a récemment multiplié les tournées au sud du Sahara. Avec habileté, il s’est tourné vers l’Afrique de l’Est, où l’Algérie cherche aussi des soutiens pour son candidat tchadien. Le souverain chérifien s’est rapproché du président rwandais, Paul Kagame, chargé d’établir un plan de réforme de l’UA très attendu. Mohammed VI caresse l’idée de former avec M. Kagame un axe de « pragmatiques » capable de proposer une alternative au traditionnel axe « idéologique » porté notamment par Alger et Pretoria, les deux poids lourds de l’UA.
« Le panafricanisme institutionnel de l’UA doit aller au-delà du politique et du militaire »
Pour l’historien sénégalais Mamadou Diouf, directeur de l’Institut d’études africaines à l’université Columbia, à New York, l’Union africaine doit orienter sa réflexion et ses actions sur des questions économiques et sociétales.
Comment peut-on réenchanter l’UA, qui semble minée par les divisions et bien souvent incapable de faire entendre sa voix et sa différence ?
Mamadou Diouf L’UA est une institution de chefs d’Etat dont la fonction première a été de gérer des conflits et d’amener les Africains à penser un destin partagé, car leur histoire a été marquée par l’esclavage, le colonialisme, le racisme.
L’organisation reste dominée par des intérêts politiques au détriment parfois de l’efficacité. Il faut créer des institutions efficaces et décentralisées, réduire la taille du monstre. L’UA a fait des progrès. L’agenda 2063 le démontre et s’essaie à une prospective nécessaire. On est passé de la gestion de crise politique ou militaire à une réflexion beaucoup plus large.
Quel regard portez-vous sur la traduction politique d’une forme de panafricanisme que tente d’incarner l’UA ?
Aujourd’hui plus qu’hier, les Africains ne remettent plus leur sort entre les mains des chefs d’Etat. Ils agissent en dehors du cadre de l’Etat, modernisent les sociétés africaines et cela va entraîner des changements politiques.
Il me semble qu’on n’est plus dans un débat sur la démocratisation formelle, mais sur une réflexion plus profonde sur la transition de sociétés « traditionnelles » à des sociétés « modernes » qui, à l’image de leur jeunesse, sont dans le « temps-monde ». Il faut aujourd’hui construire et accompagner l’évolution de sociétés africaines ouvertes, capables d’être pluralistes et diverses.
Le panafricanisme institutionnel de l’UA doit aller au-delà des questions d’ordre politique et militaire. Il faut penser l’économie, donner une place à la culture, aux intellectuels, mais aussi aux Africains de la diaspora. Pourquoi ne pas créer une vraie « région africaine » qui représenterait cette diaspora lors des sommets de l’UA, comme cela fut envisagé en 2006 ? Ce qui s’inscrirait dans un retour au projet originel du panafricanisme.
Vu de Lagos, Addis-Abeba, Nairobi ou Kigali, l’interminable conflit entre les frères ennemis du Maghreb semble bien anecdotique au regard des priorités et des défis auxquels est confrontée l’UA : résolution des conflits, développement économique, questions de gouvernance et de démocratie, réforme des institutions et autofinancement, plus de 70 % du budget de l’UA provenant actuellement de donateurs étrangers.
« C’est inacceptable de bloquer ou de parasiter l’organisation sur cette question du Sahara occidental, regrette un fonctionnaire de l’UA. Ce ne sont d’ailleurs plus l’Algérie et l’Afrique du Sud qui règlent les problèmes en Afrique, mais des puissances moyennes. Les intérêts du continent doivent primer. » Les considérations idéologiques, longtemps dominantes, semblent avoir perdu du terrain.
« L’UA a toujours été tiraillée entre pragmatisme et idéologie, explique Mamadou Diouf, directeur de l’Institut d’études africaines à l’université Columbia, à New York. Les sociétés africaines sont jeunes et s’épanouissent malgré les violences. Les débats idéologiques autour du nationalisme, du socialisme, du libéralisme appartiennent aux générations passées. La nouvelle génération d’Africains ne se reconnaît plus dans un nationalisme exacerbé, mais s’inscrit dans une réflexion africaine à l’échelle globale. Il y a un nouveau langage, un nouveau discours, qui arrivent dans le désordre, sont façonnés par les sociétés africaines en mutation, en transition. »
Le 28e sommet de l’UA qui se tiendra à Addis-Abeba sera crucial et pourrait marquer un tournant. Pas seulement pour cette élection du président de la Commission de l’UA qui donne lieu à une âpre bataille d’influence sur fond de retour du Maroc dans la « famille africaine ». Il y a fort à parier que les chefs d’Etat s’accorderont, comme par le passé, sur un candidat qu’ils pourront maîtriser, dompter ou, au besoin, écraser. Le prochain élu devra redoubler d’efforts pour se faire entendre, pour contribuer à relever les défis du continent et pour reconnecter une organisation technocratique avec les attentes des peuples. L’Organisation de l’unité africaine, créée en 1963, devenue Union africaine en 2002, se débat pour se renouveler et entrer dans une nouvelle ère en 2017.