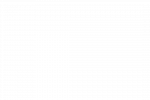La langue française en recul à Madagascar

La langue française en recul à Madagascar
Par Adrien Barbier (Antananarivo, envoyé spécial)
Madagascar accueille ce week-end le sommet de la francophonie, l’occasion d’explorer son rapport ambigu au français et au malgache.
Victor, 11 ans, vêtu de fripes déchirées, regarde fixement la feuille de papier sur laquelle deux mots sont écrits : « un chat ». Au bout de longues secondes, il murmure : « Acheter ? » Derrière lui, sa grande sœur a tenté en vain de le lui souffler. Ce jour d’octobre, il est venu s’inscrire en élémentaire à l’école publique du quartier de Mahamasina, proche du centre-ville d’Antananarivo. A la rentrée, Victor aura des cours de géographie et de « connaissances usuelles » en français. S’il ne maîtrise pas la langue de Molière, ce n’est pas bien grave : il y a de bonnes chances pour que son professeur soit dans le même cas.
Avec le malgache, le français est la deuxième langue officielle de Madagascar. C’est aussi la langue des affaires, de l’administration, de l’enseignement supérieur, et celle que l’on voit sur la plupart des panneaux de la capitale. Pourtant, seuls 20 % de la population la maîtrise. Un paradoxe que l’on retrouve dans le système éducatif qui est, sur la Grande Île, dans un état dramatique. D’après l’Unicef, 82 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, et un enfant sur quatre n’est pas scolarisé.
Bilinguisme de fortune
A quelques encablures de là, ça piaille et ça discute dans une salle de classe surchargée. Cette fois, ce sont les enseignants qui siègent sur les tables-bancs en bois, et chuchotent sous le nez du formateur. Ces « maîtres Fram », qui enseignent tous depuis cinq à dix ans, sont en cours de titularisation, et reçoivent pour la première fois une formation au métier de professeur.
Au total, Madagascar compte 85 000 de ces enseignants communautaires, qui représentent 80 % du corps professoral en primaire. Pour pallier le manque de professeurs, les parents d’élèves se sont constitués en association pour recruter des jeunes bacheliers et leur confier l’éducation de leurs enfants. Une conséquence directe des politiques « d’ajustements structurels » de la Banque mondiale qui, dans les années 1990, imposait aux pays pauvres comme Madagascar un gel du recrutement de fonctionnaires. Depuis 2014, le ministère de l’éducation les titularise par vagues successives, et leur offre une mise à niveau de six semaines.
Penchée sur le manuel, Marita Ratoandroarintsoa, 43 ans, lit la leçon, péniblement, dans un français plus qu’hésitant. Le formateur en didactique enchaîne quelques explications, puis passe au malgache pour répondre aux questions. Dans le flot de mots, on entend soudain : « Alouette, gentille alouette », qu’il entonne pour donner un exemple de comptine.
« On n’a pas assez l’habitude de parler français, explique timidement Marita à la fin du cours entourée de quelques collègues. Lorsqu’on le parle en classe, les élèves ne nous comprennent pas. » « Dans les livres, il y a pleins de mots que l’on ne connaît pas. Il faut alors consulter le dictionnaire ou demander à un collègue », renchérit Sema Randriamampiamima, également enseignant dans la capitale. Pour mener à bien leurs cours, le seul recours est un bilinguisme de fortune. Les explications se font en malgache, mais le résumé, les évaluations, et les manuels sont en français. Une barrière de plus qui s’ajoute à des conditions d’enseignement déjà difficiles : manque de matériel scolaire, salaires versés en retard, enfants dans le dénuement.
« Malgachisation »
De l’avis de tous, cette situation pour le moins cocasse, et qui constitue un frein manifeste au décollage économique de Madagascar, s’explique par des politiques linguistiques contradictoires menées depuis l’indépendance en 1960. En particulier, le traumatisme laissé par la période de « malgachisation », initiée dans les années 1970, est prégnant. Imposée par un mouvement de contestation estudiantin qui voulait détrôner la suprématie du français, celle-ci s’est, de manière unanime, soldée par un échec.
« La malgachisation en soi n’est pas mauvaise. Il n’y a pas de meilleur outil d’apprentissage pour l’enfant que sa langue première. Mais l’Etat n’avait pas les moyens de ses ambitions, ni les ressources humaines », argumente la socio-linguiste Vololona Randriamarotsimba, dans son bureau de l’Ecole normale supérieure (ENS). De manière hasardeuse et précipitée, des malgachisants ont été sollicités pour inventer tout le vocabulaire qui faisait défaut au malgache. « Mais il y avait plusieurs tendances en conflit, et des tensions entre la vingtaine de variantes régionales, ajoute t-elle. Pour l’instant, il n’existe pas encore de terminologie malgache officielle. »
Résultat, à l’école primaire, le français a été mis de côté, la qualité de l’enseignement public a chuté, une génération a été sacrifiée. Celle-là même qui se retrouve aujourd’hui à devoir donner cours en français sans le maîtriser. Les inégalités se sont creusées, alors que ceux qui en avaient les moyens mettaient leurs enfants dans le privé. « On a constaté une baisse du niveau général. La maîtrise du français est devenue un élément de stratification sociale », complète la socio-linguiste. Car, à l’Université, la langue de l’ancien colonisateur est restée l’unique langue d’enseignement. Le plafond de verre linguistique s’en est trouvé renforcé.
Complexe d’infériorité
Depuis, le pays a fait machine arrière. « Dans les années 1990, le gouvernement a eu la volonté de démocratiser le français. Mais, par prudence, l’élite politique n’a jamais voulu l’afficher clairement », détaille Vololona Randriamarotsimba, évoquant une « refrancisation implicite ».
La politique linguistique reste aujourd’hui une question épineuse, qui revient régulièrement à l’ordre du jour. « On a joué aux apprentis sorciers, et maintenant il n’y a plus de consensus ni de volonté politique », résume l’ancien ministre Gratien Horace.
De la malgachisation, le malgache garde un complexe d’infériorité, présenté comme une langue incomplète et incompatible avec les sciences. Un repli sur le malgache serait antithétique de la volonté, indispensable, d’ouvrir l’île au reste du monde. La question financière entre également en jeu : « Si l’on veut vraiment la langue malgache, il faut l’équiper avec des ouvrages, un lexique, former des enseignants, estime Amboaratiana Soa-Naivo, étudiant en linguistique française à l’ENS. C’est plus rapide et plus effectif de se focaliser sur le français, qu’on le veuille ou non. »