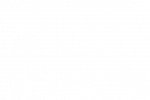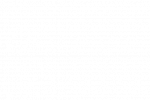Kad Merad : « J’ai tellement attendu le succès »

Kad Merad : « J’ai tellement attendu le succès »
Propos recueillis par Sandrine Blanchard
Le comédien est actuellement au Théâtre des Bouffes parisiens dans « Acting ». Du duo « Kad et Olivier » à la série « Baron noir », il revient sur un parcours fait de « coups de chance ».
Kad Merad pose à côté de son modèle en cire au musée Grévin à Paris le 21 mars. | KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Je ne serais pas arrivé là si…
… Si j’avais changé de nom. La première fois que j’ai réussi un casting, mon personnage s’appelait Ahmed Ben Mabrouk, un rôle très typé d’éducateur en MJC de banlieue dans la série « Tribunal », sur TF1. Sans doute était-ce parce que je m’appelais Kadour Merad. A la même période, je jouais dans une école de théâtre le rôle d’Alceste dans Le Misanthrope. Des producteurs étaient venus pour éventuellement me proposer de jouer François Ier jeune. Mais lorsqu’ils ont vu mon nom, ils ont tiqué et je n’ai pas été pris.
J’ai alors été tenté de changer de nom pour décrocher d’autres types de rôles. Pendant une journée, je me suis écrit des noms francisés : François Kadour, Gilbert Béguin (le nom de famille de ma mère), Jean Béguin. Je les testais en m’appelant devant un miroir. Mine de rien, même si vous ne souffrez pas de racisme, vous souffrez quand même d’un regard différent suivant votre nom. Je me disais : pourquoi me mettre cette barrière, pourquoi garder ce handicap en commençant ma carrière ?
Et finalement, vous y avez renoncé. Pourquoi ?
Lorsque mon père, Mohamed, est arrivé d’Algérie en France dans les années 1950, il s’est fait appeler Rémi. Je ne voulais pas recommencer la même chose. J’ai pensé à lui et je me suis dit tant pis, ce « frein » va être une force.
Pourquoi votre père a-t-il changé son prénom ?
Il me l’a raconté avec beaucoup d’émotion dans la voix. Il avait beau être Français d’Algérie, puisque à l’époque c’était l’Algérie française, il s’appelait Mohamed. Quand il a rencontré ma mère, Jeannine Béguin, une Berrichonne, il a voulu s’intégrer le plus possible, surtout ne pas faire de bruit. Donc il s’est appelé Rémi et tout le monde l’appelait Rémi. Il était chef d’équipe ; un mec qui s’appelait Mohamed ne pouvait pas, à l’époque, donner des ordres. Même s’il était aussi français qu’eux.
Tout est une question de nom, d’apparence. C’est le problème du monde, de ce qu’on vit aujourd’hui. Cela m’a toujours un peu hanté, alors que j’adore mon prénom. Si un jour je fais un film ou un spectacle sur mes parents, je l’appellerai : « Ma mère ce héros ». Parce que, dans les années 1960, elle a donné à tous ses enfants des prénoms algériens.
Pourquoi a-t-elle fait ce choix-là ?
Je ne l’ai jamais su. Elle souffre désormais de problèmes de mémoire et je ne peux pas avoir de conversation avec elle. C’est dommage, parce que c’est maintenant que j’aimerais savoir.
En 2012, vous avez prêté votre voix pour le documentaire « Guerre d’Algérie, la déchirure », à l’occasion du 50e anniversaire de la signature des accords d’Evian. Que représente ce pays pour vous ?
D’abord des souvenirs d’enfance. On y allait souvent en vacances l’été. On partait en voiture jusqu’au village de mon père. Je suis né en Algérie par hasard. Mes parents ont tenté de s’y installer, mais c’était trop tôt. Je n’y ai jamais vécu, je ne parle pas l’arabe, mais j’ai encore de la famille lointaine là-bas, que je revois de temps en temps. En Algérie, je ne suis pas un étranger. Une partie de moi est là-bas. Mon père est fier quand je parle de son pays. Cette mixité fait du bien.
La France, c’est ça. S’il fallait se débarrasser de tous les Français qui ont des origines étrangères, il ne resterait quasiment plus personne ! C’est dingue que certains critiquent encore aujourd’hui des prénoms d’origine étrangère et parlent des Gaulois. Où va-t-on ?
Quels sont vos souvenirs de jeunesse à Ris-Orangis ?
Des souvenirs extraordinaires ! J’y suis arrivé à l’âge de 8 ans avec mes deux passions : le rugby et la musique. A l’époque, c’était une mairie communiste, très portée sur la culture et la jeunesse. Il y avait toujours des animations pour les jeunes, une MJC, des camps d’ados. Nous étions tous mélangés, quels que soient les quartiers, et on se retrouvait autour d’un projet culturel. J’ai l’impression que tout cela est derrière nous. On a abandonné la banlieue. Franchement, avant, tout le monde s’y sentait bien. Un fossé s’est creusé. Quand j’y retourne, on ne sent plus la même joie de vivre qu’avant.
Vous dites souvent : « Je garde tout de l’enfant que j’étais. » On vous sent très nostalgique…
C’est vrai, je suis très nostalgique de mon enfance. Elle fut vraiment heureuse, malgré la sévérité et la dureté de mon père. A l’époque, nous n’avions pas grand-chose, peu d’argent, mais on ne manquait de rien. Mes parents se débrouillaient toujours pour nous offrir ce qu’on voulait. Comme la batterie que ma mère m’a achetée. J’ai gardé beaucoup de copains de cette époque. Nous étions une vraie bande de potes. La musique, l’envie de faire rire, tout est parti de l’adolescence. Je me revois encore dans ma chambre me filmer en train de faire des sketchs de Jerry Lewis.
Et un jour, Mme Rosas, votre professeure d’espagnol, vous a fait jouer du Garcia Lorca dans le réfectoire du collège…
Je suis en classe de 4e, c’est la première fois que je me retrouve sur scène. Mme Rosas adorait le théâtre et nous a proposé, dans son cours d’espagnol, de préparer une scène imposée que l’on jouerait devant les parents et les autres élèves du collège, avec des prix d’interprétation à la clé. J’ai fait rire la salle. J’entends encore dans tout le réfectoire les gens scander mon nom : « Ka-dour, Ka-dour! » J’ai obtenu le prix d’interprétation et à partir de là je me dis : je veux être sur scène.
Apparemment, vous aviez du mal avec l’école…
Pour faire plaisir à mes parents, j’essaie tant bien que mal de m’accrocher à une 2de littéraire. Mais je ne travaille pas, j’ai de très mauvais résultats. Je suis alors orienté en BEP. N’étant pas manuel, je choisis la vente. Je décroche un BEP et un CAP de commerce, mes parents sont très contents. Je commence alors à bosser, au BHV, puis en porte-à-porte pour vendre l’Encyclopædia Universalis. Mais j’abandonne très vite.
C’est la musique qui me fait sortir la tête de la banlieue. On avait monté un groupe avec les copains, et on s’est lancés dans les cafés. On est parti l’été à La Grande-Motte. On a eu du succès. J’ai arrêté les petits boulots, j’ai fait musicien et je suis parti au Club Med. J’avais toujours en tête d’être un acteur. Mais en attendant, la musique me permettait d’être sur scène et de faire rire les gens, même en étant à la batterie.
Comment intégrez-vous une école de théâtre ?
Au départ, j’ai tenté des cours « traditionnels » comme le cours Simon. Mais arrivé dans cet univers en venant de banlieue ça n’a pas marché, je n’étais pas à l’aise. Je voulais être acteur, mais de comédie. Mes idoles, c’était Louis de Funès, Pierre Mondy… Un jour, j’ai rencontré une fille dans le restaurant où je faisais de la musique et elle m’a conseillé le cours de Jacqueline Duc, dans les locaux du Café de la Gare, à Paris. Cette comédienne, sociétaire de la Comédie-Française, avait une énergie extraordinaire. Elle vous transmettait sa passion. J’étais son chouchou. Au bout de trois mois, elle m’a dit : « Je vais monter Le Misanthrope et je voudrais que tu sois Alceste. »
Vous avez eu des débuts difficiles…
Pendant des années, on fabriquait nos costumes, on placardait nos affiches, on a joué devant des salles quasi vides, dans des restaurants. Cette période était parfois terrible, il y avait du découragement mais c’est important d’avoir vécu cela.
Votre entrée à la radio Oüi FM, est-ce le fruit du hasard ?
C’est un coup de chance. Je ne serais pas arrivé là s’il n’y avait pas eu Oüi FM, où j’ai rencontré Olivier Baroux, mon futur complice de jeu. A l’époque, pour payer mes cours de théâtre, je travaillais dans une pizzeria située à côté de Oüi FM. Un jour, débarquent des responsables de la radio. J’écoute leur conversation, j’apprends qu’ils cherchent des animateurs. Je décide de me présenter. J’ai été pris pour mes qualités d’improvisation, m’a expliqué plus tard Bruno Delport, qui est devenu mon ami, puis mon associé avec Olivier. C’est lui qui nous a réunis.
Pourquoi vous êtes-vous si bien entendu avec Olivier Baroux, au point de monter le duo « Kad et Olivier » ?
Très bonne question… On est tellement différents et en même temps tellement proches… Je suis exubérant, je fais du bruit, lui est discret, tranquille. Il adore la déconne, mais un peu pointue, type Monty Python. Je suis davantage dans les clowns, de Funès, Jerry Lewis. Ce sont ces deux univers qui ont produit un choc. Je lui ai dit : « Faisons de la scène, je veux qu’on voie ma gueule. » Sans lui, je ne serais pas là. Et inversement. Notre duo a permis à chacun d’entre nous de réaliser ce qu’il voulait faire. Etre à deux nous a rendus plus forts. On a débuté ensemble en 1991. Aujourd’hui encore, on a toujours des projets en commun.
Comment avez-vous franchi la porte de la télévision ?
Grâce à Jean-Luc Delarue. Il avait entendu parler de nous. Olivier avait eu l’idée de faire du doublage de télé à la radio en direct et en impro. Delarue est venu nous voir et nous a proposé de travailler pour lui. A partir de là, on s’est retrouvés sur France Télévisions. Nous sommes passés de Oüi FM, où nous avions une liberté totale, à des directeurs artistiques de France Télévisions qui venaient toutes les deux secondes nous prévenir : « Ça, vous ne pouvez pas le dire. » Nous étions bridés, pas super-heureux, mais cela nous a permis de rencontrer des professionnels.
Et c’est grâce à la télévision que vous allez faire du cinéma…
C’est en tout cas grâce à la télévision que nous rencontrons Dominique Farrugia, qui nous emmène sur la chaîne Comédie ! On y retrouve la liberté qu’on avait perdue sur France Télévisions. C’est là que naissent tous les personnages, dont Pamela Rose. Dominique Farrugia nous suggère d’en faire un long-métrage, nous présente un producteur, et c’est parti, nous réalisons notre premier film.
Quasiment au même moment, je joue dans Les Choristes, qui vont devenir un phénomène de société ! Je me retrouve dans ce film parce que je connais le metteur en scène, Christophe Barratier. Sa copine de l’époque est amie avec ma femme, c’est tout con. Il me prend dans un court-métrage puis dans Les Choristes. Et c’est grâce à ce film que Philippe Lioret me remarque et m’engage pour son long-métrage Je vais bien, ne t’en fais pas. Ce ne sont que des coups de chance.
En quelques années, vous enchaînez Les Choristes, Je vais bien ne t’en fais pas, pour lequel vous décrochez le César du meilleur acteur dans un second rôle, puis Bienvenue chez les Ch’tis, Le Petit Nicolas, vous cumulez des millions d’entrées…
C’est une période dingue, dix années de folie. Mais j’ai tellement attendu cela… J’ai 40 ans quand je commence à bosser vraiment, à devenir tout à coup acteur de cinéma. Avant, j’étais comique, bouffon, chroniqueur, musicien. Quand Dany Boon me propose son film, il a déjà vu dix acteurs, qui ne pouvaient pas ou qui ont refusé. Pour moi, c’était le film qu’il me fallait, où j’allais pouvoir tout montrer : le comique, l’acteur, il y avait tout à jouer. Le succès de ce film est une folie. Même pour Dany Boon, être tout à coup le roi du box-office, devant La Grande Vadrouille… C’est trop. C’est très bien de faire des succès, mais après, les gens ont plus de mal à être indulgents avec vous.
Quel est le film qui vous fait devenir « acteur de cinéma » ?
Je vais bien, ne t’en fais pas, avec la récompense du César. C’est à ce moment-là que le regard du métier va se porter un peu plus sur moi. J’adore la comédie, mais un acteur comme James Stewart, dans La vie est belle, de Frank Capra, me fait pleurer. Ce film m’a retourné la tête. J’ai toujours considéré que je pouvais faire ces choses-là. Grâce à Philippe Lioret, les gens découvrent une autre facette de moi. Il s’est passé le même phénomène avec la série « Baron noir » où on s’est mis à parler de mon travail. Cela a mis du temps, car j’ai été très vite populaire. Mais j’adore alterner les comédies et les films sensibles. Je viens de terminer le tournage de La Mélodie, du jeune réalisateur Rachid Hami, dans lequel je joue un professeur de violon qui apprend la musique à des gamins de banlieue très difficiles. Ce film est formidable !
Est-il vrai que sur les tournages, on vous a souvent surnommé « Ça allait ? » ?
Je n’ai jamais été sûr de moi. C’est à vie. Je ne sais pas d’où ça vient. J’ai tellement de chance que j’ai toujours l’impression qu’on va me débusquer comme un imposteur. J’apprends en permanence. A plus de 50 ans, j’ai toujours le même enthousiasme. Et je suis moins dans l’angoisse. J’ai la vie que je voulais avoir, j’ai réalisé mon rêve d’enfant.
Bien que vous veniez du théâtre, vous en avez finalement très peu fait dans votre carrière…
Il n’y a pas eu beaucoup de propositions. Lors du tournage de « Baron noir », on s’est très bien entendus, avec Niels Arestrup. C’est un acteur qui vous élève. Un jour, je lui ai dit que j’aimerais jouer avec lui au théâtre. Il me répond : « J’ai une pièce depuis deux ans de Xavier Durringer, mais les partenaires qu’on me propose, je n’en veux pas. Lis-la, je te verrais bien dedans. » C’était Acting, la pièce que j’attendais.
« Acting », écrit et mis en scène par Xavier Durringer, au Théâtre des Bouffes parisiens, du mardi au samedi à 21 heures et le dimanche à 15 heures, jusqu’au 28 janvier 2017
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale du Monde ici