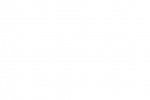Fidel Castro, flamme et cendres

Fidel Castro, flamme et cendres
Par Régis Debray (Écrivain et philosophe)
Familier, compagnon de route et interlocuteur du dirigeant cubain, l’écrivain Régis Debray revient, à l’heure des obsèques du chef révolutionnaire à La Havane, sur cette aventure qui l’a « marqué pour toujours ».
Par Régis Debray
Il est déjà trop tard pour faire sentir à une génération sans histoire, ni peut-être même sans la mémoire d’une histoire, ce que fut le vibrato d’un moment-fraternité évanoui. Il a, dans nos années 1960, arraché plus d’un enfant du siècle à son confort, en l’élevant, parfois, au-dessus de lui-même. De cette colère et de cet espoir, Fidel Castro fut le parrain, l’entraîneur, le blason. La République torturait en Algérie, des humiliés se soulevaient par milliers sur trois continents, et une tierce voie, entre capitalisme et communisme, luisait à l’horizon.
De cet élan venu des profondeurs, plus qu’un engouement, reste un sobriquet injuste et dédaigneux, le tiers-mondisme. Une certaine ingénuité d’âme, un zest de messianisme chrétien, la guerre d’Espagne encore dans les têtes et la volonté d’expier nos hontes nationales, Pétain et Guy Mollet… On en connaît la critique, bien courte. Qui se souvient aujourd’hui des dictatures militaires, des escadrons de la mort et de l’opération Condor activée par la CIA, des exactions d’un Empire sans scrupule aucun, dans son arrière-cour ? Aujourd’hui que l’économique et le médiatique, chiffrage et bruitage, deux illusions qui se prennent pour des réalités suprêmes, obnubilent le marché, non plus des convictions, mais des opinions… Et sans doute, comme Obama l’a dit à bon escient, est-il trop tôt encore pour savoir dans quelle niche l’histoire rangera demain cette figure insolite, Bolivar prolongé ou Mussolini tropical. Pile ou face. Et le choix final du stéréotype en dira encore plus sur l’historien et son moment que sur son condamné ou son héros. Etrange, incommode entre-deux.
Fidel étonnait et détonait
A chaque génération, sa sensibilité et sa géographie, et c’est peu dire qu’elles ne s’entendent plus. On soliloque de part et d’autre. Chacune a son sabir et ses simplismes. L’opposition « démocrate-dictateur », alpha et oméga de la culture politique d’une Europe désormais infantilisée par le manichéisme nord-américain, c’est une case par trop sommaire pour y loger les « hommes à cheval » issus d’une autre histoire que celle des hommes à chiffres. Si caudillo, c’était tyran, et commandante, icône, ni plus ni moins, les chefs d’Etat démocratiquement élus d’Amérique latine, gauche et droite confondues, du Colombien Santos au Brésilien Lula, ne seraient pas si nombreux à escorter l’urne funéraire.
Les souvenirs personnels ne valent pas pour des jugements d’historien, mais, pour avoir été une année durant, 1966, l’un de ses familiers et son interlocuteur jusqu’en 1989, le procès Ochoa, brouille et divorce, je ne peux me défendre d’un curieux sentiment : je ne reconnais pas la personne qui m’a permis de vivre des moments de grande intensité, dans le personnage caricaturé çà et là. Sans doute n’ai-je pas eu à connaître le chef d’Etat, mais seulement, insoucieux comme je l’étais de la situation intérieure, l’inlassable animateur des résistances nationales au-dehors. Ce Fidel-là était beaucoup plus attachant que Castro, et que l’idéologie qui s’attache à son nom. Et on pouvait, par moments, se demander s’il aimait vraiment le régime dont il était la tête.
Ouvert et curieux de tout, étonnamment cultivé, sans grandiloquence, pas Lider Maximo pour un sou, affectueux et parfois enfantin. Lançant le concours, en petit comité, au cours d’une randonnée dans la jungle, de qui tiendra le plus longtemps sans boire, et à l’arrivée, de qui remplirait le plus vite sa gourde à un suintement de source – ce n’était pas lui qui gagnait à chaque coup, je précise. Un souvenir des années 1970. Ce qu’il pouvait dire dans l’intimité de l’Union soviétique et des ses dirigeants, comme des régimes communistes de l’époque, lui aurait valu l’excommunication sans phrases du magistère marxiste-léniniste et les foudres de Granma, le journal unique de son île. Fidel étonnait et détonait. Les dissentiments politiques n’effaceront pas, en ce qui me concerne, ce sentiment tenace.
Bien sûr, le romantisme côtoyait le cynisme, Robin des bois, le prince de Machiavel, et la générosité, la cruauté. C’est la loi du genre. Nul ne règne innocemment et le pouvoir absolu corrompt absolument : ces aphorismes sont sans âge ni patrie. Ils n’empêchent pas certains clins d’œil chez les grands seigneurs de la profession, aussi contrastés soient-ils, par les mœurs ou l’idéal. C’est un club exclusif. Fidel en était, et les membres ont pris congé. A la Boisserie, dans le salon, trône aujourd’hui encore une boîte à cigares ouvragée bien en vue, un cadeau personnel de Fidel Castro au général de Gaulle. Et les Lettres à Anne nous apprennent à quel point François Mitterrand, en 1974, à La Havane, face à son hôte, sentit passer le grand souffle de l’Histoire. J’ai décrit ailleurs, dans Loués soient nos seigneurs, les hauts et les bas de l’aventure. Celle-là m’a marqué pour toujours. « Le monde d’hier », aurait murmuré, avec un sourire ému et, qui sait, un peut triste, Stefan Zweig, avant de tirer sa révérence.