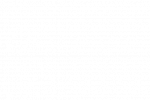« L’Afrique doit se regarder et regarder le monde avec ses propres lunettes »

« L’Afrique doit se regarder et regarder le monde avec ses propres lunettes »
Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux (contributrice Le Monde Afrique, Douala)
Le Codesria est un réseau qui rassemble des milliers de chercheurs africains en sciences sociales. Entretien avec Ebrima Sall, son secrétaire exécutif.
Créé en 1973, l’actuel Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria), basé à Dakar, rassemble environ 3 000 membres (des institutions de recherche, des universitaires, des intellectuels au sens large). Une ONG dont le budget atteint 10 millions de dollars (9,57 millions d’euros, financés essentiellement par les coopérations scandinaves, l’Etat sénégalais, l’ONU et des fondations américaines à l’instar de Canergie, Rockefeller, Mellon ou encore Open Society.
Son but est promouvoir une réflexion africaine en aidant à l’édition d’ouvrages et de revues, à leur diffusion (notamment en les traduisant et en les mettant en libre accès sur son site Internet), en rédigeant des recommandations et en organisant de nombreuses rencontres.
Cette structure, inspirée du Conseil latino-américain des sciences sociales (Clacso) fondé en 1967, a fait des émules, puisque le Conseil arabe des sciences sociales a vu le jour en 2013 à Beyrouth et qu’un conseil asiatique similaire devrait être lancé à la fin de ce mois de décembre. Rencontre avec Ebrima Sall, secrétaire exécutif du Codesria.
Quel est le rôle du Codesria ?
Ebrima Sall Le Codesria a été fondé pour créer une communauté scientifique panafricaine et lui permettre de travailler en toute autonomie. Le continent est sorti de la colonisation très fragmenté : des dizaines d’Etats indépendants, plusieurs langues de travail, des traditions administratives, politiques, intellectuelles très différentes. La communauté universitaire était traversée par cette fragmentation, sans oublier les frontières disciplinaires, de genre et de génération, ainsi que les barrières idéologiques. Dans ces conditions, difficile de construire des communautés scientifiques nationales viables ou une communauté panafricaine véritable ! Or, vu la taille réduite de certains pays, il fallait absolument sortir du cadre national pour produire des analyses pertinentes. Il fallait donc tout faire pour éviter que les frontières nationales, linguistiques et disciplinaires s’érigent en obstacles épistémologiques.
Pourquoi promouvoir une rupture avec l’Occident ?
Les savoirs qui doivent informer et guider les Africains, les décideurs publics comme la société civile, pour leur permettre de trouver des solutions aux problèmes de développement et participer à la résolution des problèmes mondiaux, doivent d’abord être principalement – mais pas exclusivement – des savoirs produits en Afrique, ou par des Africains du continent et de la diaspora. Pour une raison très simple : l’Afrique doit se regarder, et regarder le monde avec ses propres lunettes ! Et non utiliser celles des autres, sans être sûr qu’elles leur aillent. L’expertise étrangère doit venir en appoint à l’expertise africaine, et non l’inverse.
Lors des Ateliers de la pensée à Dakar fin octobre, il a beaucoup été question de la « décolonisation des savoirs ». Ce mot d’ordre date des années 1960 !
La transformation de la « bibliothèque coloniale » n’est pas achevée. L’« africanisation » des programmes a encore de grands pas à faire, malgré tous les discours sur la « renaissance africaine » et « l’afropolitanisme ». Mais, en fait, au-delà de la bibliothèque coloniale, c’est de la bibliothèque « impériale » qu’il faut parler, car l’ordre intellectuel mondial dominant est le reflet de l’ordre mondial dominant. Ce n’est pas un hasard si les meilleures universités, les revues les mieux cotées et les meilleurs cercles de réflexion se trouvent en Occident, là où sont définies les normes de ce classement. La transformation de l’ordre mondial dominant, dont le néolibéralisme est l’un des traits marquants, ne peut se faire véritablement sans la transformation de l’ordre intellectuel mondial. Il y a déjà plusieurs travaux intéressants qui vont dans ce sens, à l’instar de Theory from the South des anthropologues sud-africains John et Jean Comaroff et Epistemologies of the South de Boaventura de Sousa Santos.
Produire des savoirs africains, promouvoir une approche africaine dès lors qu’il s’agit de penser le continent… est-ce à dire que certains modèles et valeurs – comme la démocratie ou les droits de l’homme – ne sont pas universels ?
La science est universelle. Le savoir aussi. Le problème est que le savoir produit en Occident est de loin plus volumineux et plus influent que les savoirs produits ailleurs, notamment en Afrique et dans d’autres régions du Sud. Or la recherche menée dans le Sud apporte des éclairages nouveaux par rapport à ce que l’on savait sur de nombreuses questions, et ces éclairages font avancer la science universelle. Les Africains ont, au fil des siècles, accumulé beaucoup de connaissances sur les conditions sociales et écologiques qui prévalent dans les parties du monde où ils vivent. Il faut les promouvoir.
Quant au caractère universel de la démocratie et des droits humains, il n’est plus en dispute. La grande question, au fond, est celle de savoir si les sociétés peuvent encore marcher à leur propre rythme. Pour une partie des élites politiques, parler de « démocratie africaine » était une manière de se soustraire aux conditionnalités politiques liées à l’aide au développement, voire de perpétuer des régimes autoritaires. En dehors de ces cas-là, parler d’« approche africaine », c’est juste souligner le besoin de contextualiser les réalités. Après tout, nous voyons à quel point les populations africaines s’engagent dans les processus électoraux. Les jeunes de Y’en a marre (Sénégal), Balai citoyen (Burkina Faso) et Filimbi (en RDC), comme ceux d’Afrique du Nord, se battent pour la démocratie, exactement comme ils se battent pour l’emploi, des services publics fonctionnels et de meilleures conditions de vie.
N’est-il pas paradoxal de promouvoir une approche africaine et d’être financé par l’Occident ? Une réelle décolonisation ne passerait-elle pas par une indépendance financière ?
Je parlerais plutôt d’un besoin vital pour la recherche africaine d’avoir des financements africains substantiels afin de la rendre plus apte à s’inscrire dans un agenda africain. Pendant longtemps, les dirigeants africains ne portaient pas un grand intérêt à la recherche, ni dans leurs propres pays, ni au niveau régional. Or l’autonomie de la recherche et sa capacité à prendre en charge les questions qui intéressent les décideurs, les sociétés civiles et le secteur privé africains pourraient être limitées par la dépendance sur des financements extérieurs, tout simplement parce que ces financements s’inscrivent dans les politiques de coopération et les priorités des pays, fondations et organisations internationales qui les donnent.
Nombre de chercheurs africains sont aujourd’hui installés en Occident, notamment dans les universités américaines. Comment l’Afrique peut-elle tirer profit de cette situation ?
Aujourd’hui, on parle moins de « fuite » que de « circulation » des cerveaux. Les diasporas universitaires restent pour une bonne partie d’entre elles liées à leur université, leur pays et continent d’origine. Certains continuent à superviser des travaux doctoraux en Afrique, passent fréquemment du temps dans ses universités, et ce parfois même pendant leurs congés. Or cette diaspora a accès à des bibliothèques et à des ressources documentaires excellentes, et elle est « à jour » des travaux internationaux sur les questions qui la préoccupent. Elle peut donc beaucoup apporter aux universités africaines, où il y a actuellement un manque critique de personnel enseignant qualifié, notamment des professeurs capables de superviser des thèses de doctorat.
Faut-il nécessairement passer par l’Occident pour pouvoir mener une réflexion riche sur les sciences sociales en Afrique ?
Les conditions matérielles en Occident sont, il est vrai, nettement meilleures que celles qui prévalent dans la plupart des universités d’Afrique. Ceux qui travaillent en Occident ont également une plus grande visibilité, notamment grâce à l’accès facile aux médias internationaux, aux revues de renom et à des forums internationaux. Mais beaucoup de nos collègues qui se trouvent actuellement en Occident y sont allés précisément parce qu’ils étaient déjà de bons enseignants et chercheurs en Afrique. L’expérience du Codesria a montré que l’on peut être en Afrique, écrire et se faire publier par des maisons d’édition de renom. C’est ce qu’on a vu également avec la tenue des Ateliers de la pensée.
Certaines disciplines, comme l’archéologie ou la paléontologie, pâtissent d’un manque d’intérêt et de financement. Comment y remédier ?
La science n’a pas été épargnée par le néolibéralisme. Il y a une logique utilitariste, voire marchande qui joue fortement et a conduit la hiérarchisation des disciplines en fonction de la manière dont elles sont perçues. Les disciplines que vous citez sont en difficulté, mais d’autres disciplines, telle l’histoire, n’attirent plus d’étudiants dans nombre d’universités, et encore moins de ressources pour la recherche. Les gouvernements et les agences de financement doivent comprendre que leur absence constitue une grande limitation aux analyses que l’on peut faire.
Quelle place occupent les femmes chercheuses ? Alors qu’elles travaillent, on peine à les entendre et à accéder à leurs travaux…
Oui, de fait, elles dirigent des réseaux de recherche et des instituts ; elles publient et participent pleinement aux débats intellectuels, mais on n’atteint pas la parité hommes-femmes. La plupart des coordinateurs des groupes de travail et des réseaux sont des hommes. L’institut du Codesria sur le genre existe depuis 1994 et il a formé des centaines de femmes chercheuses. Mais cela ne suffit pas et il faut rendre plus visibles leurs travaux.
Le Codesria s’inscrit dans un projet panafricain. Que signifie être panafricain en 2016 ?
C’est reconnaître que l’Afrique est notre point d’ancrage dans le monde, que nous avons des expériences historiques similaires et que les Africains ont un destin commun. C’est se sentir partie prenante de la lutte que mènent les peuples de ce continent pour leur émancipation, leur dignité et leur bien-être individuel et collectif. C’est une question existentielle. Pour tous ceux qui ont choisi de faire de l’Afrique leur patrie et de faire de ce continent un acteur de plein droit dans le monde.