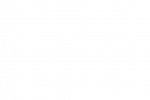Martin Schulz, l’un des principaux visages de l’Europe, quitte Strasbourg

Martin Schulz, l’un des principaux visages de l’Europe, quitte Strasbourg
Par Cécile Ducourtieux (Bruxelles, bureau européen)
Le président du Parlement européen, dont le remplaçant doit être élu mardi 17 janvier, a réussi, au cours de ses deux mandats, à transformer l’hémicycle en arène de la démocratie européenne.
Le président du Parlement européen, Martin Schulz, le 21 novembre 2016 à Strasbourg. | FREDERICK FLORIN / AFP
Mardi 17 janvier, l’heure aura sonné pour Martin Schulz de rendre son tablier de président du Parlement européen et de quitter « sa » maison, un hémicycle où il a commencé de siéger en 1994 et dont il connaît tous les recoins et tous les ressorts. A 61 ans, le social-démocrate allemand (SPD) a finalement décidé, en décembre 2016, après des mois de tergiversation, de ne pas briguer un troisième mandat et d’aller tenter sa chance en politique dans son pays natal.
Ministre des affaires étrangères, futur chef de file du SPD pour les élections législatives ? Les commentateurs lui prêtent déjà un grand avenir national. Et, de fait, cet ex-libraire, natif de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a acquis depuis Strasbourg une certaine envergure, en réussissant à faire exister médiatiquement le Parlement européen.
A l’origine d’une vraie révolution
Le traité de Lisbonne (2009) a certes doté le Parlement de Strasbourg de nouveaux pouvoirs législatifs, le transformant en « colégislateur » des textes européens avec le Conseil (représentant les Etats membres). Mais l’hémicycle n’a pas le pouvoir d’initiative des règlements et directives, qui est du ressort de la Commission de Bruxelles. Martin Schulz, excellent orateur, toujours très réactif et disponible, a su pallier ces faiblesses en transformant l’institution en arène de la démocratie européenne.
Le pape François, de nombreuses têtes couronnées, les discours croisés de François Hollande et d’Angela Merkel… Les plénières de Strasbourg ont su faire parler d’elles, malgré la crise financière – largement réglée par le Conseil européen, entre chefs d’Etat et de gouvernement – et malgré le manque de nouveaux textes législatifs à examiner au début du mandat de Jean-Claude Juncker à la Commission, en 2014. L’ex-premier ministre luxembourgeois avait en effet fait du « moins légiférer pour mieux légiférer » un des axes de sa présidence.
Martin Schulz est aussi à l’origine d’une vraie révolution institutionnelle : le concept du « spitzen candidat » (« candidat de pointe », ou chef de file), désigné par chaque famille politique européenne, qu’il a réussi à imposer en 2014 contre l’avis de la chancelière allemande, Angela Merkel. Le principe ? Le président de la Commission doit être choisi dans le camp du parti politique arrivé en tête aux élections européennes, ce qui lui confère une plus grande légitimité démocratique, et renforce les liens entre Commission et Parlement. L’élection de M. Juncker, en 2014, a résulté de ce processus.
Pourfendeur des europhobes
L’Allemand, parfaitement polyglotte, a toujours été au rendez-vous ces dernières années pour défendre une Union affaiblie et assaillie par les crises. Il invite Alexis Tsipras en juillet 2015, lui donnant l’occasion de plaider sa cause, alors que la tentation est grande chez certains Européens, en particulier en Allemagne, de bouter la Grèce hors de l’eurozone. A l’automne 2016, il tente un dernier effort diplomatique pour sauver le CETA, l’accord de libre-échange avec le Canada, contesté par la Wallonie, avant sa signature définitive avec Ottawa.
Inquiet des dysfonctionnements du « moteur franco-allemand », Martin Schulz joue également au « go-between » entre François Hollande et Angela Merkel, organisant des dîners en tête à tête entre les deux dirigeants pour les aider à briser la glace, à un moment où la chancelière reproche à la France son manque de soutien dans la crise des réfugiés.
Au Parlement, il est obsédé par la nécessité de neutraliser les eurosceptiques, entrés en force dans l’hémicycle après les élections européennes de mai 2014. Il multiplie les passes d’arme avec le Britannique Nigel Farage (UKIP), avec Marine Le Pen (FN), mais choisit d’inviter des dirigeants notoirement critiques à l’égard de Bruxelles. Une stratégie contestée en interne : les élus, conservateurs comme sociaux-démocrates, ont un souvenir très amer des prestations réussies de la première ministre polonaise, Beata Szydlo (début 2016), ou du premier ministre hongrois, Viktor Orban (printemps 2015), qui ont transformé l’hémicycle en tribune antieuropéenne.
Une proximité qui dérange
C’est parce qu’il veut faire barrage aux antieuropéens que Martin Schulz est un si chaud promoteur de la « grande coalition » entre conservateurs et sociaux-démocrates au Parlement. Mais, à force de négocier en amont toutes les prises de position importantes de l’hémicycle avec les conservateurs, il contribue à tuer le débat à Strasbourg, et à y priver les socialistes de marges de manœuvre.
Pas question d’attaquer frontalement M. Juncker après le scandale des LuxLeaks (évasion fiscale à grande échelle au Luxembourg), pas question de dénoncer l’accord de renvoi des réfugiés en Turquie souhaité par Mme Merkel, etc. Cette manière de mettre le couvercle sur toutes les discussions susceptibles de menacer Bruxelles, mais aussi de systématiquement « tirer la couverture médiatique » à lui, a fini par exaspérer jusque dans son camp socialiste.
Sa proximité avec Jean-Claude Juncker à la Commission a aussi fini par déranger. Les deux hommes se ressemblent de fait beaucoup : ils ont le même âge, le même attachement viscéral à l’Union et se côtoient depuis plus de vingt ans à Bruxelles. Tous deux sont de grands affectifs et travaillent parfaitement ensemble. M. Juncker a plaidé jusqu’au bout pour que son « ami » Martin reste à Strasbourg, en vain.
La succession de Martin Schulz sera difficile tant sa personnalité était forte, et tant les candidats déclarés pour le remplacer (Antonio Tajani pour les conservateurs, Gianni Pittella chez les sociaux-démocrates) font pâle figure à ses côtés. Seul Guy Verhofstadt pourrait prétendre reprendre la relève d’une présidence flamboyante, mais les chances du Belge, patron des libéraux du Parlement, sont jugées minces après sa tentative incompréhensible et ratée de rapprochement avec le Mouvement 5 étoiles italien.