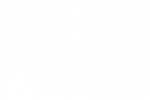Thierry Mandon : « Il faut augmenter le niveau de qualification des générations à venir »

Thierry Mandon : « Il faut augmenter le niveau de qualification des générations à venir »
Propos recueillis par Camille Stromboni, Adrien de Tricornot
La loi permettant la sélection des étudiants à l’entrée en master sera effective dès la rentrée prochaine. Entretien avec le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur, Thierry Mandon, qui a porté la réforme.
Arrivé il y a un an et demi à la tête du secrétariat d’Etat à l’enseignement supérieur, Thierry Mandon a dû s’atteler à une réforme que d’aucuns jugeaient explosive : celle de la sélection en master. Il revient sur les inquiétudes que suscite cette loi, et dresse les enjeux du marché du travail de demain pour ces diplômés bac + 5.
La loi qui instaure la sélection en master entre en vigueur en 2017. Pourquoi cette réforme ?
Nous avons voulu sécuriser la rentrée universitaire qui vient. Le droit rattrape des pratiques jusqu’ici clandestines qui existaient au milieu du master. Avec un principe de réalité : certains masters ont besoin d’être sélectifs, le nombre de candidats étant supérieur à celui des places disponibles. Mais cette réforme dépasse le simple rattrapage de pratiques illégales. Cette sélection s’accompagne désormais d’un droit à la poursuite d’études pour les titulaires d’une licence. Nous assurons ainsi à tous des parcours de qualité. Dans une vision à long terme, car, malgré les incertitudes qui pèsent sur le marché de l’emploi de demain, il est indispensable d’augmenter le niveau de qualification des générations à venir.
Les opposants à cette réforme pointent néanmoins le risque de voir émerger un système à deux vitesses, avec de bons masters sélectifs et d’autres déconsidérés, obligés d’accueillir des étudiants recalés…
Je ne suis pas inquiet d’un tel phénomène. C’est assez hypocrite d’ailleurs : les parcours sélectifs existent déjà en master, et cette dérive n’a pas été constatée. De nombreux masters ne sont pas sélectifs tout en étant de grande qualité avec des débouchés à la sortie. Ils n’ont parfois même pas assez de candidats, comme en mathématiques. Cela n’est donc aucunement lié. Mais il faut avant tout être vigilant sur les effets attendus : un suivi et une évaluation des conséquences concrètes de la loi sont prévus. Cela permettra de réaliser des ajustements, s’ils se révèlent nécessaires.
Toute barrière sélective supplémentaire peut avoir un effet négatif sur les publics les plus défavorisés. Cette réforme ne risque-t-elle pas de nuire à la démocratisation en master ?
N’oublions pas le droit à la poursuite d’études que nous créons ! Le nombre d’étudiants qui n’auront pas eu de place en master et feront un recours devant le recteur est aujourd’hui une grande inconnue. Mais, pour la première fois, nous allons voir combien de jeunes sont véritablement bloqués dans leur poursuite d’études, et y remédier. A l’heure actuelle, rien n’est régulé. Rappelons par ailleurs qu’il n’y a globalement pas de problème de places entre la licence et le master.
Quant à la question psychologique de l’autocensure, c’est me semble-t-il avant tout la longueur des études qui peut décourager les moins favorisés, plus que la sélection. Avec la mobilité géographique intervenant souvent au niveau du master, qui a un coût. Nous allons justement mettre en place une aide à la mobilité.
Reste qu’un étudiant qui s’arrêtera demain à l’entrée du master n’aura que très peu de chances de rebondir sur le marché du travail avec une licence générale, peu professionnalisante… Quid de la licence ?
Cette réforme du master aura forcément un impact sur l’offre de formations de licence. Et il est évident que le grand chantier à l’avenir, c’est celui de la licence. Elle est aujourd’hui le maillon le plus fragile de notre enseignement supérieur, avec un très fort échec en première année. Je vais profiter du temps qu’il me reste pour faire un tour de France des universités centré sur le premier cycle et l’innovation pédagogique, avec la volonté de valoriser les nombreuses initiatives mises en œuvre.
Les taux d’insertion à la sortie d’un master sont élevés, avec 85 % de diplômés en emploi à dix-huit mois du diplôme, 90 % à trente mois. Ces statistiques sont effectuées longtemps après la fin du cursus, et ces chiffres restent en deçà de ceux des grandes écoles. Les débouchés professionnels après un master sont-ils à la hauteur ?
Il est certain qu’à dix-huit mois c’est tard. Il faut repenser l’outil statistique pour avoir des données plus tôt, comme le font les grandes écoles. Mais les chiffres sont bons, il ne faut pas dévaloriser les résultats. Et par rapport aux grandes écoles, il faut faire attention à comparer ce qui est comparable : les masters d’ingénierie ou d’informatique insèrent tout aussi bien que les écoles d’ingénieurs !
Il n’empêche, il reste du chemin à parcourir aux universités. Une réelle distance existe encore avec le monde de l’entreprise, même si la situation a beaucoup évolué. L’ouverture des conseils d’administration des établissements aux personnalités de l’entreprise n’a pas suffi à y remédier.
Il faut une proximité physique, une imbrication des deux mondes sur un même lieu. C’est tout l’enjeu des campus de demain. Sans remettre en cause, bien sûr, l’indépendance des universitaires. Je n’ai pas eu le temps suffisant d’avancer véritablement sur le sujet mais des premières bases sont posées. Par exemple avec la nouvelle vague de quatre universités qui vont devenir propriétaires de leurs locaux, ce qui leur permettra d’avancer en ce sens.
Les universités ont-elles les moyens d’aller plus loin sur ce chantier de l’insertion professionnelle, alors que leurs budgets sont de plus en plus serrés face à un nombre d’étudiants qui ne cesse d’augmenter ?
L’enseignement supérieur français n’est pas en retard, au regard des derniers chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), mais il est évident que le temps du réinvestissement est venu. Il a été amorcé en 2017, avec une augmentation de 800 millions d’euros du budget de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’effort doit être poursuivi dans les prochaines années, à hauteur d’un milliard d’euros par an, sinon la mutation ne se fera pas. Et c’est l’avenir de la nation qui est en jeu.
L’université est confrontée à une très forte pression démographique [+ 30 000 étudiants par an], elle n’a pas les moyens d’investir autant qu’il le faudrait de manière générale, sur la transformation numérique, dans la formation continue ou encore pour son parc immobilier. La question immobilière constitue d’ailleurs un problème majeur : outre la vétusté de certains bâtiments, qui suppose un important effort d’entretien et de rénovation, ce sont aussi les nouvelles façons d’apprendre qui l’exigent.
Le chantier ne doit-il pas également porter sur l’insertion des docteurs ?
Nous n’avons pas encore obtenu de résultats tangibles suffisants dans l’insertion des docteurs. C’est une question fondamentale car ce sont les ambassadeurs de l’université dans le monde des entreprises. Mais un travail énorme a été accompli ces derniers mois. Avec des salons de recrutement, des actions auprès des entreprises pour valoriser les doctorants, la simplification des contrats de recherche privée… Cet ensemble de mesures devrait porter ses fruits.
Comment les formations universitaires peuvent-elles mieux s’adapter au marché du travail de demain ?
Les universités ont désormais la possibilité d’être bien plus réactives au marché du travail. Nous avons desserré le carcan réglementaire, elles peuvent maintenant développer des parcours de master pour répondre aux demandes des entreprises sans attendre plusieurs années, comme cela était nécessaire jusqu’ici avec l’habilitation des diplômes.
Mais je ne crois absolument pas à l’idée de tendre vers une adéquation totale entre l’offre de formation et le marché du travail, en essayant de caler très précisément les contenus pédagogiques sur les besoins des entreprises. Nous sommes dans un univers incertain, nous ne connaissons pas tous les métiers de demain.
Les entreprises elles-mêmes ne savent pas prévoir ce dont elles ont besoin ! En revanche, une université qui travaille étroitement avec les entreprises, avec des contacts quotidiens, c’est la meilleure manière d’avancer. Ce qui passe par cette présence sur un même campus mais aussi par le chantier de la formation continue. Les universités doivent devenir un acteur central en la matière.
Même après un master, le début de carrière est mal vécu par certains, avec un sentiment de déclassement. N’est-ce pas le signe d’un décalage ?
Ce sentiment peut s’expliquer par un discours schizophrénique. D’un côté, on insiste sur la nécessité d’augmenter le niveau de qualification des jeunes, de faire toujours plus d’études. Mais, d’autre part, certains valorisent sur le plan économique le moins-disant salarial et social, et la compétitivité par les coûts : aller plus vite, travailler plus, pour toujours moins cher. Nous serons toujours en retard sur le low cost vis-à-vis d’autres économies. Cela ne doit pas être notre positionnement.
Il faut un discours cohérent sur le plan économique. Nous devons viser la compétitivité par la qualité : améliorer la qualité des produits, des services et des emplois. C’est le positionnement d’innovation « à l’allemande » qui est le bon. Avec pour horizon une montée en gamme générale, grâce à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Un supplément et un salon du « Monde », pour tout savoir sur les masters, MS et MSc
Etudiants en licence ou d’ores et déjà diplômés bac + 5, retrouvez un supplément de 16 pages sur les masters de l’université, ainsi que sur les mastères spécialisés et masters of science proposés par les grandes écoles, dans Le Monde daté du 26 janvier, puis sur Le Monde.fr.
Suivra, samedi 28 janvier, le 13e Salon des masters et mastères spécialisés (SAMS) organisé par Le Monde, à la Cité de la mode et du design à Paris, permettant de découvrir plus de 4 000 programmes bac + 5 et de participer à des conférences organisées par nos journalistes (entrée libre, préinscription recommandée).