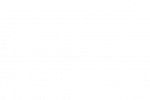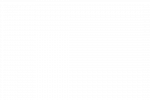L’Afrique veut-elle vraiment en finir avec la Cour pénale internationale ?

L’Afrique veut-elle vraiment en finir avec la Cour pénale internationale ?
Par Emeline Wuilbercq (contributrice Le Monde Afrique, Addis-Abeba)
L’Union africaine a adopté une « stratégie de retrait collectif » de la CPI lors du sommet d’Addis-Abeba. Une décision qui est loin de faire consensus.
Le divorce entre l’Union africaine (UA) et la Cour pénale internationale (CPI) est-il consommé ? Les chefs d’Etat et de gouvernement du continent ont adopté, à l’issue du 28e sommet de l’UA qui s’est déroulé à Addis-Abeba, en Ethiopie, les 30 et 31 janvier, une « stratégie de retrait collectif » de l’institution de La Haye, chargée de poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide.
Cette mesure est toutefois juridiquement non contraignante, et ne dépossède pas les Etats africains de leur souveraineté. Ils décideront individuellement d’une éventuelle démarche de retrait. Actuellement, parmi les 124 Etats parties de la CPI, 34 sont africains.
« Pas de retrait collectif »
Pour le juriste Désiré Assogbavi, spécialiste de l’Union africaine auprès de laquelle il représente Oxfam International, cette « stratégie de retrait collectif » est un abus de langage qui « n’existe pas en droit international ». D’ailleurs, l’UA, en tant qu’organisation, n’est pas membre de la CPI. « S’il n’y a pas eu d’adhésion collective, il n’y aura pas de retrait collectif », résume un diplomate.
Lors des discussions à huis clos, certains pays ont émis des réserves ou ont demandé davantage de temps pour étudier la stratégie, notamment le Liberia, la Tunisie, le Malawi, la Zambie et la Tanzanie. « Cette décision ne nous engage pas », aurait martelé le Sénégal, lors de la réunion du conseil exécutif en amont du sommet. Le Nigeria, le Cap-Vert et la Côte d’Ivoire font également partie des défenseurs de la CPI qui, tout en admettant ses écueils, considèrent qu’il vaut mieux « changer les choses de l’intérieur ».
Les pourfendeurs de l’institution, menés par l’Afrique du Sud, ont toutefois proposé une étude détaillée des procédures nationales de retrait individuel de la CPI, que le Monde Afrique a pu consulter. « Ils veulent faciliter le boulot des Etats membres de l’UA », ironise un diplomate nord-africain.
La décision d’élaborer une « feuille de route pour un retrait de la CPI » remonte au sommet de janvier 2016, à Addis-Abeba, et était portée par le président kényan Uhuru Kenyatta, qui avait lui-même été poursuivi pour « crimes contre l’humanité » avant que les charges ne soient abandonnées fin 2014. Son vice-président, William Ruto, était encore poursuivi au moment du sommet par la Cour. Mais, lors de la grand-messe de Kigali, au Rwanda, en juillet 2016, les ministres des affaires étrangères chargés de plancher sur le sujet ne s’étaient pas mis d’accord.
Alors pourquoi un « consensus » sur cette stratégie aujourd’hui ? C’est plus une « position de principe », souligne un observateur, qui rappelle que l’Acte constitutif de l’UA ne peut prendre le pas sur les Constitutions nationales. « L’UA utilise peut-être [cette stratégie] comme un instrument de pression politique pour catalyser des changements à la CPI », poursuit Désiré Assogbavi d’Oxfam International. Il s’agirait « plutôt d’un document qui indique les griefs et revendications de l’UA sur la CPI », temporise le juriste.
« Un instrument de l’Occident »
Depuis le premier mandat d’arrêt émis contre le président soudanais en exercice Omar Al-Bachir en 2009, la fronde des dirigeants africains contre la CPI ne cesse de prendre de l’ampleur. En 2016, trois pays ont annoncé qu’ils quittaient l’institution qui siège à La Haye : l’Afrique du Sud, pourtant longtemps considérée comme un pays allié, le Burundi, et la Gambie, avant que Yahya Jammeh n’essuie une défaite à l’élection présidentielle de décembre 2016 et ne quitte le pouvoir en janvier.
« L’Afrique se sent délaissée, pas entendue », déclarait la cheffe de la diplomatie kényane, Amina Mohamed, au Monde Afrique en janvier 2016. Les dirigeants du continent regrettent une justice internationale partiale, qui ne ciblerait que leurs homologues, et serait un « instrument de l’Occident ». Ils exigent la suspension des poursuites contre le chef de l’Etat soudanais – qui est toujours invité aux sommes de l’UA – mais leur requête reste pour l’instant lettre morte, ce que certains considèrent comme un « affront ». Ils réclament également l’immunité pour les présidents en exercice, prévue par le protocole de Malabo, qui vise à étendre la compétence de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme aux crimes d’envergure internationale.
La stratégie de l’UA vise d’ailleurs à renforcer cette Cour qui deviendrait une sorte de Cour pénale panafricaine. Mais celle-ci n’est pas encore mise en place, car le protocole n’a jusqu’à présent été ratifié que par neuf pays africains – et doit l’être par 15 Etats pour entrer en vigueur – ne réduisant la compétence pénale de la Cour qu’à une « promesse », selon un observateur indépendant. Et soulevant des inquiétudes si un certain nombre d’Etats africains devaient emboîter le pas des pays « déserteurs » de la CPI, compte tenu de la faiblesse de la plupart des juridictions nationales. « Se retirer de la CPI avant qu’une cour africaine ne soit capable de juger et de punir les crimes graves, c’est tout simplement garantir l’impunité et mépriser les victimes », conclut M. Assogbavi.