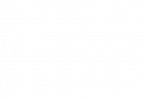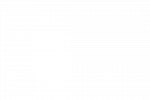Les 3% de déficit, une règle arbitraire née sur un coin de table

Les 3% de déficit, une règle arbitraire née sur un coin de table
LE MONDE ECONOMIE
Repère fixé en 1981 à la demande de François Mitterrand, il fut repris tel quel dans le traité de Maastricht. Sans que ne soit vraiment posé le sens de ce chiffre, vu comme simpliste par ses détracteurs.
Lorsqu’ils ont inscrit dans le traité de Maastricht les critères limitant le déficit public à 3 % du produit intérieur brut (PIB), et la dette publique à 60 % du PIB, les dirigeants européens se sont-ils fiés à une règle économique solide ? Pas vraiment. Selon la petite histoire, le seuil des 3 % a en effet été inventé en 1981 par trois hauts fonctionnaires français sur un coin de table. Le président François Mitterrand cherchait alors un chiffre simple à opposer aux ministres qui lui réclamaient des hausses de budgets.
Ce critère sera repris en 1992 comme règle de convergence économique des pays membres. Depuis, il ne cesse de diviser. Ceux qui le défendent affirment qu’il a le mérite d’instaurer une ligne de bonne conduite à respecter pour les gouvernements, leur évitant ainsi tout dérapage budgétaire.
Ces détracteurs lui reprochent l’usage dogmatique qu’il en est parfois fait à Bruxelles, et son manque de finesse : il ne fait pas la différence entre le « bon » et le « mauvais » déficit. Le premier correspond aux dépenses d’avenir permettant de favoriser la croissance future (certes pas toujours faciles à identifier), tandis que le second correspond à une augmentation injustifiée des dépenses de fonctionnement.
Le seuil des 60 % du PIB pour l’endettement public est tout aussi arbitraire. En effet, il ne présage en rien de la soutenabilité d’une dette, qui dépend de critères bien plus complexes, tels que la vigueur de la croissance, le niveau des taux d’intérêt, la durée des obligations émises, la nationalité de ceux qui les détiennent ou encore la crédibilité du gouvernement. A plus de 240 % du PIB, la dette souveraine du Japon n’inquiète ainsi personne. Mais en 2002, l’Argentine a fait défaut sur la sienne alors qu’elle dépassait « à peine » les 150 % de son PIB.