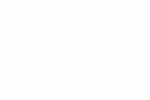Le Conseil constitutionnel censure la consultation habituelle de sites terroristes

Le Conseil constitutionnel censure la consultation habituelle de sites terroristes
Par Martin Untersinger
Les conseillers de la rue de Montpensier ont estimé que le texte limitait la liberté d’expression de manière disproportionnée.
La simple consultation d’un site Internet, fût-il terroriste, ne doit pas conduire en prison, a estimé, vendredi 10 février, le Conseil constitutionnel. Saisi par un Français poursuivi pour avoir consulté des contenus djihadistes, notamment des chants, sur l’application Telegram, ce dernier a jugé que le code pénal, qui prévoit depuis le mois de juin de punir de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende le fait de « consulter habituellement » des sites Internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à commettre de tels actes était contraire à la Constitution.
Le Conseil a d’abord rappelé, en préambule, que « la libre communication des pensées et des opinions » garantie par la Déclaration des droits de l’homme de 1789 « implique la liberté d’accéder » à Internet. Il a ensuite expliqué que toute disposition rognant sur cette liberté se devait d’être « nécessaire, adaptée et proportionnée ».
Nécessaire, la loi contestée ne l’est nullement, a noté le Conseil, égrenant les nombreuses dispositions constituant l’arsenal répressif, judiciaire comme administratif, dont s’est dotée la France, ces dernières années, pour lutter contre le terrorisme. Les gardiens de la Constitution notent que les pouvoirs des enquêteurs et des magistrats en matière d’enquêtes antiterroristes sont nombreux et ont été accrus ces dernières années ; les capacités de surveillance des services de renseignement ont connu la même évolution, et des capacités administratives de blocage et de déréférencement des sites Internet ont été octroyées aux forces de l’ordre. Bref, résume le juge constitutionnel, les pouvoirs publics peuvent déjà « contrôler » les sites, « surveiller » leurs visiteurs et les « sanctionner » lorsqu’ils risquent de passer à l’action, et ce « avant même que ce projet soit entré dans sa phase d’exécution ».
Le Conseil constitutionnel a aussi estimé que l’atteinte à la liberté de communication portée par ce délit n’est ni adaptée, ni proportionnée, puisqu’il « n’impose pas que [son] auteur ait la volonté de commettre des actes terroristes », pas plus qu’il adhère « à l’idéologie exprimée » sur ces sites. Autrement dit, et comme l’avait noté l’avocat François Sureau lors de son intervention devant le Conseil pour la Ligue des droits de l’homme, la loi contestée punit la « simple démarche intellectuelle ».
La loi prévoyait une exception lorsque la consultation habituelle était réalisée « de bonne foi ». Le Conseil a semble-t-il entendu les arguments de M. Sureau, qui a estimé lors de l’audience que la loi attaquée empêchait « le citoyen d’une démocratie de se former une opinion justifiée sur l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur notre société, sur sa nature et sur ses formes », jetant « un pan entier de la liberté de penser […] dans l’ombre policière et répressive ». Les conseillers ont en effet balayé cette exception, jugeant qu’elle faisait « peser une incertitude sur […] l’usage d’Internet pour rechercher des informations ».
Fin d’un serpent de mer
Cette décision du Conseil constitutionnel intervient dans un contexte particulier : la France a adopté une loi à visée antiterroriste par an depuis 2012, sans compter les dispositions relatives à l’État d’urgence. Cet édifice sécuritaire est régulièrement critiqué pour le recul qu’il fait subir aux libertés, faisant dire à M. Sureau que « la tristesse de ce temps » tenait « à l’évidente fragilité des grands principes dans notre conscience même. […] Les gouvernements ont cédé. Les parlements ont cédé. Personne je crois n’aurait pu, dans notre jeunesse nourrie des grands exemples et des drames du passé, imaginer qu’ils céderaient aussi facilement, par lâcheté, par inconséquence ou par calcul ». Par cette décision, le Conseil constitutionnel enfonce un deuxième coin dans cet édifice, après sa décision du mois d’octobre concernant la surveillance hertzienne.
Le juge constitutionnel, dont la décision signe la fin de toutes les procédures pour consultation habituelle de sites terroristes à l’exception des affaires définitivement jugées, coupe aussi définitivement la tête d’un serpent de mer qui venait régulièrement hanter les débats parlementaires sur l’antiterrorisme. D’abord proposé en 2012 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, après les attentats de Toulouse et Montauban, le délit de consultation habituelle de sites terroristes avait été vertement critiqué par le Conseil d’Etat, mais défendu par la droite, et finalement voté par les députés de gauche. Contre l’avis du gouvernement, il avait finalement pris place dans la loi sur la réforme pénale, promulguée en juin.