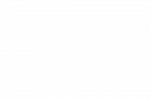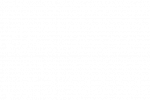A Madrid, des femmes en grève de la faim depuis un mois contre les « féminicides »

A Madrid, des femmes en grève de la faim depuis un mois contre les « féminicides »
Par Sandrine Morel (Madrid, correspondance)
Sur la place de la Puerta del Sol, une dizaine de femmes de tous âges réclame la fin du « terrorisme machiste ». Depuis le début de l’année, 17 femmes sont mortes des coups de leur conjoint.
Lors de l’édition 2016 de la Journée internationale des droits des femmes, à Madrid. | PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
« Combien de mortes faut-il ? » La question est posée sur un bout de carton, posé à même le sol, au centre de la place de la Puerta del Sol, à Madrid. Devant, un amoncellement de chaussures, couleur rouge sang, et des affiches, avec un nom, une ville, l’âge de la victime et la date de sa mort. « On ne nous tue pas, on nous assassine », est-il écrit sur une autre pancarte, terrible légende de cette mise en scène à la fois macabre et émouvante, visant à réveiller les consciences.
Les tentes ont repris position sur la Puerta del Sol, place emblématique de Madrid qui, en 2011, avait vu fleurir le mouvement des « indignés ». Cette fois, ce ne sont pas des jeunes qui crient contre la corruption, le chômage et la crise, mais des femmes en grève de la faim depuis le 9 février pour exiger des mesures effectives pour mettre fin à ce qu’elles appellent les « féminicides », qui chaque année font des dizaines de victimes – 60 en 2015, 44 en 2016 et déjà 17 en ce début d’année. Depuis que sont publiées les statistiques sur le sujet, en 2003, 887 femmes sont mortes en Espagne des coups de leur compagnon ou ex-compagnon.
En Espagne, la prise de conscience est forte et le royaume s’est doté de lois avant-gardistes pour protéger les femmes menacées, qui ont ensuite inspiré les pays alentours, dont la France. Système de surveillance, plan de protection intégral, bracelets électroniques, ou encore, dernière mesure annoncée en février, envoi d’un message téléphonique à la victime quand son agresseur bénéficie d’une permission de sortie de prison, n’ont cependant pas éradiqué le fléau.
Malgré les campagnes de prises de conscience, les numéros verts et les mesures d’éloignement, le pays continue de compter les mortes. A chaque nouvelle femme tuée des mains de son compagnon ou de son ex, l’information est relayée par les médias, en détail, et le bilan actualisé. En 2016, plus de 40 % des femmes assassinées avaient déjà porté plainte et 15 % bénéficiaient d’un plan de protection.
« Les lois existent, mais elles ne sont pas dotées des moyens nécessaires. Un policier pour 150 femmes maltraitées, ce n’est pas assez, dénonce, depuis la Puerta del Sol, mardi 7 février, Susana Bejarano, 46 ans, qui n’a rien mangé depuis vingt-six jours. En décembre 2015, nous avions déjà fait treize jours de grève de la faim avant les élections législatives pour obtenir le soutien des partis politiques. Mais depuis, ils nous ont oubliées et nous continuons à être assassinées. »
« J’étais devenue une menteuse compulsive, pour cacher mes bleus »
Comme tous les membres de l’association galicienne Ve-la luz (Vois la lumière), à l’origine de la mobilisation, elle-même a été victime des violences de son compagnon. « Pendant quinze ans, entre mes 18 ans et mes 33 ans, j’ai vécu avec mon agresseur, raconte-t-elle sous la tente où elle vend, avec ses compagnons de lutte, des tee-shirts et des badges, et fait signer une pétition demandant au gouvernement de renforcer la protection des victimes et les aides aux orphelins. Jusqu’au jour où mon fils de 8 ans a appelé la police : j’étais inconsciente. »
S’ensuivent deux années à se cacher, pendant lesquelles la justice a retiré l’autorité paternelle à son ex-compagnon, et cinq ans de thérapie pour réparer, plus ou moins, les blessures. « Quand je l’ai quitté, mon fils de 3 ans ne parlait pas. Il a commencé à le faire quand nous sommes allés vivre chez ma mère, » raconte-t-elle encore.
Avant d’expliquer, comme si elle devait se justifier d’être restée avec son bourreau tant d’années, qu’elle était « indépendante financièrement mais dépendante émotionnellement. »
« C’est le père de tes enfants, tu penses que tu peux le changer, le rééduquer. J’étais devenue une menteuse compulsive, pour cacher mes bleus. J’avais perdu toute confiance en moi, ce qui est normal puisqu’il répétait sans cesse à mes enfants que je ne valais rien, que j’étais une pute… Le quitter a été la décision la plus importante de ma vie. »
Pour l’association Ve-la luz, les victimes de « violence de genre », l’expression consacrée en Espagne, doivent être assimilées à celles du terrorisme, et leurs enfants bénéficier des mêmes indemnités et mesures de protection qu’elles. Car c’est un « terrorisme machiste » qu’elles dénoncent.
Devant le stand où elle est venue signer la pétition, Maria Jesus Orgaz, avocate de 60 ans, acquiesce. « On ne peut pas se permettre tant de morts, dit-elle. Qualifier ces assassinats de terrorisme, ce n’est pas s’éloigner de la réalité. La peur, incrustée dans les mentalités, et le sentiment chez les victimes qu’elles sont obligées à rester avec leur agresseur, en sont des ingrédients. »
Un flux constant de femmes vient signer la pétition, et quelques hommes aussi. Blanca, esthéticienne de 47 ans, regarde, les yeux noirs, le cercle des chaussures rouge sang et les noms des victimes. « J’ai souffert pendant des années de violence verbale et je suis en train de régler cela avant que ça n’aille plus loin », dit-elle. Elle ne dit pas « compagnon » ou « mari », mais, comme si elle ne savait plus comment définir celui qui partage sa vie, « la part masculine. »
« J’aurais aimé que la part masculine fasse quelque chose. Il se rend compte [du problème], mais il ne veut pas voir de psychologue. Je suis en phase de séparation, pour moi et pour le bien de mes deux filles… »
Dans son regard et ses mots, on comprend qu’elle a peur. « Le machisme est encore très présent dans les foyers et je crains que cela perdure encore longtemps. »
« Ma génération pense qu’il n’y a plus de machisme, mais c’est faux »
Soraya, 48 ans, employée administrative, frêle, a du mal à contenir son émotion. « Je suis venue pour leur donner mon soutien et les remercier de faire quelque chose pour toutes les femmes qui souffrent », dit-elle. Et sur sa joue, on discerne sous une épaisse couche de fond de teint, un bleu. « Je suis victime de violence », murmure-t-elle, la voix chevrotante. Elle raconte alors qu’elle n’a pas eu le courage de porter plainte quand la police est intervenue, l’an dernier, alertée par les voisins. « J’avais peur. Mais je vais voir une psychologue de la mairie, et ça me fait du bien… Je vis encore avec mon agresseur mais je me dis que ça ne pourra pas durer toujours. »
S’étirant après une nuit dans un sac de couchage sous la tente, une dizaine de jeunes filles venues soutenir, le week-end dernier, les militantes de Ve-la luz, s’assoient au soleil. « Ma génération pense qu’il n’y a plus de machisme, mais c’est faux », affirme Monica, 23 ans, qui raconte le calvaire des relations contrôlées via réseaux sociaux, les interrogatoires pour des « likes » sur une photo d’instagram posté par un copain, ou simplement la peur de se promener seule la nuit.
Au détour d’une question, elle lâche, le regard dur : « Mon père est un agresseur. » Commence alors un autre récit, parmi tant d’autres, sur cette place de Madrid transformée en hommage aux victimes trop longtemps silencieuses. « Ma mère n’était pas prête pour partir. Elle se sentait coupable, comme si elle méritait les coups et les insultes. Elle l’a quitté cet été. Elle nous a demandé pardon à mon frère et moi. On lui a dit merci. »
A 19 heures, une grande manifestation parcourra les rues de Madrid. Les femmes sont invitées à s’y rendre vêtues de noir, en signe de deuil.