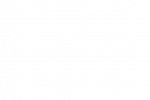En Tunisie, l’enquête sur l’attaque du musée du Bardo entachée par les controverses

En Tunisie, l’enquête sur l’attaque du musée du Bardo entachée par les controverses
Par Charlotte Bozonnet, Frédéric Bobin (Tunis, correspondant)
Deux ans après l’assaut djihadiste contre le musée de Tunis, où vingt-quatre personnes ont péri, malaise et crispations ont altéré l’environnement de l’enquête. Les avocats des victimes françaises se plaignent du manque d’information.
Des militaires devant le musée du Bardo, en mars 2015, lors d’une manifestation contre le terrorisme. | ANIS MILI / Reuters
A sa manière, l’affaire est un miroir des tensions propres à la transition tunisienne. Deux ans après l’attaque terroriste à Tunis contre le musée du Bardo, l’enquête n’en finit pas de soulever des interrogations, voire un malaise. Le 18 mars 2015, deux jeunes djihadistes tunisiens armés de kalachnikovs avaient fait irruption dans ce haut lieu de la mémoire du pays, très fréquenté des touristes, et y semèrent la mort – 21 visiteurs étrangers et un policier – avant d’être eux-mêmes abattus par les forces de sécurité.
Revendiqué par l’organisation Etat islamique (EI), l’attentat avait traumatisé la Tunisie, dont le fragile modèle démocratique, seul rescapé de la vague des révolutions arabes de 2011, était clairement visé. Un peu plus de trois mois plus tard, le pays sera à nouveau ensanglanté par une attaque similaire contre une station balnéaire près de Sousse, où 38 touristes étrangers – dont trente Britanniques – seront assassinés. En novembre 2016, le juge d’instruction saisi de l’affaire du Bardo a officiellement clos l’enquête, transmettant le dossier à la chambre d’accusation, qui devrait se prononcer sur le renvoi en procès. Sauf coup de théâtre, ce dernier pourrait se tenir dans les prochains mois. Selon des sources judiciaires, une vingtaine de prévenus devraient comparaître.
En France, les avocats des victimes ou de leurs familles (quatre ressortissants français ont été tués et six blessés) ne cachent pas leur dépit devant la manière dont ils ont été informés de l’instruction. « Une immense déception », dit Pauline Manesse, dont le cabinet représente une trentaine de victimes. « On a voulu croire en la justice tunisienne, faire confiance à cette démocratie naissante et lui laisser du temps, ajoute-t-elle. Il est normal que les Tunisiens conduisent les opérations – enquête et procédure judiciaire – mais ils auraient dû rendre compte de leurs avancées à la justice française. Or le dossier français est squelettique. Il a fallu attendre un an et demi pour recevoir des procès-verbaux d’interrogatoires, qui plus est, arrivés en arabe ». « Les victimes ne comprennent pas : aucune autorité ne joue le jeu de la transparence, poursuit-elle. Elles ont un sentiment d’abandon ».
Allégations de torture
Dès le départ, la sérénité de l’enquête a été altérée par des cafouillages, des querelles intestines au sein de l’appareil sécuritaire tunisien et, plus grave, des allégations de torture contre des suspects. A la brigade antiterroriste d’El-Gorjani (un quartier de Tunis) initialement saisie de l’enquête, une violente rivalité oppose alors le chef à son adjoint. Elle va se cristalliser autour d’un cas de torture. Le juge d’instruction chargé de l’enquête de l’attaque du Bardo, Béchir Akremi, magistrat du pôle antiterroriste, constate la réalité de la torture dont a été victime le suspect Houcine D. et dessaisit la brigade antiterroriste d’El-Gorjani pour confier l’enquête à une autre unité : la garde nationale de l’Aouina. Cette affaire de torture aura une autre conséquence : la libération, décidée en août 2015 par le juge Akremi, de six suspects, tous prétendant avoir subi de mauvais traitements. Il faut reprendre des pans entiers de l’enquête.
Cette vague de relaxes va enflammer la polémique. « Cela a été une erreur, fustige Issam Dardouri, un syndicaliste policier et fondateur de l’Organisation tunisienne de la sécurité et du citoyen. On ne relâche pas des terroristes sur le simple fait qu’ils ont été torturés. » M. Dardouri vient de sortir de quatre mois de détention, condamné pour diffamation après avoir lancé diverses accusations sur les réseaux sociaux. Dans cette Tunisie en transition, la controverse exacerbe les tensions entre juges et policiers, entre les tenants de l’Etat de droit et ceux de l’impératif sécuritaire. Dans le cas particulier de l’enquête sur l’attaque du Bardo, il s’y ajoute une mise en cause visant expressément le juge Akremi – nommé depuis procureur de la République – dénoncé par ses détracteurs pour de prétendues sympathies islamistes. Celles-ci expliqueraient, selon eux, les dysfonctionnements de l’enquête.
Goût amer
A Paris, l’accusation est bruyamment relayée par Philippe de Veulle, l’un des avocats des victimes. A l’en croire, la relaxe d’août 2015 des six prévenus, motivée par leur torture, n’est qu’un « prétexte judiciaire ». « Le juge est marié à une islamiste, pointe-t-il, et il a été nommé au moment du gouvernement de la troïka. » Cette « troïka », coalition de trois partis dominée par les islamistes d’Ennahda, avait dirigé la Tunisie entre la fin 2011 et début 2014. Quand on objecte à M. de Veulle qu’Ennahda a dénoncé sans ambiguïté la vague d’attentats dont la Tunisie est la cible ces dernières années, il rétorque : « Ils ont un double discours. Tout ça, c’est une nébuleuse. C’est le danger de l’islam politique ». Une source proche du dossier s’étonne de telles accusations : « Aucun élément issu des procès-verbaux ne permet d’affirmer que le juge a trahi des sympathies islamistes ».
Au-delà des polémiques sur un éventuel un biais partisan du juge Akremi, il reste que la manière dont l’enquête a été conduite laisse un goût amer à bien des observateurs. La remise en cause de certains aspects de l’enquête préliminaire de la brigade antiterroriste d’El-Gorjani en raison du scandale de la torture laisse perplexes certaines sources ayant eu accès au dossier. Selon elles, certaines pistes suggérées par des éléments techniques auraient pu connaître un traitement différent. Confusion institutionnelle, rivalité de pôles de pouvoir et âpreté des controverses partisanes dans la Tunisie post-révolution auront, à l’évidence, affecté l’environnement de l’enquête sur la tragédie du Bardo.