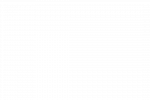Cédric Villani : « Je n’ai jamais eu les idées claires sur mon avenir »

Cédric Villani : « Je n’ai jamais eu les idées claires sur mon avenir »
Propos recueillis par Catherine Vincent
Lauréat en 2010 de la médaille Fields, la plus prestigieuse distinction de sa discipline, le mathématicien Cédric Villani est aussi un fervent défenseur de la recherche et de l’Europe. Il revient sur un parcours hors du commun.
Je ne serais pas arrivé là si…
… si je n’avais pas rencontré mon élève, Clément Mouhot, en 2000, à l’Ecole normale supérieure de Lyon. Et si nous n’avions pas eu, huit ans plus tard, la conversation qui a démarré notre recherche sur l’amortissement Landau. Ce n’était pas écrit sur mon radar.
L’amortissement Landau ?
Un calcul mathématique portant sur la stabilité des plasmas, effectué par Lev Davidovitch Landau, l’un des plus grands physiciens du XXe siècle. Mais, en 2008, ce n’est pas du tout la stabilité des plasmas qui me préoccupe. Je veux plutôt me lancer dans un grand problème
sur l’équation de Boltzmann – un physicien du XIXe siècle qui découvrit la notion statistique d’entropie d’un gaz. Mais le problème est juste trop dur pour moi. Clément, à cette époque, est devenu chercheur au CNRS. Nous sommes en contact régulier, il connaît bien mes travaux, je sais qu’il est brillant et disponible. Je l’invite donc un dimanche au bureau.
Et, pendant qu’on est en train de phosphorer, je me souviens d’une conversation que j’ai eue deux ans auparavant, à Princeton, avec un post-doctorant. Cela lui en rappelle une autre, qu’il a eue à Rhode Island… Et quand on met tout ensemble, Clément dit : « Ça doit avoir un lien avec l’amortissement Landau. » C’est ce jour-là que l’idée de travailler sur ce sujet est arrivée dans ma vie. Avant, je savais que cela existait, que c’était mystérieux, un truc pas clair du point de vue mathématique. Mais ce n’était pas dans mes plans. Et là, c’est arrivé. Comme une émanation de la conversation.
Est-ce ce sujet qui vous a valu la médaille Fields deux ans plus tard ?
La médaille venait récompenser des travaux portant sur la compréhension de la stabilité dans les systèmes de physique statistique. Et sans ce travail sur l’amortissement Landau, le compte n’y était pas. On s’y est lancé ensemble, pendant deux ans. Deux ans de galère commune.
Qu’une découverte mathématique parte d’une « émanation de la conversation », cela arrive-t-il souvent ?
C’est assez fréquent. Les conversations, c’est un peu notre fonds de commerce, et les collaborations aussi. Ce qu’on met en commun ? D’abord des astuces techniques. Ensuite un pool d’idées. Le simple fait de pouvoir discuter avec quelqu’un. Et l’espoir : quand il y en a un qui n’y croit plus, c’est l’autre qui le tire, et ainsi de suite – comme une cordée. Avec Clément, le gros du boulot a été fait par e-mail – des centaines de courriels échangés, parfois tous les jours, quand j’étais à l’université de Princeton. Car j’ai été invité pendant six mois dans cette petite ville, en 2009, avec ma femme et mes deux enfants, alors qu’on bossait là-dessus. Et, cela aussi, ça a été décisif. Si j’avais été en France à ce moment-là, je n’aurais jamais pu rassembler le niveau de concentration nécessaire. J’avais trop d’autres choses à faire.
18 de moyenne au bac à 16 ans et demi, maths sup et spé au lycée Louis-le-Grand, puis l’Ecole normale supérieure (ENS) à Paris : comment avez-vous vécu ce brillant parcours ?
Comme une révélation. Je suis né à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, j’ai grandi pour l’essentiel à Toulon… La prépa à Louis-le-Grand, c’est la sortie du cocon familial, et le moment où l’on va jusqu’aux limites de la résistance physique. Je suis passé presque sans transition d’une époque où j’étais au lit à 20 heures-21 heures, tout sage, à une autre où je refaisais mes exercices et des délires de potache avec les camarades jusqu’à 2 heures du matin ! Une autre vie.
On voit souvent la prépa comme un moment étouffant, castrateur, où on se replie sur soi-même : je l’ai vécu au contraire comme un épanouissement. Je travaillais énormément, j’étais en discussion constante avec d’autres élèves… Ma chambre d’internat était un peu à l’écart des autres, et cela ne me convenait pas. Alors, je passais presque toutes mes soirées dans les chambres des autres, à bosser avec eux. A chaque moment, j’avais un squat où je venais sans arrêt, jusqu’à ce qu’ils perdent patience et que je doive en trouver un autre. J’en ai eu comme ça trois ou quatre différents au cours de mon année de sup… Je rejoignais ma chambre très tard pour dormir un peu. A l’époque, j’avais un réveil interne : je me réveillais spontanément à l’heure qu’il fallait, juste un quart d’heure avant le cours. J’ai perdu cette faculté depuis.
A quel moment avez-vous découvert votre amour des mathématiques ?
Honnêtement, je ne m’en souviens pas. Je n’ai pas de souvenirs avant 6 ou 7 ans, et, à cette époque-là, déjà, c’était un sujet qui me plaisait. Mais de là à devenir mathématicien… Même en terminale, je ne savais pas. Mes parents, tous deux pieds-noirs arrivés d’Algérie – un pays qui m’est cher – alors qu’ils étaient tout juste adolescents, étaient profs de lettres. Ce qu’ils voulaient, c’était que je passe l’agrégation : les maths, ce n’était pas spécialement leur truc. Quant à mon grand-père maternel, qui était marin au long cours, il m’a écrit des années plus tard une lettre touchante dans laquelle il disait : « J’aurais préféré que tu fasses Polytechnique, mais tu as fait le bon choix. »
Et pourquoi, donc, avoir choisi l’ENS plutôt que Polytechnique ?
Je ne sais pas trop. Vous savez, je n’ai jamais eu les idées très claires sur mon avenir. Le jour où j’ai été reçu à l’ENS, à la première réunion des admis, le directeur nous a demandé : « Qu’est-ce que vous voulez savoir sur l’ENS ? Combien vous allez être payés ? » C’est alors que j’ai découvert que j’allais être rémunéré pour mon travail… Je ne m’étais jamais posé la question ! De même, je ne cherchais pas spécialement à entrer à l’ENS, j’ai juste suivi le flot de ce qu’on me conseillait. Ma seule inquiétude, c’était : « Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes de mes pairs et de mes enseignants ? » Arrivé en spé, vu mes résultats en sup, je me souviens d’une énorme pression. Une obligation de réussite. Une fois à l’ENS, en revanche, j’ai fait mon coming out.
C’est-à-dire ?
Après trois-quatre mois fort sérieux, je suis passé d’un extrême à l’autre. Je me suis mis à sécher tous les cours, à l’exception unique de celui de musique et de mathématiques. Je me suis remis au piano, je passais mes journées à écouter de la musique classique en faisant des anagrammes… C’est aussi l’époque où je me relooke – c’est de là que date ma tenue actuelle.
Le costume trois pièces, la lavallière, la broche araignée à tout juste 20 ans… Pourquoi ce choix, si jeune ?
Par quête d’identité sociale. Un jour, je prends le métro pour aller à un concert – à l’époque, j’allais Salle Pleyel, au Châtelet, ou qui sait quoi quasiment toutes les semaines –, et je tombe face à une publicité montrant une de ces grandes chemises à l’ancienne, avec l’adresse du magasin. J’y suis allé – c’était passage Choiseul –, le truc m’a plu, j’ai commencé à écumer les rayons de vêtements de seconde main dans les échoppes du coin, dans les brocantes ici et là… Et voilà : quelques mois plus tard, j’étais branché sur mon costume trois pièces avec nœud papillon et montre de gousset, après avoir aussi tâté du jabot et du chapeau haut-de-forme.
Très théâtral, non ?
Un petit peu, un petit peu… A la même époque, je deviens un être hypersocial, occupé sans arrêt à discuter avec les uns et les autres, très souvent fourré avec les littéraires. Je me fais nommer directeur du club Spectacles de l’ENS, puis président de l’association des élèves. Sans parler des filles ! Je commençais seulement à m’y intéresser – très tardivement, donc. Mais, avec mon costume et l’aura du poste de président de l’association, d’un coup, ça marchait du tonnerre. C’était en 1994, et ça a failli être la fin de ma carrière scientifique.
Diable ! Et pourquoi cela ?
Parce que l’organisation des activités me passionnait et m’occupait à plein-temps ! Présider les assemblées générales, faire voter le budget, organiser le grand bal du bicentenaire de l’ENS… J’avais fait le discours d’ouverture dans un gymnase bourré de monde, aux côtés de Roger Fauroux, qui avait été ministre sous la gauche, je m’étais lancé dans une diatribe enflammée dans le style révolutionnaire – j’avais potassé les discours de Saint-Just, à l’époque, pour préparer l’affaire, et découvert qu’il était beaucoup plus rationnel et méthodique que l’image enflammée qu’on en a… J’étais à fond ! Et à deux doigts de me lancer dans une carrière administrative.
Ce qui m’a ramené à la recherche, c’est quand mon tuteur de l’époque m’a fait miroiter un poste d’agrégé préparateur (un « caïman » dans le jargon normalien) : un poste dans lequel on est intermédiaire entre les élèves et les enseignants, où l’on fait du tutorat, du conseil : c’est ce que je voulais plus que tout au monde. Du jour au lendemain, je me suis remis au boulot.
Je reviens sur votre tenue vestimentaire, qui est devenue votre signature. N’avez-vous jamais envie d’en changer ?
Pas spécialement. C’est plutôt mon entourage familial que cela agace parfois, quand on est en déplacement, et que les uns et les autres viennent me demander des autographes ou des selfies… Ça fait toujours marrer mes enfants. Mais moi, non, ça ne m’a jamais pesé. Même pas le week-end.
C’est une sorte de seconde peau, alors ?
Ce n’est pas toujours une seconde peau, les vêtements ? Je ne suis pas psychanalyste, je ne sais pas ce qui se passe dans mon propre cerveau.
En 2012, vous avez publié « Théorème vivant », ouvrage singulier – et très accessible – qui retrace la lente élaboration de votre théorème. Une fois à Princeton, dites-vous, vous réalisez qu’il vous reste moins d’un an pour pouvoir briguer la médaille Fields, attribuée tous les quatre ans à des chercheurs de moins de 40 ans… Obtenir cette récompense suprême, était-ce un but essentiel ?
Disons que ça vient en toile de fond. On s’efforce de ne pas y penser, on ne travaille pas pour elle, on ose à peine la nommer (on dit : la MF)… Mais on sent l’horloge qui tique.
Un des souvenirs marquants de cette intense période de recherche ?
Une étape dramatique, et majeure dans le processus. On est début 2009, j’ai accepté de présenter mes résultats au séminaire d’un ami, je pense tenir ma démonstration… et à peine la présentation terminée, je me rends compte que ma preuve ne tient pas debout. Avoir annoncé des résultats qui ne sont pas encore démontrés, c’est une grave faute professionnelle ! Je comprends alors qu’il faut absolument réparer. Réparer, réparer. A l’urgence de briller s’ajoute l’urgence de racheter mon honneur… Je m’en souviens comme d’une période très pénible. Pression monstrueuse. Cela a duré peut-être deux mois, le temps de me remettre en selle. Et, deux mois plus tard, la preuve n’était toujours pas réparée, mais les ingrédients étaient là. Clément et moi sentions qu’on avait trouvé quelque chose de bien. On y croyait.
Il y a deux ans, vous avez également écrit avec le compositeur Karol Beffa un ouvrage sur « Les Coulisses de la création » (Champs Flammarion). Quel rapport entretenez-vous avec la musique ?
Je suis un être musical, au sens qu’il me faut ma dose de musique tous les jours. A une époque, j’avais besoin de jouer du piano au moins une heure par jour pour me sentir bien. J’ai dû tourner la page parce que je n’avais plus le temps. Mais j’ai besoin du soutien musical sans arrêt. Toutes sortes de musiques : je suis venu à la musique classique sur le tard, mais avec une énorme énergie, beaucoup de pop et de rock, comme tout le monde… Cela va par vagues, toujours en obsession.
Il y a quelques années, je me suis pris de passion pour Nightwish, un groupe de hard rock symphonique finlandais extraordinaire. J’ai fait une orgie d’Allain Leprest, de la chanson française à texte poétique, magnifique. Plus récemment, c’était Masahiko Sato et Kate Tempest et en ce moment la mystérieuse et élégante Fishbach. Je suis également président d’une association fondée par Patrice Moullet, l’ancien compagnon de Catherine Ribeiro, qui s’occupe de fabriquer de nouveaux instruments de musique, au design très particulier, qui s’adaptent à tous les types de handicaps. C’est une part importante de ma vie aujourd’hui.
Vous multipliez les conférences grand public, vous vous engagez pour l’avenir de la recherche et de l’Europe tout en dirigeant l’Institut Henri-Poincaré, haut lieu français des mathématiques… Vous êtes un peu hyperactif, non ?
Il y a de ça, oui. Mais je n’ai pas toujours été ainsi. J’étais un petit garçon chétif, plutôt malade, passant une bonne partie de mon temps à lire au lit… Et d’une timidité extrême : les enseignants se plaignaient de ne pas entendre le son de ma voix ! Le côté hypertonique, rognant sur les heures de sommeil, c’est venu avec les classes préparatoires.
Y a-t-il eu un avant et un après la médaille Fields ?
Oui. Et aussi un avant et un après Théorème vivant. Tout à coup, j’étais l’invité que tout le monde voulait. Il y a eu beaucoup d’émissions de télévision, de conférences, on me demandait de parler de la naissance des idées, de créativité, d’innovation… Je suis devenu beaucoup plus visible médiatiquement. Or, de nos jours, la notoriété et la puissance sont très corrélées. J’en profite pour tenter de faire avancer les idées auxquelles je crois. Et la plus importante à mes yeux, c’est la réconciliation de la figure du scientifique avec la société. Pour motiver les jeunes à se lancer dans la science, mais aussi pour améliorer l’interface entre le monde de l’entreprise et le monde universitaire, entre la recherche-développement et la science.
Vous soutenez publiquement la candidature d’Emmanuel Macron. Pour quelle raison ?
Du fait de sa position vis-à-vis de l’Europe. Je travaille depuis 2011 avec le think tank pro-européen EuropaNova, dont je suis maintenant l’un des vice-présidents, et pour lequel l’avenir réside dans une Europe fédérale. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré Emmanuel Macron pour la première fois, en 2013, alors qu’il s’occupait à l’Elysée des questions européennes. Et puis j’ai entendu son discours à Berlin, à la mi-janvier de cette année : c’était le discours le plus résolument et sincèrement pro-européen qu’ait fait un dirigeant politique français depuis longtemps. Je me suis dit alors : « C’est mon devoir de conviction européenne que d’aller soutenir sa campagne. » Par ailleurs, son positionnement ni gauche ni droite me parle beaucoup. Cela fait quinze ans que j’attends qu’émerge une force politique au centre.
« Théorème vivant », de Cédric Villani, est réédité au Livre de poche (2013)
Retrouvez tous les entretiens de La Matinale du Monde ici