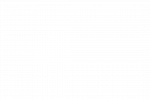Les métiers de la French touch, atouts pour passer les frontières

Les métiers de la French touch, atouts pour passer les frontières
Par Jessica Gourdon
Estampillés « qualité française », les métiers du luxe, de l’artisanat d’art, de la 3D, de la gastronomie ou encore celui d’ingénieur, s’avèrent de bons filons pour qui veut tenter une expérience professionnelle hors les murs.
Etudiants de l’école de gastronomie Ferrandi, en avril 2016. AFP PHOTO / PHILIPPE LOPEZ | PHILIPPE LOPEZ / AFP
Canada, Nouvelle-Zélande, et maintenant, Angleterre : depuis son diplôme, Alexis Kerjosse, 26 ans, a enchaîné les postes aux quatre coins du monde. Il a toujours trouvé des contrats sans difficultés, et ce, alors qu’il avait fait toutes ses études en France. Travailler à l’étranger était un « rêve »pour ce jeune homme, qu’il a réussi à réaliser en devenant animateur 3D. Une compétence très recherchée, et dans laquelle les Français ont acquis une excellente réputation. « Mon premier salaire à Vancouver, au Canada, était assez bas, juste assez pour vivre en colocation. Ensuite, entre Montréal et Wellington, j’ai triplé mes revenus », explique ce diplômé 2014 de l’Ecole de l’image des Gobelins, à Paris.
L’animation comme les jeux vidéo font partie d’un ensemble de domaines où les jeunes Français profitent, hors des frontières, d’un avantage comparatif, doublé d’une bonne image. « Les animateurs français sont appréciés à l’étranger car ils savent bien raconter les histoires, et qu’ils ont une certaine fraîcheur pour faire passer des émotions. C’est dû, selon moi, à la manière dont on enseigne, et au fait que nos jeunes puisent leur inspiration dans la richesse culturelle française », résume Nathalie Berriat, directrice des Gobelins, qui compte parmi ses anciens quelques symboles de réussite tel Pierre Coffin, le créateur des Minions.
Dans un marché de plus en plus compétitif, ces filières French touch permettent souvent aux jeunes de s’expatrier dans de meilleures conditions. Et quand on parle de choses que la France fait mieux que les autres, on en vient souvent à la table.
Cuisine et métiers d’art
Certes, l’étoile des grands chefs français a pâli ces derniers temps. Mais avoir fait ses classes en France donne « un gage de qualité évident », tranche Simon Herfray, pâtissier de 30 ans installé à New York. « Ici, rien qu’avec l’accent français, on présume que tu es compétent », dit-il, amusé. Depuis son bac pro, ce Nantais a promené sa toque entre Londres, l’Australie et la Côte est des Etats-Unis. Les contrats se sont enchaînés, ses employeurs lui ont souvent payé billets d’avion et visas, l’ont accueilli à l’aéroport, voire hébergé. « En tant que pâtissier français, travailler à l’étranger n’est pas compliqué. Je mets mon CV sur un site, et je suis souvent rappelé. A Sydney, j’ai frappé à la porte d’une pâtisserie française, qui m’a embauché le jour même. Même s’il y a de la concurrence, il y a un savoir-faire et une passion qu’on ne trouve pas ailleurs. »
Boulanger, cuisinier, pâtissier : des professions idéales pour ceux qui rêvent de partir, comme celles, de manière moins attendue, qui touchent aux métiers d’art, ces compétences typiquement françaises nées dans le giron de Colbert et des manufactures royales. Les Métalliers Champenois, entreprise qui a investi le marché américain depuis qu’elle a restauré la statue de la Liberté, emploie dans son atelier du New Jersey sept jeunes Français, spécialistes en métallerie fine, qui fabriquent des rampes et des portes en bronze pour des palaces ou des résidences de luxe. Elle en envoie d’autres à Hongkong, dans les Emirats, à Monaco, au Canada.
Luxe : une longueur d’avance
Pendant ses études en apprentissage, Jennifer Crescy, spécialiste en tapisserie de sièges, n’était pas partie à l’étranger, et en était « un peu frustrée ». Elle s’est rattrapée : depuis un an, elle travaille à New York pour la filiale des Ateliers Jouffre, une entreprise de tapisserie. Elle fabrique et restaure des sièges pour des hôtels ou des résidences particulières, et forme des équipes locales. « Aux Etats-Unis, les gens apprennent la tapisserie sur le tas. Il n’y a pas, comme ici, d’écoles qui normalisent les pratiques et permettent de maintenir un savoir-faire, commente-t-elle. Ici, les clients disent que ce qu’ils aiment chez les Français, c’est l’attention au détail, la rigueur. »
Dans ce même univers, les études en management du luxe donnent aux jeunes Français une longueur d’avance à l’international, en particulier en Asie et en Amérique. C’est ce qu’a constaté Simon Nyeck, professeur à l’Essec en marketing du luxe : « Le luxe est un secteur où les marques françaises dominent dans le monde, mais où les marchés et les boutiques sont surtout hors d’Europe. Or, à l’étranger, les directions restent très françaises, et recrutent des gens de formations qu’elles connaissent. Pour des jeunes Français qui veulent partir, c’est un bon filon. D’autant que les formations en management du luxe en France sont uniques : elles bénéficient de la proximité avec les métiers d’art, les maisons de couture, bref, d’une histoire qui n’existe pas ailleurs. »
Par-delà le monde des arts et de la création, d’autres jeunes Français n’ont pas de mal à larguer les amarres : les ingénieurs. Dans un contexte de pénurie, les entreprises de la Silicon Valley « se les arrachent », n’a pas peur d’affirmer Sylvain Kalache, 28 ans, développeur informatique passé par le siège de Linkedin et animateur de While42, réseau qui rassemble 600 ingénieurs français en Californie. « Par rapport aux Américains, les ingénieurs français sont appréciés car ils ont un esprit beaucoup plus critique, sont plus attentifs aux détails. Alors que les développeurs américains ont souvent une meilleure vision business et marketing. Ce sont donc des profils très complémentaires », résume ce diplômé de SupInfo, qui a créé à San Francisco une école où il forme des développeurs « à la française ».
Le « plus » des maths
Cette bonne image découle en partie d’un autre atout de la France, connu depuis Descartes, Lagrange et Pascal : les maths. « Notre système de formation permet d’amener beaucoup d’étudiants à un meilleur niveau que celui atteint dans d’autres pays », témoigne Stéphane Seuret, président de la Société mathématique de France. C’est ce qui explique que les diplômés universitaires en maths n’ont pas de mal à se faire embaucher dans des universités ou des entreprises étrangères. Même si la Chine fournit des concurrents « de plus en plus importants », note Stéphane Seuret.
Car une avance dans un domaine n’est jamais garantie dans le temps. Prenez la philosophie. « Certes, elle reste une discipline majeure en France, mais aujourd’hui, son avantage à l’international n’est plus frappant », estime le chercheur et historien des idées François Cusset. Selon lui, les sciences humaines françaises ont « un peu raté le train de l’internationalisation ». « Les jeunes chercheurs français ne sont pas très représentés dans les réseaux mondiaux, et sont peu présents dans certains champs, comme les études de genre ou postcoloniales. Alors qu’on voit des courants de pensée de plus en plus structurés émerger de certains pays du Sud. »
Et si les philosophes de la « French Theory » (Deleuze, Foucault, Derrida…) ont été un temps adulés sur les campus américains, et ont pu, il y a vingt-cinq ans, donner aux jeunes chercheurs hexagonaux « un avantage symbolique aux Etats-Unis », ces auteurs constituent aujourd’hui « un corpus de références parmi d’autres », tandis que les nouvelles générations françaises « n’ont pas forcément creusé cet héritage », poursuit François Cusset.
Ainsi, l’atout French touch, même lorsqu’il s’appuie sur un héritage, des figures d’autorité ou un système de formation, n’est jamais donné à vie. A l’échelle individuelle non plus. « Une personne peut être très bonne dans son travail dans son pays, et mauvaise à l’étranger. S’expatrier demande des compétences et des capacités d’adaptation que tout le monde n’a pas », prévient Jean-Luc Cerdin, auteur d‘ouvrages sur l’expatriation. French touch ou pas, rien n’est gagné d’avance.