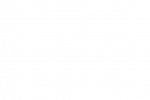Comment évaluer un bachelor commerce

Comment évaluer un bachelor commerce
Par Jean-Claude Lewandowski
Durée du cursus, ouverture internationale, modalités pédagogiques, coût de la scolarité… L’offre des écoles de gestion est foisonnante et variée.
Des étudiants sur le campus de l’université de Raleigh, en Caroline du Nord. | Kevin C. Cox / Getty Images/AFP
La plupart des écoles de commerce proposent désormais un bachelor – parfois plusieurs. Mais d’un programme à l’autre, les caractéristiques diffèrent : cursus en trois ou quatre ans, contenus d’enseignement qui varient selon les écoles, sélection sur dossier ou concours, ouverture internationale plus ou moins marquée… Quant aux tarifs, ils peuvent évoluer du simple au double – de 6 000 à 11 000 euros par an le plus souvent, ceux du réseau Ecoles de gestion et de commerce (EGC) tournant autour de 4 000 euros.
Dans ces conditions, comment choisir son programme ? Sur quels critères ? D’autant que, à la différence d’un diplôme national comme celui de master, le bachelor reste très peu réglementé. La Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), soucieuse de réguler l’offre, planche sur un projet de « grade licence »… qui se fait attendre. Quant aux classements de bachelors, s’ils peuvent fournir d’utiles informations, mieux vaut ne pas s’y fier aveuglément.
La durée du cursus constitue un premier élément du choix. Si tous les bachelors affichent une dimension internationale marquée, les programmes en quatre ans sont, a priori, les plus ouverts sur le monde. La plupart prévoient des séjours longs à l’étranger – jusqu’à deux années à l’Essec, à Kedge Business School, à EM Lyon ou à Neoma – et un enseignement le plus souvent en anglais. Skema, de son côté, a opté pour deux programmes en quatre ans, dont un « BBA in Global Management », assorti d’un double diplôme, qui permet de séjourner sur les campus de l’école à Raleigh (Etats-Unis), Suzhou (Chine) ou au Brésil.
Qualité de l’enseignement
Il convient donc de bien réfléchir à son projet : inutile de s’embarquer dans un bachelor en quatre ans, forcément plus onéreux, si l’on n’envisage pas de faire carrière à l’international. Certaines écoles comme Kedge, Neoma ou l’Inseec proposent les deux types de cursus – et parfois des bachelors spécialisés.
Mais plusieurs autres critères sont à prendre en compte – à commencer par la qualité de l’enseignement. Certes, il est difficile de juger, de l’extérieur, du niveau de la formation dispensée. « Mais certaines institutions font appel à des enseignants moins expérimentés et moins internationaux que pour leur cursus grande école, voire à des vacataires », signale Jean-Philippe Ammeux, directeur de l’Ieseg.
La sélection à l’entrée constitue également un gage de sérieux. Si certaines écoles choisissent avec soin leurs candidats (sur dossier et/ou sur concours), d’autres, confrontées à une équation budgétaire délicate, ne résistent pas à la tentation d’ouvrir largement leurs portes et d’abaisser leurs critères d’admission… « Nous avons en moyenne trois candidats pour une place », assure pour sa part Jean-Philippe Ammeux. L’Edhec, de son côté, a adopté un dispositif visant à attirer les bacheliers avec mention bien ou très bien, avec des réductions sur leurs frais de scolarité.
Réputation de l’école
« Quelques établissements gonflent leurs effectifs pour augmenter leurs ressources », relève encore Jean-Philippe Ammeux, qui préfère miser sur de petites promotions (une trentaine d’élèves par an). « Mieux vaut éviter les programmes aux effectifs trop réduits, car l’offre pédagogique y est limitée », juge à l’inverse François Bonvalet, directeur général de Toulouse Business School, dont le bachelor, l’un des plus importants de l’Hexagone, aligne 400 inscrits par an.
Autre question à se poser : que deviennent les diplômés ? « Il faut être très attentif aux perspectives de sortie professionnelle à l’issue du cursus, conseille François Bonvalet. Mieux vaut aussi vérifier où s’orientent les diplômés qui optent pour la poursuite d’études : accèdent-ils à une école cotée, ou doivent-ils se contenter d’institutions de second rang ? »
Reste la solution qui consiste à se fier à la réputation de l’école qui propose le programme. « Une marque reconnue constitue une forme de garantie », affirme François Bonvalet. Difficile, il est vrai, pour une institution réputée d’offrir une formation qui ne tiendrait pas sa « promesse » : elle risquerait d’y perdre son crédit. Car les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille, en la matière, jouent à plein.