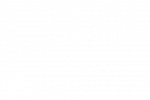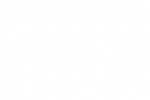Nour, prostituée free-lance à Abidjan : « Je n’ai pas de maquerelle mais un téléphone portable »

Nour, prostituée free-lance à Abidjan : « Je n’ai pas de maquerelle mais un téléphone portable »
Par Ghalia Kadiri (Abidjan, envoyée spéciale)
Abidjan underground (2/6). Au cours d’une soirée avec des clients saoudiens, cette Marocaine de 25 ans s’est confiée à notre reporter.
En arabe, « nour » signifie « lumière ». Et c’est vrai que ce soir, on ne voit qu’elle. Ses éclats de rire, son aisance naturelle. Nour fait son entrée dans le restaurant comme une comédienne monte sur scène. Les projecteurs sont braqués sur elle. Elle s’est donné un rôle. Comme à chaque fois qu’elle exerce, elle devient une autre. Pour se protéger, sans doute. « Pour survivre », dit-elle.
Depuis l’âge de 16 ans, Nour se prostitue. Loin de son pays, cette Marocaine de 25 ans a préféré poursuivre sa carrière à Abidjan, où elle s’est installée il y a deux ans. Comme elle, des centaines de filles – la prostitution est difficilement chiffrable – ont quitté le royaume pour rejoindre les réseaux d’Afrique de l’Ouest. En Guinée, au Gabon, au Nigeria et même au Mali, avant l’intervention de l’armée française en 2013. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont les marchés les plus prisés. Faciles d’accès et souples en matière de législation sur la prostitution, ces pays abritent une diaspora libanaise et une communauté d’expatriés dans lesquelles se recrutent les clients. Pour les prostituées, le déplacement permet d’exercer sous couvert d’anonymat, loin des regards de la famille et de la stigmatisation de la société.
« Je ne peux pas les supporter »
Ce soir, Nour est assise à la table de quatre Saoudiens dans un restaurant chic d’Abidjan. Elle est belle, métamorphosée en fille sage et aimante. Brune, petite, les jambes fines. Pas de talons aiguilles ni de maquillage outrancier. Elle rit très fort chaque fois que son client, Abou Asaad, un diplomate de 35 ans, lui glisse un mot à l’oreille. Lui et ses trois amis travaillent à l’ambassade d’Arabie saoudite à Abidjan. Nour les complimente à tour de rôle dans un dialecte saoudien parfait. Mais, dès qu’ils ont le dos tourné, elle sort de son personnage le temps d’un témoignage chuchoté en aparté.
« J’ai descendu deux bouteilles de vin avant d’arriver. Je ne peux pas les supporter. L’alcool, ça aide. »
Les mots sortent en darija (arabe dialectal marocain). Celui qu’on entend dans les quartiers populaires de Casablanca. Le langage est cru, la posture intacte.
« Je n’ai pas de maquerelle mais un téléphone portable. Et un titre de séjour grâce à un contact à l’ambassade du Maroc. Je n’ai besoin de personne. Ici, je connais tout le monde : les taxis, les flics, les maquereaux, les videurs de boîte. »
Elle jette un regard prudent en direction du diplomate saoudien.
« Il suffit de sortir dans les bons endroits pour chasser les bons pigeons. Règle numéro 1 : jamais de clients noirs ; sinon, plus personne ne te touchera. Règle numéro 2 : ne pique pas la clientèle des autres. Il y a beaucoup de free-lance à Abidjan, on se connaît. Et puis, les maquerelles nous surveillent de près. J’ai déjà reçu un verre au visage parce que je m’approchais trop près d’un client. »
Nour montre discrètement une cicatrice en haut du cou, petite mais profonde, cachée par sa chevelure épaisse. Son sourire pétillant n’a pas quitté son visage. Sur la table, les bouteilles de vodka s’enchaînent l’une après l’autre. Elle suit le rythme.
« Je parle beaucoup pour ne pas m’endormir. Parfois, quand je bois trop, je m’évanouis. »
Abou Asaad se rapproche de Nour. Elle murmure de plus en plus bas.
« C’est un jnoun [un démon, en arabe]. Il m’attache au lit et me bat avant de passer à l’acte. Moi, je dois faire semblant que ça m’excite. Il aime les filles soumises. Jusque-là, je m’en suis sortie avec des hématomes et des éraflures. Mais c’est trop tard pour dire stop. Si je refuse de sortir avec lui, il me retrouvera et me tuera. Il a l’immunité diplomatique. Je sais que ce c’est, je suis allée à l’école. »
Le Saoudien attrape fermement sa main, comme pour s’assurer qu’elle n’ira nulle part.
« En plus, il refuse de se protéger. Je n’ai pas peur de grand-chose après tout ce que j’ai vu dans ma vie. Mais le sida, ça me fait peur. Surtout ici. Je n’ai jamais osé faire un dépistage. »
La soirée touche à sa fin. Dehors, Abou Asaad tire la jeune fille vers une berline noire. Nour le suit, elle sourit toujours.
« Je me suis sacrifiée pour mes frères »
Le lendemain, son visage d’enfant a perdu de son éclat. Nour est assise, le regard vide, sur le canapé de son luxueux appartement, qu’elle partage avec deux autres prostituées marocaines. L’atmosphère est glaciale, le décor aseptisé.
« Je viens de Casablanca. Là-bas, j’habitais dans une pièce avec toute ma famille : mon oncle et sa femme, leurs trois filles et mes deux petits frères. Nous n’avons jamais connu mon père. Ma mère était femme de ménage. Elle est morte quand j’avais 14 ans. »
Les projecteurs sont éteints. Elle est redevenue elle-même.
« C’est mon oncle qui s’est occupé de nous. Il m’a demandé d’arrêter l’école pour gagner de l’argent parce que, déjà qu’il nous logeait, il ne pouvait pas faire plus pour nous, disait-il. Dehors, tout ce que j’ai su faire, c’est vendre mon corps. J’avais 16 ans, je n’étais jamais sortie du quartier. A ce moment-là, j’ai compris que ma vie n’avait plus de valeur. Celle de mes frères, si. Ils avaient encore la possibilité de s’en sortir. Alors je me suis sacrifiée pour eux. »
Nour allume une cigarette de ses mains tremblantes.
« Mais moi, je ne pouvais pas rester. Tout le monde savait que je me prostituais. Mon oncle m’a interdit de venir rendre visite à mes frères dans le quartier. Les voisins l’avaient menacé d’appeler la police. Et puis, il n’y avait plus de boulot. J’étais devenue périmée pour les clients. »
Ici, Nour gagne entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Elle en envoie la moitié à ses frères, restés au Maroc. Aujourd’hui, le plus jeune passe le bac, l’autre est étudiant en droit.
« Et moi, je suis prostituée. »
Son sourire a disparu.
Le sommaire de notre série « Abidjan underground »
Plongée dans les bas-fonds d’Abidjan, où prospèrent trafiquants de drogues et de médicaments, maqueraux et prostituées.