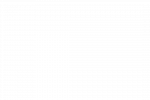« Dragon Ball Super » de retour dans les librairies françaises

« Dragon Ball Super » de retour dans les librairies françaises
Par William Audureau
Après deux décennies d’interruption, Goku, le superhéros intergalactique, fait son retour dans une nouvelle saga inédite, avec un nouveau dessinateur à la barre.
« Puisqu’on est au stade super saiyan de l’état super saiyan divin tous les deux, c’est forcément moi, le guerrier d’élite, qui serai supérieur !
– Non, c’est mon stade super saiyan de l’état super… OUILLE !! Je me suis mordu la langue. »
Son Goku, le guerrier intergalactique au cœur pur, et Vegeta, son éternel rival orgueilleux, se toisent en plein combat d’entraînement et… débattent de leurs transformations. Il faut avoir suivi les quarante-deux volumes inititiaux de la série « Dragon Ball » pour comprendre ces références sibyllines à des mutations capillaires étranges – plus les héros se renforcent, plus leur chevelure arbore des couleurs et formes improbables, comme jaune, jaune jusqu’aux fesses, rouge à épi, et, ô nouveauté, bleu turquoise.
Mais suivre la série, c’est précisément ce qu’ont fait plusieurs générations de mangaphiles – trente millions de volumes ont été achetés rien qu’en France depuis son lancement, selon son éditeur, Jacques Glénat. Et « Dragon Ball Super » vient reprendre le flambeau d’une saga interrompue brutalement en 1995, au faîte de sa gloire, après une énième crise de lassitude de son fécond créateur, Akira Toriyama.
Le mystérieux maître, qui refuse catégoriquement tout entretien et ne se dessine que derrière un masque à gaz loufoque, est crédité au scénario de cette suite, mais on perçoit vite la subtile différence amenée par son disciple désigné, le mangaka Toyotaro. Tout en cherchant à coller au plus près au style du maître – période « Dragon Ball Z », la plus anguleuse – à l’exception de quelques combats très fouillés, le trait est souvent un peu moins assuré, la gestuelle plus raide, certaines silhouettes trop vite expédiées. A la décharge du nouveau venu, difficile de reprendre le flambeau d’un dessinateur aussi influent, et dont le style a tant évolué depuis les débuts du manga, en 1984.
Beerus débarque sur Terre pour la détruire
L’histoire reprend celle du dessin animé déjà diffusé depuis janvier en France. Son Goku, le combattant moult fois ressuscité, croyait pouvoir jouir d’une petite retraite comme agriculteur lorsqu’un Dieu de la destruction, Beerus, débarque sur Terre pour la détruire, parce que pourquoi pas. Après un affrontement forcément grandiloquent, il prendra le héros et ses amis sous son aile pour les présenter à un tournoi interdimensionnel contre son frère jumeau, issu d’un autre univers. En toute simplicité.
De ce premier tome, il y a autant à retenir qu’à jeter. Coincé entre des références aux débuts naïfs et légers de la série et ses derniers chapitres ultraguerriers, « Dragon Ball Super » tente un grand écart permanent, et se déchire parfois l’entrecuisse. Les combats, trop courts et d’une imagination très inégale, ont pour l’instant quelque chose d’assez anecdotique. Les plaisanteries, elles, tombent parfois dans une forme d’urophilie dont on n’a pas souvenir qu’elle nous amusait enfant. Le dialogue entre le héros et son mandarin, maître Kaio, à l’arrivée du dieu de la destruction, résume le problème :
« – Oh non… Pas possible… C’est terrible… Quelle calamité !!
– Qu’est-ce qui t’arrive, Maître Kaio ? Tu as fait dans ta culotte ? »
Rires gênés.
Parfois, « Dragon Ball Super » donne l’impression d’une fan fiction aux enjeux narratifs dilués. Il met en scène tant de héros différents qu’aucun n’a le temps d’exister. Les personnages secondaires sont tous écrasés par un Son Goku à la fois lisse et omniprésent. A l’image du tournoi, dans lequel on ne voit que lui, alors que ce rendez-vous scénaristique autrefois majeur et plébiscité était surtout l’occasion de découvrir d’autres protagonistes.
Pourtant, Toriyama et Toyotaro introduisent quelques nouveaux venus hauts en couleurs assez savoureux – même si déjà vus dans certains films et mangas dérivés récents. Beerus, capricieux Dieu de la destruction, à la tête de chat égyptien et au palais gourmand, qui détruirait la galaxie pour une sauce mal dosée.
Bulma, l’adolescente intrépide des tout débuts, incarne également à chaque apparition l’insolence initiée à sa création, et sa courte épopée dans l’espace ressuscite sur quelques pages la fraîcheur et l’inventivité de la période « Dragon Ball ». Le tournoi lui-même – inachevé à la fin de ce tome – réserve quelques surprises. « Voilà, là je te reconnais », pourrait-on se dire en citant l’ultime phrase de ce volume.
Car oui, il y a le plaisir coupable de retrouver l’univers unique et foisonnant d’Akira Toriyama, ce mélange d’humour régressif et de grandiloquence tintamarresque, rencontre improbable entre l’esprit Télétubbies et un spectacle de Muse. Peut-être aussi parce que ce monde-là ne vieillit pas, que la nostalgie préempte assez vite tous les droits sur l’indépendance du jugement, et que désormais quarante-trois volumes plus loin, faibles que nous sommes, on lirait bien le quarante-quatrième.