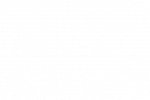Fessenheim ou l’impéritie de l’Etat actionnaire

Fessenheim ou l’impéritie de l’Etat actionnaire
Editorial. François Hollande s’est montré incapable de faire respecter sa promesse de fermer la centrale nucléaire. Comment est-ce possible, alors que l’Etat détient 83 % du capital de cette entreprise publique ?
La centrale nucléaire de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, le 10 avril 2017. | VINCENT KESSLER / REUTERS
Editorial du « Monde ». Dans les annales politico-industrielles françaises, l’interminable saga de la centrale nucléaire de Fessenheim restera comme l’un des meilleurs exemples de l’impéritie de l’Etat actionnaire.
A l’issue d’un conseil d’administration particulièrement houleux, jeudi 6 avril, au cours duquel se sont affrontés représentants de l’Etat d’un côté, administrateurs salariés et indépendants de l’autre, EDF a fini par acter la fermeture des deux réacteurs nucléaires de la centrale du Haut-Rhin. Cette fermeture est cependant assortie de conditions et d’un calendrier tels que le prochain président de la République, celui qui sortira des urnes le 7 mai, aura le loisir de conforter cette décision ou de poursuivre l’exploitation de la doyenne des centrales françaises jusqu’en 2022, le terme fixé par l’Autorité de sûreté nucléaire.
D’un côté, François Hollande voulait donner l’impression qu’il tenait au moins en partie sa promesse de 2012 de fermer le site alsacien durant son quinquennat, ce qui n’est pas le cas. Mais le chef de l’Etat avait aussi intégré dans son raisonnement les exigences du PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, et des cinq administrateurs indépendants, qui exigeaient la garantie que les capacités nucléaires d’EDF ne seraient pas réduites tant que l’EPR de Flamanville (Manche) n’entrerait pas en service. Ce sont eux qui ont eu gain de cause, en obtenant que le décret de fermeture ne soit pas pris avant mi-2018.
De l’autre, Ségolène Royal, la ministre de l’environnement et de l’énergie, voulait concrétiser la fermeture – dès le vote acquis chez EDF – par un décret en bonne et due forme. Devant l’intransigeance des administrateurs indépendants, qui ont ignoré ses pressions jusqu’au bout, Mme Royal a dû se contenter de l’inscription in extremis du caractère « irréversible » et « inéluctable » de cet arrêt.Une pirouette politique, destinée à lui permettre de sauver la face, sans aucune portée juridique.Le dossier Fessenheim n’est donc pas clos.
Comment l’Etat, détenteur de 83 % du capital d’une entreprise publique, a-t-il été incapable, durant cinq ans, de faire respecter une décision prise au sommet du pouvoir ? Les Verts et Greenpeace ont beau jeu de répéter qu’EDF décide d’une partie de la politique énergétique, devant le flottement des positions du gouvernement.
M. Hollande et Mme Royal ont fait voter en 2015 une « loi de transition énergétique pour la croissance verte », qui prévoit notamment de ramener la part d’électricité d’origine nucléaire de 75 % à 50 % à l’horizon 2025. Les Français seraient en droit de penser qu’une inflexion aussi forte, rompant avec cinquante ans d’une politique de quasi « tout nucléaire », se prépare et se gère avec méthode. D’autant plus que l’atome civil est une industrie du temps long : sauf bouleversements majeurs, l’EPR de Flamanville pourrait fonctionner encore… en 2100.
L’objectif de 50 % gravé dans le marbre de la loi, l’arrêt de Fessenheim en appelait d’autres. Preuve des incertitudes sur les lendemains du nucléaire, ce programme de fermetures n’a jamais vu le jour et l’on attend les prochaines. La loi contraint EDF à fermer des centrales ; les dirigeants de l’électricien poussent à l’allongement de leur durée de vie, tout en préparant avec Areva un « EPR optimisé », moins coûteux, pour remplacer le parc ancien. La fin de la décennie sera cruciale : c’est, finalement, au successeur de François Hollande qu’il reviendra de trancher et d’engager l’avenir énergétique de la France.