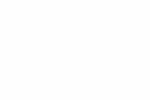Au Rwanda, la réconciliation n’est pas un vain mot

Au Rwanda, la réconciliation n’est pas un vain mot
Par Yann Gwet
L’histoire d’Olivier, rescapé du génocide des Tutsi en 1994, permet à notre chroniqueur de retracer le chemin parcouru par le pays depuis vingt-trois ans.
Jusqu’en 1994, Olivier était un petit garçon comme les autres : il allait à l’école, il jouait au foot avec ses camarades de classe et, le dimanche, il se rendait à l’église de Cyahinda, dans le sud du Rwanda. Pour le petit garçon qu’il était, l’église représentait quelque chose : un sanctuaire, un refuge, un endroit pas tout à fait comme les autres.
Au mois d’avril de cette année-là, son univers bascula. A la radio, les tubes du moment avaient disparu, remplacés par un sinistre refrain, « Tuzabatsemba », qui signifiait : « Nous vous exterminerons et nous vous éradiquerons tous. » Quand les massacres commencèrent, c’est à l’église de Cyahinda que l’adolescent de 14 ans pensa. Il y serait en sécurité.
En journée, il se cachait dans la forêt, bravant la faim, la soif et la peur, priant de tout son cœur pour que cette pluie qui hier l’empêchait de jouer au ballon avec ses amis s’abatte le plus fort possible aujourd’hui et qu’elle entrave l’œuvre des affamés de la mort. La tombée de la nuit apportait l’espoir du mouvement : il pourrait courir, fuir. La pluie était une alliée : elle absorbait tous les bruits.
Lorsqu’il arriva à l’église, ce fut l’horreur : une rivière de sang, un tapis de cadavres d’hommes et de femmes déchiquetés, d’enfants démembrés. Les tueurs étaient impitoyables, quitter le pays était sa seule chance. Alors il trouva refuge sur les longs coteaux de Gasasa et, de là, entouré d’un petit groupe de survivants, il parvint à échapper aux hordes de criminels qui les pourchassaient. Il franchit la frontière burundaise le 22 avril 1994. La veille, le Conseil de sécurité de l’ONU, pourtant au fait de la situation, votait la réduction du contingent des forces de sa mission au Rwanda, la Minuar, à 270 soldats ghanéens, tous volontaires…
Vingt-trois ans après, Olivier se souvient encore de la voix retentissante de Ladislas Ntaganzwa, l’autorité politique de la région, qui, dans un haut-parleur, appelait ses confrères côté burundais à lui renvoyer ces adolescents « paresseux » qui « fuient la famine »…
Thérapie collective
A l’image de beaucoup de Rwandais que je connais, Olivier est plutôt réservé. Son débit est lent, sa voix est douce. Il relate son expérience avec un calme qui déstabilise. On ne sent pas de haine en lui, plutôt une tristesse sourde et une profonde incompréhension. Vingt-trois ans après, il ne comprend toujours pas pourquoi. Qu’a-t-il fait pour mériter un tel déchaînement de haine ? Qu’ont fait les siens pour mourir aussi atrocement ? Et puis comment un homme politique, pourtant censé œuvrer à la concorde générale, a-t-il pu apporter un concours actif à un projet d’anéantissement systématique d’une partie de sa propre population ?
Il a témoigné de son expérience et posé ces questions au cours du « Ndi Umunyarwanda » organisé par le Sénat rwandais, mercredi 5 avril. Il s’agit d’un dialogue institutionnalisé, porté par le gouvernement dans le cadre du programme de réconciliation nationale et de lutte contre l’idéologie génocidaire, et qui donne l’occasion à chaque institution rwandaise d’ouvrir le débat sur la période la plus sombre de l’Histoire du pays et, en même temps, de faire œuvre de thérapie collective.
L’expérience d’Olivier a influencé son rapport aux politiciens. Il nourrit vis-à-vis d’eux une méfiance de principe. Pour beaucoup de Rwandais, le personnel politique était en première ligne dans le désastre de 1994. En parcourant le pays à la fin des années 1990 pour expliquer aux populations ce qu’est une Constitution, l’importance d’en avoir une et les raisons pour lesquelles celle-ci devait sortir des entrailles du peuple (et non du cerveau de constitutionnalistes occidentaux), le sénateur Tito Rutaremara, alors président de la commission chargée de rédiger la première Constitution rwandaise post-génocide, a été surpris par la profonde défiance des populations : « Vous les hommes politiques qui nous avez montés les uns contre les autres, maintenant vous nous demandez d’être unis. Eh bien montrez donc l’exemple ! »
Derrière la dénonciation de la classe politique, il y avait la demande d’une nouvelle manière de faire de la politique. Après le génocide des Tutsi, le peuple rwandais exigeait de l’apaisement, de la stabilité, de la sérénité. De cette aspiration est né un système politique inédit en Afrique. Là où ailleurs la politique est un jeu à somme nulle, ici le consensus est recherché et même imposé. L’unification du pays est impérative.
Un pays sans ethnie
La séance de « Ndi Umunyarwanda » à laquelle a assisté Olivier s’est déroulée sous l’égide de Bernard Makuza, le président du Sénat. Comme l’exige la Constitution, celui-ci, tout comme son homologue de l’Assemblée nationale, n’appartient pas au parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais (FPR). Au cours de ce « Ndi Umunyarwanda », M. Makuza n’a pas hésité à revenir sur l’histoire de son père, ancien président du Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND, parti extrémiste à l’origine de la redoutable milice des Interahamwe) banni après 1994 et mort dans le déshonneur, et sur les humiliations que lui-même a subies à la disparition de celui-ci, lorsqu’il a été identifié à sa mère tutsi.
L’histoire de Bernard Makuza illustre la complexité d’une société qu’il est hasardeux de fragmenter en deux blocs distincts. Historiquement, Tutsi et Hutu se sont toujours mélangés. Le Rwanda est un pays sans ethnie rendu artificiellement « ethnique » par les « bienfaits » tant vantés de la colonisation. Cette réalité d’un peuple uni à l’origine explique l’architecture politique du pays : par exemple, 50 % des membres du gouvernement actuel, à commencer par le premier ministre, sont issus de partis d’opposition. La Constitution est gardienne de l’aspiration des Rwandais au consensus et à la réconciliation.
Oui, la réconciliation. Car pour de nombreux Rwandais, celle-ci n’est pas une option politique, mais une nécessité historique. Ils doivent vivre ensemble, sans quoi, après avoir perdu les leurs, ils pourraient perdre leur pays. Evidemment, de nombreux commentateurs doutent de la réalité de cette « réconciliation ». Il y a quelques jours encore, Le Monde reprochait au président rwandais, Paul Kagamé, d’avoir « décrété qu’il n’y avait plus au Rwanda que des Rwandais, plus de Hutu ni de Tutsi […] comme si l’effacement de ces mentions ethniques sur les cartes d’identité suffisait à effacer les mémoires ». Mais comment contester les efforts d’un gouvernement africain qui forge un projet national sur la ruine de différences artificielles ?
Le vrai est que la question de la réalité de la réconciliation au Rwanda est une fausse bonne question. Le cœur des hommes est insondable et le restera. Ce qui importe, en revanche, ce sont les paroles et les actes des Etats. En d’autres termes, tant que la société rwandaise sera inclusive – et, à ce jour, elle l’est –, alors le processus de réconciliation sera crédible.
Des sillons d’espoir
Vingt-trois ans, c’est à la fois peu pour oublier et beaucoup pour avancer dans la vie. Olivier est resté quelques mois dans un camp de réfugiés au Burundi. La vie y était difficile, mais il avait appris à se satisfaire de peu. Quand est-il rentré au pays ? Il n’en a pas le souvenir : le temps n’avait plus de réalité pour lui. Tout au plus se souvient-t-il d’avoir « écouté l’annonce de la formation d’un nouveau gouvernement, le 19 juillet 1994, sur le sol rwandais ».
Après ses études, il s’est installé à Kigali, où il a postulé à divers emplois. Au bout de quelque temps, il a rejoint un organisme d’Etat. Il y a travaillé dur et a progressé régulièrement. Il y a quelques années, son supérieur lui a dit que le président du Sénat de l’époque cherchait un conseiller et qu’il avait proposé son nom. Conseiller du président du Sénat ? Impensable ! Pourtant, après avoir envoyé son dossier, il a été convoqué à un entretien et a été recruté. « Tu te rends compte ? Je ne le connaissais pas. Je ne l’avais jamais rencontré. Je n’avais pas de réseau. Et pourtant… »
Lorsqu’un nouveau président du Sénat – en l’occurrence Bernard Makuza – a succédé à celui qui avait embauché Olivier, il n’a pas jugé utile de se séparer de lui. Désormais, le mérite prime dans le pays. Tant qu’il est performant, Olivier ne craint rien : « Je n’ai pas de relation personnelle avec le président du Sénat. J’arrive, je fais ce que j’ai à faire et je rentre chez moi. C’est ça le Rwanda aujourd’hui… »
Vingt-trois ans après, la douleur est toujours là. La pluie aussi. Quand elle tombe, les images de la rivière Akanyaru, entre le Rwanda et le Burundi, dont le niveau avait augmenté à l’époque et qui charriait des centaines de corps sans vie, reviennent hanter l’homme que le petit garçon est devenu. Mais elle tombe sur une terre différente et trace des sillons d’espoir. Pour Olivier comme pour le Rwanda, un jour nouveau s’est levé.
Yann Gwet est un essayiste camerounais.