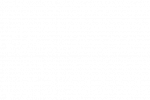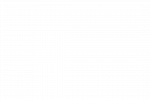Faute d’accord politique, les manifestations s’intensifient au Venezuela

Faute d’accord politique, les manifestations s’intensifient au Venezuela
Par Paulo A. Paranagua (Caracas, envoyé spécial)
Les opposants au gouvernement Maduro continuent de réclamer la tenue d’élections générales, la libération des prisonniers politiques et le respect des attributions du Parlement.
Depuis le palais présidentiel de Miraflores, le ministre vénézuélien de l’intérieur, le général Nestor Reverol, a déclaré, lundi 10 avril, que le Venezuela était « tout à fait tranquille ». « Continuons tous et toutes à construire la patrie socialiste et humaine que nous voulons », a ajouté le sulfureux général, accusé par Washington, du temps de Barack Obama, de tremper dans le trafic de drogue.
Le même jour, le président, Nicolas Maduro, est, lui, parti à La Havane, où il a reçu le soutien de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, soudée à force de pétrole vénézuélien fourni à prix d’amis. Aux côtés de son homologue cubain, le général Raul Castro, il s’est dit victime d’une « conspiration de la droite » destinée à ouvrir la voie à une « invasion américaine », comme en Libye ou en Irak.
Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, aux côtés du président cubain, Raul Castro, à La Havane, lundi 10 avril. | YAMIL LAGE / AFP
La veille, dans son programme de télévision dominical, Nicolas Maduro a défié l’opposition en disant qu’elle serait écrasée lors des prochaines élections de gouverneurs des Etats et qu’il en profiterait alors pour « radicaliser la révolution bolivarienne ». Or, ce scrutin, prévu en 2016, avait été suspendu sine die par le pouvoir afin d’éviter toute déroute électorale. Alors que les chavistes contrôlent 21 des 24 Etats, les sondages laissaient présager un raz-de-marée de l’opposition, ce qui aurait sans doute affaibli le gouvernement.
Fixer un calendrier et libérer les prisonniers politiques
L’une des exigences des opposants et de la communauté internationale, de plus en plus préoccupée par la situation dans le pays, est justement le respect ou le rétablissement d’un calendrier électoral. Face à l’échéance de la présidentielle de décembre 2018, les autorités ont commencé à préparer le terrain, en éliminant de la course les opposants les plus populaires. Henrique Capriles Radonski, deux fois candidat à la présidence de la République, d’abord contre Hugo Chavez puis contre Nicolas Maduro, a été privé de ses droits politiques pendant quinze ans le 7 avril. Leopoldo Lopez, lui, est dans une prison militaire depuis plus de trois ans.
Mardi, le vice-président de l’Assemblée nationale (contrôlée par l’opposition), Freddy Guevara, a annoncé que les opposants continueraient à manifester jusqu’à obtenir des élections générales, la libération des prisonniers politiques et le respect des attributions du Parlement. Il a promis, pour le 19 avril, « la mère de toutes les manifestations ».
L’une des manifestations des opposants au gouvernement Maduro, à Caracas, samedi 8 avril. | CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS
Le général Miguel Rodriguez Torres, ancien ministre de l’intérieur de Maduro, a demandé, lui aussi, « un chronogramme électoral » pour « éviter la violence de la rue ». « Avec les élections régionales et municipales, nous commencerions à avancer vers une ré-institutionnalisation, dans le cadre de la Constitution, a-t-il précisé. Pour surmonter la crise, il faut réconcilier le pays. » Des mots apaisants de la part du ministre qui a mené la répression contre les protestations de 2014, qui s’étaient soldés par 43 morts. La procureure générale qui avait à l’époque couvert les forces de sécurité, Luisa Ortega, vient d’exprimer publiquement son désaccord avec la tentative de la Cour suprême de s’arroger les attributions de l’Assemblée nationale. Le général Rodriguez Torres, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, aspire à attirer les chavistes attachés à la défense de l’Etat de droit.
Répression par des collectifs paramilitaires
Cependant, dans les rues de la capitale comme en province, c’est l’escalade. Amnesty International et les défenseurs vénézuéliens des droits de l’homme dénoncent « l’usage excessif de la force ». Les autorités refusent tout accord préalable avec les dirigeants de l’opposition sur le trajet des manifestations.
Le centre-ville de la capitale, dans lequel se trouve l’Assemblée nationale, est interdit aux opposants. Trois manifestations d’une ampleur croissante se sont succédé dans la capitale les 4, 6 et 8 avril : samedi, les photos aériennes montraient une foule compacte de dizaines de milliers de personnes. En face d’eux, des milliers de personnes ont aussi défilé dans les rues de la capitale mardi, mais pour soutenir le président Maduro.
La crise au Venezuela expliquée en quatre minutes
Durée : 03:58
Les choses se gâtent lorsque les manifestants de l’opposition prétendent se rendre au centre-ville, « zone rouge » réservée aux seuls chavistes. Lundi 10 avril, les forces policières n’ont pas attendu la formation d’un cortège ; elles ont attaqué le premier rassemblement et poursuivi les opposants jusqu’à Palos Grandes, quartier de Caracas jusqu’alors préservé des heurts. Des bombes lacrymogènes ont été larguées depuis des hélicoptères, ce qui a ému le défenseur du peuple (une sorte de médiateur), Tarek William Saab, pourtant acquis au régime. Rafael Uzcategui, coordinateur de l’organisation de défense des droits humains Provea, déplore que « les Vénézuéliens victimes de brutalités policières n’aient pas de recours pour demander justice ».
Outre la police et la gendarmerie, le pouvoir utilise des « collectifs » armés et souvent motorisés pour attaquer les protestataires. Selon une investigation du quotidien El Nacional, ces collectifs obéissent à une chaîne de commandement au plus haut niveau. Loin d’être de simples chavistes extrémistes, ce sont de véritables groupes paramilitaires ou parapoliciers qui agissent en toute impunité. En 2014, c’est pour avoir tenté de leur mettre le holà que le général Rodriguez Torres avait été renvoyé du ministère de l’intérieur.
Phil Gunson, analyste de l’ONG International Crisis Group basée à Caracas, pense qu’il faut envisager « une solution négociée de la crise, avec un gouvernement de transition capable de rétablir l’Etat de droit et la stabilité économique ». Jusqu’à présent, les médiations diplomatiques n’ont donné aucun résultat. Le gouvernement ne se sent pas assez acculé pour accepter une véritable négociation. A l’exception du Parlement, il dispose à sa guise des quatre autres pouvoirs, sans oublier l’argent public et la force des armes.
Le risque d’une « dislocation à la russe »
Jesus « Chuo » Torrealba, l’ancien secrétaire exécutif de la Table de l’unité démocratique (MUD), la coalition électorale des opposants, admet que la perspective d’une issue négociée n’est pas très attirante pour l’opinion publique, excédée par les difficultés économiques et l’arrogance du régime.
Pour les jeunes radicalisés qui affrontent les policiers, cette idée est inaudible. « Pourtant, ne pas discuter du modèle de transition, de la nécessité d’un gouvernement d’union nationale et des formes de reconstruction de l’économie serait un suicide politique, affirme M. Torrrealba. Si le chavisme est en phase terminale, nous ne pouvons pas proposer à nos concitoyens un saut vers l’inconnu. »
Cet opposant est parfaitement conscient de l’hétérogénéité de la MUD, mais fait confiance au processus des primaires pour éviter les disputes d’ego et la concurrence entre candidats. Toutefois, il n’y aura pas d’élections libres sans une négociation préalable. « Si l’alternative à l’implosion du chavisme n’est pas l’opposition, l’Etat vénézuélien risque une dislocation à la russe, avec des oligarques et des militaires qui détiennent les leviers économiques soutenus par les mafieux du crime organisé qui contrôlent déjà un tissu social en décomposition », assure M. Torrealba.
« Chuo » sait de quoi il parle : depuis onze ans, il anime une émission radiophonique produite dans les « barrios », les quartiers populaires de Caracas. Ceux-ci sont les principales victimes de l’explosion de la criminalité, avec 21 752 homicides en 2016, selon la procureure générale Luisa Ortega.