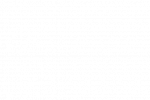Henrique Capriles Radonski : « Le gouvernement de Maduro est une dictature du XXIe siècle »

Henrique Capriles Radonski : « Le gouvernement de Maduro est une dictature du XXIe siècle »
Propos recueillis par Paulo A. Paranagua (Caracas, envoyé spécial)
Au Venezuela, le gouverneur de l’Etat de Miranda, candidat de l’opposition pour la présidentielle de 2018, s’est vu privé de ses droits politiques.
Le leader de l’opposition vénézuelienne, Henrique Capriles (au centre), lors d’une manifestation à Caracas, le 8 avril. | CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS
Les manifestations contre le président, Nicolas Maduro, s’intensifient au Venezuela. Pour la première fois, la contestation a gagné les quartiers populaires de Caracas, où le régime puise pourtant son appui politique et social.
Henrique Capriles Radonski, deux fois candidat de l’opposition à la présidence, est le gouverneur de l’Etat de Miranda, dans la périphérie de la capitale. Le 7 avril, il s’est vu privé de ses droits politiques pendant quinze ans, suscitant un tollé. Il semblait le candidat le mieux placé pour assurer l’alternance lors de la présidentielle de décembre 2018, vingt ans après la première élection de l’ancien président Hugo Chavez (1999-2013).
Quels sont les motifs invoqués par la Cour des comptes pour vous priver de vos droits politiques ?
Par une décision discrétionnaire, on m’interdit d’exercer toute fonction publique pendant quinze ans, à la suite d’une amende de 10 dollars ! C’est contraire à la Constitution. En 2011, la Commission interaméricaine des droits de l’homme avait d’ailleurs demandé de mettre un terme au pouvoir de la Cour des comptes de casser les droits politiques. Seule une condamnation d’un tribunal, confirmée en appel, peut priver quelqu’un de ses droits. Or, il n’y a aucun procès judiciaire ouvert contre moi, encore moins de sentence.
Que vous reproche-t-on ?
L’Etat de Miranda, dont je suis le gouverneur, a reçu deux donations des ambassades de Pologne et du Royaume-Uni. La première pour aménager un terrain de sport, la seconde pour un programme scolaire sur la justice et la paix. Ce n’est ni irrégulier ni illégal. Cette décision montre à quel extrême est arrivé le président, Nicolas Maduro. Il veut m’empêcher d’être candidat à la présidence de la République en 2018, alors que je suis la principale option de l’opposition.
Maduro et son entourage ne veulent pas d’élections, mais au cas où ils y seraient obligés, ils préparent le terrain pour avoir face à eux l’opposant de leur choix. La France et la communauté internationale se sont élevés contre mon interdiction. Même si le gouvernement contrôle tous les pouvoirs, à l’exception du Parlement, je vais épuiser les recours. Il ne réussira pas à briser notre moral ni à empêcher une alternance.
Quel regard portez-vous sur la crise vénézuélienne ?
Le Venezuela vit une nouvelle étape historique. L’ancien président Hugo Chavez prétendait construire le « socialisme du XXIe siècle ». En 2016, par son refus d’un référendum révocatoire prévu dans la Constitution, son blocage de l’Assemblée nationale, où l’opposition est majoritaire, et la suspension des élections, le gouvernement Maduro est devenu une dictature du XXIe siècle, différente de celles que l’Amérique latine a connues dans le passé. Refuser de se soumettre au suffrage universel marque une rupture décisive. Sans vote, sans élections libres, il n’y a pas de démocratie.
Le pouvoir a perdu les législatives de décembre 2015, il sait qu’il est désormais impopulaire et minoritaire dans l’électorat. Mardi 11 avril, lorsque Maduro est allé à San Félix, dans l’Etat de Bolivar, il a été accueilli par une pluie d’œufs. Toutes les chaînes transmettaient la scène en direct ; la télévision a coupé la retransmission, mais pas assez vite pour éviter que la séquence ne devienne virale sur les réseaux sociaux. Je connais cette région, elle est très populaire.
Malgré la répression, les opposants et les mécontents continuent à s’exprimer avec fermeté. On ne manifeste plus sous des airs de musique, comme si c’était une fête, mais avec gravité et dignité. A Caracas, les rassemblements ont lieu dans l’est de la métropole, parce que c’est la seule zone où l’on peut se réunir. Mais les gens viennent désormais aussi bien des quartiers résidentiels de classe moyenne que des « barrios » pauvres. Mardi soir, on a entendu des protestations à Petare et dans d’autres quartiers populaires. Le malaise s’étend aux forces armées, même si je ne crois pas à une solution militaire ; tous les coups d’Etat sont mauvais. Mais l’exigence d’élections, la défense du droit de vote nous concernent tous.
La crise au Venezuela expliquée en quatre minutes
Durée : 03:58
Pensez-vous qu’il y aura une issue négociée ?
La négociation et le dialogue sont l’essence de la politique. On devrait se mettre d’accord sur une solution à la crise institutionnelle, économique, humanitaire. Exiger le droit au suffrage universel pour surmonter l’impasse résume notre démarche. Si des élections pour les postes de gouverneurs et de maires se tiennent cette année, il y aura un raz-de-marée de l’opposition.
La perte de 20 des 24 Etats et de 200 des 335 municipalités du pays provoquerait une hémorragie dans les cercles du pouvoir. La situation deviendrait insoutenable pour le gouvernement Maduro. A la limite, ce serait pire que des élections générales avançant la date de la présidentielle, prévue en décembre 2018. Mais Maduro manque de finesse politique, il est arrogant, il roule des mécaniques et menace, il n’a pas de personnalité, il imite la façon de parler de Hugo Chavez. Les chavistes eux-mêmes se rendent compte de l’imposture, il n’arrive pas à la cheville de Chavez.
Quel serait l’ordre du jour d’une négociation ?
Nous ne demandons ni le palais présidentiel de Miraflores ni la solution de la crise économique en une semaine… Nous voulons des élections libres, sans candidatures interdites, la libération des prisonniers politiques, la création d’un canal humanitaire pour soulager la population face aux pénuries d’aliments et de médicaments et le respect des attributions de l’Assemblée nationale.
Comment envisagez-vous le changement ?
Je crois qu’il faudra former un gouvernement d’unité nationale, capable de rétablir l’Etat de droit et de relancer l’économie, avec des personnes qualifiées de l’opposition, mais aussi du chavisme, à condition qu’elles ne soient compromises ni avec la corruption ni avec le chaos actuel. Dans l’Etat de Miranda, j’ai signé la nomination de chavistes comme directeurs d’écoles, parce qu’ils avaient la qualification requise. Nous ne pouvons pas tomber dans le sectarisme, l’apartheid politique en vigueur aussi bien dans l’administration publique que dans la distribution d’aliments.
Il faut rendre confiance aux acteurs économiques, aux entrepreneurs et aux travailleurs, aux paysans et aux commerçants. Il faut donner des garanties aux investisseurs étrangers et recourir aux fonds multilatéraux destinés à secourir les pays en cas de catastrophe comme celle ayant court au Venezuela. Les priorités sont l’alimentation, la santé et la sécurité, avec une réforme des forces policières et de la justice. Le Venezuela a une position stratégique, privilégiée. Avant, l’aéroport accueillait des avions à destination de l’Europe et des Etats-Unis, avec plusieurs vols par jour. Le Concorde reliait Paris et Caracas. Maintenant, la plupart des compagnies ne viennent plus, nous nous sommes isolés du reste du monde.
Des chavistes ont prétendu que vous étiez impliqué dans le scandale de l’entreprise brésilienne Odebrecht ?
Il suffit de vérifier les contrats pour se rendre compte qu’ils ont été signés du temps de mon prédécesseur au gouvernorat de Miranda, le chaviste Diosdado Cabello, pour la construction du métro à Los Teques [la capitale de l’Etat]. Je n’ai jamais eu affaire avec Odebrecht. Cette entreprise était la cagnotte de Chavez, qui lui a attribué, sans appel d’offres, tous les grands chantiers du Venezuela, comme le pont sur le lac Maracaibo ou sur le fleuve Orénoque.
Aucun autre pays n’a reçu autant de pots-de-vin d’Odebrecht, pour des travaux souvent inachevés. L’homme de paille du vice-président Tarek El Aissami a payé cash une maison de 17 millions de dollars (16 millions d’euros) en Floride, produit du blanchiment de l’argent de la drogue. Le chavisme a implanté un capitalisme mafieux.