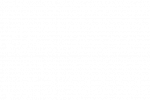Les salariés de Tati se mobilisent à Barbès

Les salariés de Tati se mobilisent à Barbès
Par Pierre Bafoil
Les salariés de Tati ont manifesté devant le magasin historique de la marque, boulevard Barbès, à Paris. Inquiets pour leurs emplois, ils dénoncent un manque d’implication politique.
Devant le Tati du boulevard de Barbès, les vendeurs à la sauvette ont laissé place aux salariés de l’enseigne emblématique du 18e arrondissement de Paris, rassemblés à l’appel de la CGT. Dans la foule cernée par les caméras et les micros, les visages sont crispés.
« On nous ment depuis le début, ce sont nos emplois qui sont en jeu, annonce d’emblée une vendeuse. J’ai 59 ans, je suis à deux ans de la retraite. Qu’est-ce qu’on va faire ? Et que vont faire les plus jeunes ? On est 1 300 salariés à être menacés. » En effet, la marque Tati a été déclarée en cessation de paiement le 28 avril. Xavier et Luc Biotteau, à la tête du groupe Eram, propriétaire de l’enseigne à bas prix, ont décidé de s’en séparer. Le tribunal de commerce de Bobigny a décidé le placement en redressement judiciaire de l’enseigne.
« On ne nous a rien dit, on est dans le flou, on n’a aucune information, déclare Nicole Coger, déléguée syndicale CGT chez Tati. Des licenciements, il y en aura, nous ne sommes pas dupes. On veut savoir combien et quand. » Sept repreneurs se sont positionnés, mais c’est l’offre de l’enseigne Gifi qui retient l’attention des salariés. « C’est le seul qui veut bien nous reprendre sans démanteler Tati, et avec peu de licenciements, estime Mme Coger. Mais Eram veut faire de l’argent et la découpe [vente d’une partie d’un groupe] ça rapporte plus. »
"Nous sommes peut être des caissières, mais nous sommes des gens respectueux. Nous voulons des réponses"Nicole Coge… https://t.co/XbTt84lcHy
— BafoilP (@Pierre Bafoil)
« On est bien, on veut rester »
Tous les salariés rassemblés ont bien conscience que c’est une question de temps. Adossée à la grille baissée du magasin, Sylviane, 53 ans, annonce qu’elle est « perdue ». Ses collègues autour d’elle hochent la tête. « Je suis arrivé ici en septembre 1981 », explique-t-elle. « Moi en 1983 », enchérit une autre. « Moi 1990 », glisse une autre. « La plus jeune ici, c’est cinq ans d’ancienneté », raconte Jamila, 42 ans. « C’est la preuve qu’on est bien et qu’on veut rester », lâche en riant Rabiaa, arrivée il y a dix ans sur le site de Barbès.
Dans l’immédiat, les trois copines sont inquiètes parce que leur paye du mois d’avril n’a pas été versée. « Le 11 ils ont dit, mais on ne sait pas trop comment on va faire avec les enfants ! » Toutes trois sont mères de famille monoparentale, comme la plupart des employées du Tati Barbès. Et la plupart ont dépassé la quarantaine. « Personne ne va nous réembaucher si on est licenciée, craint Sylviane. On n’a reçu aucune formation, on n’a rien. »
A défaut de maintenir leur emploi, elles espèrent au moins avoir des indemnités de licenciement conséquentes. « J’aimerais partir avec une indemnité à hauteur de mes trente-six ans d’ancienneté, pour ne pas me retrouver à la rue sans rien », demande Sylviane. Nicole Coger, la déléguée syndicale, a calculé ce qu’elle toucherait en cas de licenciement. Avec vingt-huit ans d’ancienneté, elle recevra à peine 10 000 euros. « Il me reste dix ans au moins avant la retraite, je ne peux pas tenir avec ça. »
Si Barbès tombe, tout tombe
Devant le Tati de Barbès, il y a des salariés de tous les magasins parisiens de l’enseigne rose. « Enfin pas tous, parce que certains chefs ont fait du chantage, assure une employée du Tati de Stains (Seine-Saint-Denis). Mais si on s’est réuni ici, c’est symbolique, c’est la maison historique. » Beaucoup pensent que si « Barbès tombe, tout tombe ».
« Même pour le quartier, c’est important, affirme Ampano Isidoro, salariée depuis quarante ans au Tati Barbès. Les gens, quand ils viennent ici, ils vont voir aussi les magasins à côté, ça fait vivre tout le monde. » La femme d’une cinquantaine d’années a les yeux brillants de rage. « Et la police ? Eux aussi sont mal si on part, on les informe sur ce qu’il se passe ici, et il s’en passe des choses », précise-t-elle.
Sylviane, Jamila et Rabiaa assurent tenir au Tati Barbès : « On est chez nous ici, on y est bien. » Avec cette mobilisation, elles espèrent faire un peu de bruit. « Si on fait la grève, c’est pour être écoutés et entendus, explique Sylviane. Parce que personne ne parle de nous. » La référence au débat de la veille est claire. « Aucun des deux n’a parlé de nous hier, déplore-t-elle. A part s’insulter, ils n’ont pas fait grand-chose. » Ses deux collègues acquiescent, la mine déconfite, un peu consternées. « Whirlpool, ils sont quelques centaines et les deux candidats se sont déplacés, remarque une autre salariée qui vient d’arriver. Ici on est plus d’un millier, et pourtant il n’y a personne. »
La présidentielle dans toutes les têtes
La présidentielle est évidemment dans toutes les têtes. Et que ce soit l’un ou l’autre des deux candidats qui gagne ne rassure pas les salariés. Sylviane, elle, a fait son choix : « Macron, il ne fera rien et Marine Le Pen… » Elle s’interrompt en écarquillant les yeux. C’est décidé, elle ira voter blanc. « Pour ce que ça va changer… » Une autre en est sûre « Avec Macron, ça sera la loi travail puissance dix, on va tous être sur le carreau ».
Pour autant, nombre d’entre eux votera le candidat d’En marche !. « Contrairement à Marine Le Pen, ce n’est pas lui qu’on combat, c’est son programme. Mais il est inquiétant son programme », lâche Boris, un militant CGT venu soutenir le mouvement.
Plusieurs personnalités politiques sont venues voir les salariés en grève et passent à tour de rôle au micro. La féministe Caroline De Haas, Ian Brossat, élu PCF à la mairie de Paris ou encore le candidat malheureux à l’élection présidentielle, Philippe Poutou, veulent montrer leur soutien aux salariés de Tati devant les journalistes venus en masse. « Mais Macron, il est où ? », crie quelqu’un dans la foule. Une salariée glisse à une autre : « Aujourd’hui il y a des caméras, mais demain ? »
Sylviane regarde l’enseigne dans laquelle elle a passé trente-six ans, l’air angoissé. « On est bien ici, je n’habite pas dans le quartier, mais c’est l’âme de Barbès. » Elle habite en Seine-et-Marne et fait une quarantaine de minutes de transport tous les jours. En souriant tristement, elle confie : « Vous savez, moi je me fiche du trajet, au moins je vais au boulot. »