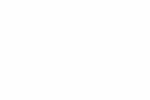Cyclisme : avec Aru le Sarde et Nibali le Sicilien, le Tour d’Italie redécouvre ses îles

Cyclisme : avec Aru le Sarde et Nibali le Sicilien, le Tour d’Italie redécouvre ses îles
Par Clément Guillou
Le 100e Giro part vendredi de Sardaigne, avant de passer par la Sicile. Une excursion rare chez ces parents pauvres du cyclisme italien, qui ont pourtant vu naître ses deux champions actuels.
Lorsque le Giro, le Tour d’Italie cycliste, se souvint, en 1930 puis en 1949, que le pays comptait aussi des îles, s’y rendre était encore une aventure. Lors de ces deux éditions, des ferrys mirent cap sur la Sicile, emportant dans leurs ventres les bicyclettes et leurs propriétaires, les voitures suiveuses et les camions publicitaires, les médecins et les embrocations, les commissaires de course et les chroniqueurs.
Parmi eux s’était glissé, pour le Tour d’Italie 1949, l’écrivain Dino Buzzati, au service du Corriere della Sera*. A bord du Saturnia, il se plaisait à imaginer les derniers moments de tranquillité des coureurs, que seul un départ insulaire pouvait offrir :
« Ils dorment, les champions, savourant la douceur de cette nuit si confortable et raffinée, bercés par les mille voix du navire qui, aux heures les plus avancées, se mettent à raconter de merveilleuses histoires d’océans, de baleines, de gratte-ciel, d’amours exotiques, de villes lointaines aux noms trop difficiles à prononcer. (…) Cette nuit, il n’y a que cette immense avenue, au milieu de la mer, sans trous ni parapets ni montées, qui ressemble à un tapis douillet que la proue du navire découpe avec une étonnante facilité, comme s’il ne s’agissait que de soie, sans que les mollets soient contraints de le pousser à coups de pédale. »
Soixante-huit ans plus tard, les sièges compacts des compagnies aériennes invitent moins à la rêverie et organiser un passage par les îles ne relève plus du défi logistique. A l’occasion de la 100e édition qui s’élance vendredi 5 mai, les organisateurs du Giro ont pour la première fois réuni les deux îles du pays, Sardaigne et Sicile : d’Alghero à Messine, les coureurs passeront une semaine au large avant de retrouver le continent.
Un drapeau sarde flotte devant le podium de présentation du 100e Giro, sur lequel se tiennent les coureurs d’AG2R Ben Gastauer et Alexandre Geniez. | LUK BENIES / AFP
« Toute l’Italie veut vous voir, vous admirer »
Pour cette centième, le directeur de la course, Mauro Vegni, souhaitait un parcours « qui rende visite à autant de régions d’Italie que possible pour célébrer la course, l’histoire de l’Italie et celle du Giro ». Un écho à l’éditorial de La Gazzetta dello Sport, le journal organisateur, qui clamait le matin du premier départ, le 13 mai 1909 : « Toute l’Italie veut vous voir, vous admirer. »
Longtemps, ce ne fut pas le cas. Le Giro d’Italia, qui aurait pu œuvrer à la construction d’une identité nationale dans un pays aux régionalismes puissants, à une époque où le cyclisme devançait encore le football dans les cœurs, a très longtemps regardé le Sud avec dédain. Il trouvait dans le Nord tout ce dont il avait besoin : des montagnes, des routes en bon état, des municipalités riches.
Pas plus que les régions du Mezzogiorno, les îles n’avaient d’argent pour accueillir le Giro. La Sicile et la Sardaigne restèrent longtemps privées de la course nationale, une anomalie d’autant plus frappante que l’Italie moderne est née du royaume de Sardaigne. Il fallut le centenaire de l’unité italienne pour que le Giro y mette les roues, en 1961.
Giro d'Italia 1961 / Il Film
Le grande partenza de Sardaigne sera le quatrième passage du Giro dans l’île, qui s’est parée de rose, la couleur de la course, pour le recevoir. Un honneur autant qu’un rappel utile de son appartenance à la nation, estime l’écrivain Marcello Fois dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : « La Sardaigne, c’est l’Italie : cela peut sembler banal et élémentaire, mais ce n’est pas toujours le cas. Cette fois, nous faisons partie de l’Italie parce qu’il y a le Giro : nous sommes un très bel élément de la nation, mais le Giro ne peut pas être la seule raison de revendiquer cette place que les Sardes n’ont pas réussi à se faire. »
Aru, « Il Cavaliere dei Quattro Mori »
Son confrère Gianni Mura, écrivain et journaliste à La Reppublica de Milan, ne s’attend pas à voir flotter beaucoup de drapeaux italiens au bord des routes du Giro, sur les côtes est et nord de l’île : « Un peu comme les Corses, les habitants de la Sardaigne se sentent un peu soumis et aiment faire de grands rappels à leur indépendance. Leur immense plaisir, qui les a remboursés d’un siècle d’oppression, reste le scudetto [titre de champion] du Cagliari de Gigi Riva en 1970. »
X questa volta devo guardare i miei compagni da qui, comunque emozionante #TeamPresentation tra la mia gente!… https://t.co/oIcLb5rtnT
— FabioAru1 (@Fabio Aru)
Depuis les buts de Riva, les succès de sportifs sardes ont été rares. Fabio Aru a comblé un vide. Troisième du classement final du Tour d’Italie en 2014, puis deuxième l’année suivante, et enfin vainqueur du Tour d’Espagne en septembre 2015. Sur le podium, il se parait du drapeau sarde aux quatre têtes de maures, dont lui vient son surnom : « Il Cavaliere dei Quattro Mori ».
Fabio Aru s’est blessé à l’entraînement en préparant le Giro, mais il était présent à Alghero jeudi 4 mai, pour la présentation des équipes. | LUK BENIES / AFP
Que le plus grand espoir du cyclisme italien soit natif de Sardaigne a sans doute beaucoup joué dans l’organisation du grand départ sur l’île. Blessé, il ne pourra finalement courir le Giro, mais il a tenu à se rendre en civil à Alghero.
Avant Aru, seuls sept Sardes avaient pris le départ du Giro, signe du rapport distant entre l’île et la bicyclette. Des années 1950 à 1970, deux courses professionnelles y ont entretenu la présence cycliste dans l’île, par la volonté d’un passionné, Franco Pretti. Placées en début de saison, elles attiraient de grands noms – Jacques Anquetil, Hugo Koblet ou Eddy Merckx au palmarès – mais disparurent dans les années 1980. Leur brève renaissance, en 2010 et 2011, a fait long feu. Quant au cyclisme amateur, il y est presque inexistant, malgré les lieux d’entraînement paradisiaques et le soleil qui invite à la balade.
« Le chemin de la gloire, c’est vers le nord »
« C’est difficile pour un coureur sarde d’atteindre le haut niveau, car il doit beaucoup se déplacer sur le continent pour les courses et rester loin de sa famille », observe le grimpeur d’AG2R-La Mondiale, Domenico Pozzovivo. Natif de Basilicate, dans le sud de la Botte, Pozzovivo a été confronté au même dilemme que Fabio Aru à l’adolescence : « Partir très jeune pour essayer de faire carrière, car les grandes équipes amateurs sont dans le Nord. »
Fabio Aru s’est exilé en Lombardie à 18 ans, laissant derrière lui le verger familial et les rues en pente de Villacidro. Vincenzo Nibali a, lui, quitté la Sicile pour la Toscane avant la majorité. De Messine, où il est né de parents modestes commerçants, le continent n’est qu’à un court trajet de traghetto. « Mais en Calabre, il n’y a pas de courses non plus. Le chemin de la gloire, c’est vers le nord », insiste Gianni Mura. Et les trajets coûtent cher.
Vincenzo Nibali (à droite) et son coéquipier Valerio Agnoli lors de la présentation des équipes, jeudi 4 mai à Alghero (Sardaigne). | LUK BENIES / AFP
Raison pour laquelle la Sicile a produit à peine plus de coureurs que sa voisine, malgré la présence plus fréquente du Giro sur ses routes. La région, influencée par les succès de Vincenzo Nibali – deux Tours d’Italie, un Tour de France, un Tour d’Espagne –, a pourtant tenté de pousser à la roue, en offrant des subventions automatiques aux clubs cyclistes.
Un véritable âge d’or : il y a quelques années, on comptait jusqu’à 400 équipes dans l’île. Mais la plupart n’ont jamais vu la couleur d’un dossard et servaient uniquement à encaisser les subventions. Depuis l’arrêt de cette politique, leur nombre a été divisé par quatre et la fédération locale a été mise sous tutelle de la Fédération italienne de cyclisme.
Bien qu’ils aient grandi hors de leur île, Aru et Nibali restent des leviers puissants pour le développement du cyclisme sur place, le premier organisant une cyclosportive en Sardaigne, le deuxième soutenant un club à son nom à Messine. Pour le financement, en revanche, les deux hommes ont passé leur tour : tous deux sont résidents fiscaux de Lugano.
* L’intégralité de ses chroniques viennent d’êtres traduites en français par les éditions So Lonely (175 pages, 14 euros).