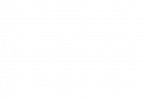Fausse agression aux Restos du cœur de Montreuil : un prévenu incohérent

Fausse agression aux Restos du cœur de Montreuil : un prévenu incohérent
Par Cécile Bouanchaud, Romain Ouertal
Six mois de prison ont été requis jeudi à Bobigny contre un gérant bénévole, accusé d’avoir inventé de toutes pièces une agression islamiste à la hache et au couteau.
Dans la 14e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny, alors que se succèdent dans l’indifférence générale les affaires de droit commun, jeudi 11 mai, Richard S., quinquagénaire à l’allure bien mise, attend son tour avec un calme teinté de désinvolture. C’est ce même calme qui avait marqué les pompiers, le 1er juillet 2016, lorsqu’ils l’avaient retrouvé au petit matin avec un couteau dans le ventre, dans le local des Restos du cœur de Montreuil (Seine-Saint-Denis).
Aux enquêteurs, le responsable de l’association à l’apparence bonhomme avait raconté avec force les détails de son agression par un couple armé d’une hache et d’un couteau, au cri d’« Allah Akbar ». L’affaire, survenue en pleine période de menace djihadiste en France, avait eu une forte résonance médiatique. Mais les moyens colossaux déployés pour l’enquête allaient rapidement mettre au jour les incohérences de cet homme, accusé d’avoir inventé de toutes pièces une agression islamiste. Ce qu’il nie encore aujourd’hui.
« Aucun élément de sa version n’a pu être vérifié », car « ça ne s’est pas passé », a tranché la procureure, qui a demandé au tribunal de prononcer six mois de prison à l’encontre de Richard S., la peine maximale prévue par le code pénal pour « dénonciation de crime ou délit imaginaire ».
« Soutenir une version imaginée devant des policiers, puis un tribunal, c’est manquer de respect à toutes les victimes d’attentat. Leur voler leur souffrance. Et contribuer à créer une ère du soupçon. »
Incohérences
Pourtant, le récit que déroule Richard S. à la barre n’incite guère aux soupçons, tant il est dense et détaillé. Un vendredi matin d’été, raconte-t-il, vers 7 heures, un homme « de type africain » et une « femme voilée » débarquent dans les locaux de l’association, armés d’une hache et d’un couteau. S’ensuit « une scène de combat », durant laquelle la femme lui plante le couteau dans le ventre. Le bénévole assure avoir essuyé plusieurs coups, avant de parvenir à faire fuir ses agresseurs et à appeler les secours. A leur arrivée, les pompiers constatent deux plaies dans le thorax, en plus du couteau dans le ventre. Ses jours sont en danger.
Au fil de l’interrogatoire du prévenu à la barre, les détails distillés révèlent les incohérences de son récit. Comme au sujet de cette femme voilée, qu’il assurait aux enquêteurs pouvoir reconnaître, et dont il dit aujourd’hui qu’il ne voyait que les yeux. Ou la scène de combat à laquelle il s’est livré, à grand renfort de coups de pied et de coups de balai, alors que Richard S. est déclaré invalide à 79 % depuis un accident de voiture survenu en 1993. Et, surtout, cette hache, l’une des armes de l’agression, sur laquelle l’ADN de sa compagne a été retrouvée.
Autant d’éléments qui font vaciller la version du prévenu, forcé de réviser son récit, au gré des questions posées par la présidente. Lui, qui avait assuré aux enquêteurs qu’il n’avait aucune idée de la provenance de cette hache, déclare aujourd’hui : « Elle était chez moi et je l’ai ramené aux Restos du cœur parce qu’elle serait plus utile là-bas. » Et d’ajouter devant une présidente incrédule : « Elle fait partie d’un lot d’outils, qui nous a été volé, trois ou quatre mois avant l’agression. »
« Pourquoi ne pas avoir porté plainte au moment du vol ? », l’interroge la présidente, rappelant que le prévenu est pourtant coutumier des mains courantes. « Pourquoi ne pas en avoir parlé aux enquêteurs ? », ajoute-t-elle. Parce qu’on ne lui a « pas demandé », lui répond sans ciller l’homme au visage rond comme ses lunettes, sous-entendant par là que l’enquête a été bâclée.
Banal
La présidente rappelle alors « les moyens colossaux mobilisés » pour cette affaire, confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle. Une « équipe d’élite » qui s’est attelée à interroger bénévoles, voisins, facteurs, chauffeurs de bus, ouvriers proches des locaux. Tous assurent d’une même voix ne jamais avoir vu la trace de ce couple d’agresseurs présumés. Des témoignages corroborés par les caméras de vidéosurveillance de la ville et par les expertises ADN, qui n’ont révélé que celui de la femme du suspect, mise hors de cause, car elle a pu prouver qu’elle travaillait au moment de l’agression.
A écouter Richard S., cette enquête ouverte sur fond de soupçons de terrorisme n’était qu’une « affaire banale ». Un terme qui revient souvient dans la bouche du quinquagénaire. Banales sont les « dizaines » de lettres de menaces de mort qu’il prétend avoir reçu ces dernières années – mais dont l’analyse graphologique de la dernière révèle qu’il en est l’auteur. Banals sont les incidents aux Restos du cœur de Montreuil, où il assure se faire régulièrement traiter de « koufar », sans que cela soit confirmé par les autres membres de l’équipe, qui ne tarissent pas d’éloges à son égard. Banale enfin, son agression, qu’il ne qualifie en rien de terroriste :
« Ce n’est pas une attaque terroriste, si j’avais été victime d’un attentat, je serais mort. Pour moi, c’est une agression banale. J’ai été victime d’une agression, parce que je dérangeais les dealers. »
« Spirale du mensonge »
Alors que tout accable Richard S., un élément de l’enquête vient pencher en sa faveur : les expertises psychologiques, qui mettent en avant le « discours cohérent » d’un homme « ancré dans la réalité ». Un homme « spontané » qui assure « aimer trop la vie pour penser y mettre un terme ». Surtout, un homme qui présente les symptômes d’un choc post-traumatique, selon les experts, qui évoquent les « troubles du sommeil et les angoisses » du prévenu. « Un argument qui ne fait pas le poids », élude la procureure dans son réquisitoire, préférant évoquer « la spirale du mensonge » dans laquelle s’est engouffré Richard S. :
« Je crois que M. S. n’est pas capable d’avouer, c’est trop tard, il est allé trop loin. »
Evoquant un récit « plein d’incohérences », « plausible en rien », la procureure, « persuadée que le prévenu a tout inventé », réclame une « peine sévère ». Une fois le constat de la culpabilité de Richard S. établi, la procureure soulève une question qui restera sans réponse : « Pourquoi avoir monté de toutes pièces cette agression ? »
Dans une plaidoirie qui s’annonçait délicate, Me Jean-Louis Grenata, l’avocat du bénévole, réclame, lui, la relaxe, estimant que « rien dans ce dossier ne permet de comprendre en quoi l’infraction est constituée ». Et d’ajouter, après avoir tenté, sans convaincre, de déminer les incohérences du récit de son client : « Ce n’est pas parce que l’enquête n’a pas permis d’identifier les auteurs que l’agression n’a pas existé. » Le tribunal rendra sa décision le 15 juin.