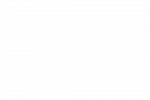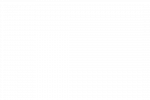François Bayrou nommé garde des sceaux

François Bayrou nommé garde des sceaux
Par Patrick Roger
Le président du MoDem est nommé ministre de la justice.
Dans l’ère de « dégagisme » qui semble balayer le paysage politique, François Bayrou fait figure de miraculé. Le maire de Pau, 66 ans dans quelques jours, trente-cinq ans de mandats politiques au compteur, élu conseiller général en 1982 et député en 1988, deux fois ministre de l’éducation nationale (sous François Mitterrand, puis sous Jacques Chirac), trois fois candidat à l’élection présidentielle, vient d’être nommé ministre de la justice dans le premier gouvernement d’Emmanuel Macron.
La rançon du choix fait par le président du MoDem, fin février, de s’allier au candidat d’En Marche !. Le bon choix, enfin, pour celui qui a collectionné les rendez-vous manqués et subi autant de désillusions qu’il a présenté de candidatures à l’élection présidentielle. En 2002, au lendemain du premier tour qui a vu se qualifier Jean-Marie Le Pen, il va voir Jacques Chirac. « Tu vas être élu avec 80 % des voix. Tu dois ouvrir et faire un gouvernement d’union nationale », lui dit-il. « Je vais faire le parti unique », lui répond le chef de l’Etat. Bayrou refuse d’en être. Aux législatives suivantes, c’est l’hémorragie : le patron de l’UDF ne compte plus que 29 députés contre 365 à l’UMP.
Cinq ans plus tard, rebelote. Après avoir obtenu son meilleur score à l’élection présidentielle, avec 18,6 % des voix, faisant de lui le troisième homme derrière Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, il laisse celle-ci, venue lui proposer le poste de premier ministre, sur le pas de sa porte. Il est perdant de tous les côtés. Son choix annoncé entre les deux tours de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy lui vaut de voir la majorité de ce qui lui restait comme parlementaires rejoindre Sarkozy. Il est réélu dans sa circonscription des Pyrénées-Atlantiques, mais le MoDem ne compte plus que trois députés.
Pater familias
Enfin, en 2012, Bayrou franchit le pas et appelle à voter pour François Hollande. Il ne lui en sera tenu aucun gré, si ce n’est qu’il s’attire durablement les foudres de la droite, qui le considère comme un traître. Humiliation suprême, il est battu aux législatives par une candidate socialiste. Depuis, replié sur la mairie de Pau, qu’il a conquise en 2014, il était devenu une sorte de pater familias traité avec d’autant plus d’égards et de bienveillance que son avenir politique semblait être derrière lui.
Il s’était progressivement fait à l’idée de ne pas concourir une quatrième fois à l’élection présidentielle et, lors de la primaire de la droite, avait ardemment soutenu la candidature d’Alain Juppé. La victoire de François Fillon le laisse un peu orphelin. Il n’adhère pas au programme du candidat de la droite et du centre. Les déboires judiciaires et politiques dans lesquels est empêtré ce dernier ne font que renforcer sa conviction qu’il faut trouver une autre voie et ravivent sa tentation de livrer une nouvelle bataille, de sentir encore le « parfum de la poudre ».
Il n’est pas enthousiasmé, non plus, par Emmanuel Macron, qu’il a qualifié à l’automne 2016 d’« hologramme » et en qui il voit le « candidat des forces de l’argent ». Avant de comprendre qu’ayant les mêmes aspirations et la même volonté de mettre à bas le duopole ayant régi le système politique depuis des décennies, ils se condamnaient, en présentant deux candidatures séparées, à s’éliminer tous deux du second tour. « J’ai pris mes responsabilités, souffle-t-il après avoir décidé de s’allier avec Macron. J’ai traversé des obstacles mais je suis au rendez-vous dans les moments difficiles. »
Certains de ses anciens amis, devenus aujourd’hui ses pires détracteurs, le décrivent comme un « calculateur », « habité », « un intrigant et un opportuniste », « le melon comme une montgolfière », un centriste radical à l’orgueil démesuré et à la détermination absolue qui n’hésitera pas à sacrifier sa famille politique pour préserver son indépendance. Mais les faits ont fini par lui donner raison. Il a toujours cru que le « système » finirait par imploser et que sa grande idée d’un gouvernement d’« union nationale » s’imposerait. Sa prémonition est devenue réalité. François Bayrou aime à citer cette devise d’Henri IV qu’il avait placée en exergue de la biographie qu’il lui a consacrée en 1994, Henri IV, le roi libre : « Ce qui doit arriver ne peut manquer. »