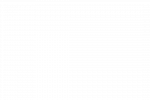Antoine Bozio : « L’évaluation sert le débat démocratique »

Antoine Bozio : « L’évaluation sert le débat démocratique »
LE MONDE ECONOMIE
Le lauréat de l’édition 2017 du Prix du meilleur jeune économiste consacre sa carrière de chercheur à l’audit des politiques publiques.
Antoine Bozio, 39 ans, est directeur de l’Institut des politiques publiques de l’Ecole d’économie de Paris. Nominé pour le Prix du meilleur jeune économiste en 2014, il en est le lauréat 2017 pour ses travaux sur l’évaluation des politiques publiques.
Comment avez-vous été amené à vous intéresser à l’évaluation des politiques publiques ?
Antoine Bozio. - J’ai toujours été intéressé par l’exercice démocratique, par la façon d’agir collectivement pour régler les problèmes de société. La raison pour laquelle je me suis engagé dans une carrière de recherche universitaire en économie est que je n’étais pas très convaincu par l’ENA comme voie royale pour savoir quelle politique mettre en place. J’ai été assez vite persuadé qu’en réalité on ne le sait pas très bien : de nombreux dispositifs créés sur de bonnes intentions ont souvent eu l’effet opposé à celui escompté. Dans notre monde complexe, il est nécessaire de bien comprendre l’impact des multiples options possibles des politiques publiques avant d’arbitrer les choix politiques.
L’évaluation, pour moi, consistait à élaborer une démarche scientifique pour donner le plus d’informations possible sur l’impact des politiques, au service du débat démocratique, pour sortir de la dichotomie du type : « Faut-il plus ou moins d’Etat ? » Cette opposition exprime un point de vue idéologique, mais sans faire avancer nos choix collectifs. Ce n’est pas vraiment la bonne question. La vraie question serait plutôt : « Quelles dépenses ont le plus d’efficacité pour l’objectif fixé (réduire les inégalités, baisser le chômage, favoriser l’innovation, etc.) ? »
Un exemple ?
Sur la réforme du marché du travail qui a donné lieu à controverses, ce qui frappe, c’est l’ampleur de notre ignorance. L’Etat fait peu d’efforts en termes d’évaluation et de conception des politiques publiques. Ainsi, lors de la mise en place du CICE [Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi], qui correspondait à une dépense d’un point de PIB, soit 20 milliards d’euros, on n’a consacré que 200 000 euros à son évaluation, soit 0,001 % ! Cela aurait mérité d’investir un peu plus pour savoir si ces milliards étaient utilisés de la meilleure façon.
Quelles ont été vos premières recherches ?
Parmi les dépenses publiques, le budget le plus important est celui des retraites : 14 points de PIB. J’ai donc choisi de consacrer mes premières recherches à l’évaluation des réformes des retraites en me disant que, si on parvenait à améliorer l’efficacité de cette dépense ne serait-ce que de 1 %, l’effet serait considérable. En 2004, quand j’ai commencé ma thèse, très peu de travaux avaient été réalisés et ils consistaient essentiellement à documenter les grands équilibres entre vieillissement et viabilité des caisses de retraite.
La méthodologie que j’ai appliquée à la première réforme disponible, celle de Balladur de 1993, consistait à mesurer sur la population concernée l’impact de chacun des paramètres modifiés par la réforme : combien de personnes étaient restées plus longtemps en emploi, comment avait évolué le chômage, etc. Cette méthodologie a permis de sortir de l’opposition théorique, d’objectiver le débat et de rentrer davantage dans le détail.
Le prix récompense l’ensemble de vos travaux, dont ceux sur la retraite, aujourd’hui repris par Emmanuel Macron pour proposer des comptes notionnels. Quelle est l’innovation majeure de cette réforme ?
En 2008, Thomas Piketty m’avait incité à réfléchir à une proposition de réforme des retraites qui permette de redonner confiance dans la pérennité du système. Nous avons abouti au fonctionnement en comptes notionnels afin de sortir de deux points de blocage. Le premier est que notre système actuel est d’une complexité inouïe, qui nuit directement à la confiance : les jeunes générations croient – à tort – qu’elles cotisent pour rien. Le second problème concerne l’équilibre de long terme du système. Depuis 1987, les gouvernants successifs ont choisi la désindexation des salaires de référence comme mode principal d’équilibrage du système des retraites face à l’augmentation de l’espérance de vie. Cela conduit à rendre notre système dépendant d’une croissance de long terme bien incertaine.
Pour sortir de cette situation, il fallait trouver une formule de calcul des pensions qui garantisse des taux de remplacement indépendamment de la croissance, tout en prenant en compte l’augmentation de l’espérance de vie. C’est ce que font les comptes notionnels. Dans un premier temps, les cotisations sont revalorisées en fonction de la croissance des salaires, puis au moment du départ en retraite, l’espérance de vie moyenne de la génération concernée sert à déterminer le montant de pension. Les paramètres sont fixés par génération, au vu des tables de mortalité de projection de l’Insee. Avec les comptes notionnels, chacun part quand il veut. En fonction des cotisations versées, il sait à quelle pension il a droit.
Les Suédois ont mis vingt ans à réaliser ce type de réforme. La France pourrait-elle le faire en un mandat présidentiel ?
Pour la France, il y a bien un ou deux ans de travail pour convertir les anciens droits obtenus dans chacun des régimes en nouveaux droits. En revanche, pour la phase de mise en œuvre, même si les conseillers d’Emmanuel Macron envisageaient plutôt une transition de neuf à dix ans, je tends à penser qu’on peut échapper à une transition longue, en maintenant au départ des taux de cotisation différents. Si l’on souhaite faire converger les efforts contributifs dans les différents régimes, cela peut prendre du temps, mais il n’est pas nécessaire que cette convergence ait lieu immédiatement.
Votre plus récent projet est la création de l’Institut des politiques publiques. Pourquoi cette innovation ?
Après ma thèse, j’ai travaillé au Royaume-Uni dans un centre d’évaluation des politiques publiques. Durant les cinq ans où j’étais à l’Institute for Fiscal Studies (IFS), j’ai été frappé par l’impact qu’avaient leurs travaux sur le débat public britannique, repris au Parlement, par les médias, donnant une voix au monde de la recherche, perçu comme plus impartial, moins politisé que les think tanks ou les lobbys. Il n’y avait pas d’équivalent en France.
L’Institut des politiques publiques (IPP), créé en 2012 par le Crest et l’Ecole d’économie de Paris, compte aujourd’hui une douzaine de chercheurs, qui ont l’ambition de faire ce travail. Nos travaux ont déjà concerné de nombreuses politiques, des allocations logement (pour la Cour des comptes) aux propositions sur le revenu de base de Benoît Hamon, du crédit impôt recherche (CIR) aux politiques éducatives et à la retraite, qui intéressent M. Macron. Faire porter la discussion non plus sur des choix idéologiques mais sur des arbitrages chiffrés favorise le débat démocratique dans un cadre plus constructif.