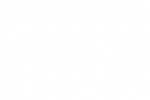Cannes 2017 : « Rodin », le geste puissant de l’artiste au travail

Cannes 2017 : « Rodin », le geste puissant de l’artiste au travail
Par Mathieu Macheret
Le biopic de Jacques Doillon s’ouvre en 1880, quand le sculpteur (Vincent Lindon) reçoit sa première commande d’Etat, et le suit à travers une série d’épisodes intimes et créatifs.
Il fallait sans doute compter sur l’indépendance d’esprit d’un Jacques Doillon pour ne pas couronner le centenaire de la mort d’Auguste Rodin avec un biopic (film biographique) supplémentaire. La rencontre semblait presque aller de soi, entre le glorieux sculpteur et le cinéaste de l’intime, réputé pour modeler à l’écran des états souvent extrêmes du corps – qu’on pense à La Pirate (1984), avec ses personnages aux postures tiraillées par les passions, ou au plus récent Mes séances de lutte (2014), où Sara Forestier et James Thierrée s’affrontaient amoureusement dans la boue.
Doillon n’a donc aucunement tenté de compiler la destinée de son personnage comme une pièce montée récapitulative ou hagiographique, mais a prélevé une séquence bien particulière de sa vie d’homme et d’artiste.
Le film s’ouvre en 1880, quand Rodin (Vincent Lindon), âgé de 40 ans, reçoit sa première commande d’État pour réaliser La Porte de l’Enfer, inspirée de la Divine Comédie de Dante. On suit le sculpteur à travers une série d’épisodes intimes et créatifs, se situant à chaque instant à la croisée des chemins.
Dans son art d’abord, puisque Rodin prend sa reconnaissance tardive comme l’occasion d’aller plus loin et de déchaîner ses audaces. Dans sa vie amoureuse ensuite, puisque sa liaison houleuse avec Camille Claudel (Izïa Higelin) se consume et s’éteint, avant qu’il ne plonge dans les bras de ses nombreux modèles, ou ne revienne auprès de sa compagne Rose Beuret (Séverine Caneele). Le tournant décisif intervient avec sa conception d’un Monument à Balzac, bond en avant vers la modernité qui l’occupera pendant près de six ans, et ne suscitera que rejet et incompréhension.
Rapport ductile à la beauté des corps
Que le récit attaque d’emblée sur la question de la commande n’a évidemment rien d’anodin et constitue d’ailleurs en partie le sujet du film. Comment résister à l’officialité et à l’institutionnalisation ? La question se pose à deux niveaux, c’est-à-dire qu’elle concerne autant le personnage de Rodin, aux prises avec ses commanditaires, que le cinéaste Doillon, chargé de représenter un monstre sacré de la culture française.
La réponse est, encore une fois, commune au sculpteur et au cinéaste : on résiste par l’inachèvement (Rodin qui ne finit pas sa Femme cambrée, laissée à l’état de torse) et par la quête perpétuelle du mouvement insufflé à la matière inerte (la terre que le sculpteur façonne de ses grosses paluches).
Ce mouvement trouve son origine dans les relations de Rodin aux diverses femmes qui l’entourent. C’est sans doute la part la moins convaincante du film, tant elle ramène la créativité de l’artiste à la sève de désir qui bouillonne en lui. Analogie peut-être pertinente, mais un peu courte pour véritablement cerner le geste puissant et emporté de l’artiste.
Les plus beaux passages du film sont à chercher dans les sessions de travail de Rodin, et plus précisément dans les « arcs » constants qui s’établissent entre le regard de l’artiste et son geste de sculpture. Dans une scène splendide, il prend une série de croquis sans quitter un instant ses modèles des yeux, tout en leur soufflant différentes poses. Observer et créer se confondent alors dans un même circuit, n’étant autres que les deux facettes d’un même rapport ductile à la beauté des corps et à leur ineffable tressaillement.
Film français de Jacques Doillon. Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele, Bernard Verley (1 h 59). Sortie le 24 mai.