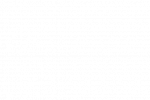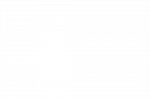Formation continue : l’université au rattrapage

Formation continue : l’université au rattrapage
Par Emmanuel Davidenkoff
Les établissements n’ont pas su s’adapter à un marché pourtant porteur.
C’est un des grands rendez-vous manqués de l’université, dont il n’est quasiment jamais fait mention. Quand Jacques Delors porte sa loi sur la formation professionnelle sur les fonts baptismaux, en 1971, il sait qu’il ouvre un marché prometteur : les entreprises ont désormais l’obligation de consacrer 1 % de leur masse salariale à la formation des salariés. Le futur président de la Commission européenne estime alors que le service public – éducation nationale et universités – pourrait récupérer les deux tiers de la manne (qui dépasse aujourd’hui les 30 milliards d’euros par an). Près d’un demi-siècle plus tard, un rapport de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale évalue à 1,5 % la part des stagiaires de formation continue formés à l’université, pour une part de marché, en chiffre d’affaires, de 1,9 %.
Les raisons de l’échec sont en partie exogènes. La loi Delors se heurte très vite aux crises pétrolières et à la brutale montée du chômage. Héritière d’initiatives lancées dans les grandes entreprises dès les années 1950 afin de soutenir leur développement et conçue pour permettre la promotion sociale des salariés, la formation pour adultes doit très vite intégrer des publics sans emploi et, souvent, sans diplôme, qui sont hors du champ de vision de l’université.
Cette dernière échoue aussi à concevoir des dispositifs pour les techniciens supérieurs, cadres intermédiaires et cadres supérieurs. La formation continue appuie sur tous les points douloureux de l’université : destinée à des adultes, elle exige des méthodes d’enseignement différentes dans un univers qui s’intéresse peu à la pédagogie ; tournée vers le marché de l’emploi, elle impose des liens étroits avec le monde économique, que l’université connaît mal et dont, souvent, elle se défie ; dévolue aux savoir-faire, elle impose une réflexion sur les compétences dans un monde tourné vers les savoirs ; contrainte à une constante adaptation aux évolutions des métiers et des secteurs, elle bouscule des structures administratives sous-dotées et peu agiles.
Certaines universités ont pourtant su relever le défi – un cinquième d’entre elles concentrent la moitié du marché. Les unes pour s’être précocement emparées de l’idée d’éducation populaire, née à la fin du XIXe siècle, comme celle de Nancy, ou pour s’être impliquées très tôt dans les chantiers de requalification de salariés heurtés par les crises du charbon et du textile. D’autres, plus récentes, pour avoir su, dès leur naissance, embrasser les enjeux de leur temps et de leurs territoires. D’autres encore parce qu’elles abritent des entités qui y consacrent une part de leur énergie, comme les instituts d’administration des entreprises.
Mais il en va de la formation continue comme de la formation initiale : hypersensibles aux besoins de l’économie et, particulièrement ces dernières années, en quête de ressources complémentaires pour pallier le recul des financements publics ou consulaires, les grandes écoles se sont fermement installées sur le marché. Et, comme en formation initiale, elles attirent les clients les plus solvables et les publics les moins fragiles. Un précipité de cinquante années d’histoire de l’enseignement supérieur.
Supplément coordonné par Jessica Gourdon.