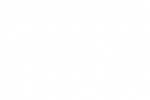A Kikwit, les rescapés des massacres au Kasaï racontent une guerre atroce qui se « tribalise »

A Kikwit, les rescapés des massacres au Kasaï racontent une guerre atroce qui se « tribalise »
Par Pierre Benetti (contributeur Le Monde Afrique, Kikwit, RDC, envoyé spécial)
La ville accueille des milliers de déplacés ayant fui les milices qui écument le centre de la RDC en pillant, tuant, décapitant. Peu d’hommes en ont réchappé.
Jamal, dont les parents ont été décapités par des miliciens, attend sa ration de nourriture au camp de déplacés de Kikwit, en RDC, le 7 juin 2017. | JOHN WESSELS/AFP
Les mains croisées dans le dos, Jamal ne parle pas, il murmure. D’une voix presque éteinte, l’air stupéfait, il ne dit que son nom. Quel âge a ce garçon : 8 ans, 10 ans peut-être ? D’où vient sa famille ? Personne ne sait. Une certitude : les parents de Jamal sont morts. Chercheur de diamants et marchande de légumes, ils ont été décapités un jour d’avril, lors d’une attaque de miliciens à Mayi Munene, un village de la province du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC). Un voisin, Hugo Ndaba, père de quatre enfants, a recueilli l’orphelin. Ils ont fui tous ensemble. A pied, en suivant la rivière Kasaï jusqu’à la ville de Tshikapa ; puis à bord d’un camion jusqu’à celle de Kikwit, à 350 km de là, dans la province du Kwilu.
Ce matin, Jamal patiente le dos au mur d’une maison, dans le quartier Kanzombi. Nous sommes chez Kafuti et Abraham, un couple d’infirmiers. En mars, ils ont commencé à voir affluer des rescapés de ces massacres qui endeuillent le centre de la RDC depuis l’été 2016. Leur pas-de-porte est devenu une cour des miracles où des grands-mères préparent de la pâte de manioc pour une foule d’affamés. En silence, femmes et enfants remplissent l’espace clôturé de bambous. Il y a aussi de rares hommes, des « vieillards » de 50 ans, assis sur des chaises en plastique, en colère car les rations sont maigres. Jamal, lui, a perdu l’appétit. Chaque jour, à l’aube, son nouveau père lui couvre le front de craie, « pour lui enlever les souvenirs ».
Décapitations, incendies, pillages
Au Kasaï et dans les provinces voisines, la guerre ne dit pas encore son nom, mais elle a déjà ses victimes : ses disparus, qui se comptent par centaines selon l’ONU, par milliers selon d’autres estimations, certains étant enfouis dans les 42 fosses communes identifiées par les Nations unies ; et ses déplacés, plus de 1 million selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Ils ont fui la vague de massacres déclenchée par la mort du chef coutumier Kamwina Nsapu, opposant déclaré au président de la République, Joseph Kabila, tué lors d’un assaut policier le 12 août 2016. La répression de l’armée congolaise qui s’en est suivie a été implacable.
Epuisés, les membres écorchés, fiévreux, anémiques, ces réfugiés de l’intérieur franchissent au compte-gouttes les vastes plateaux de savane qui séparent le Kasaï du paisible Kwilu. Dispersés dans des maisons et des églises, ils seraient bien plus nombreux que les 6 665 personnes enregistrées dans la province par l’Association pour le développement social et la sauvegarde de l’environnement (ADSSE), l’ONG chargée de leur évaluation par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Pourquoi les parents de Jamal ont-ils été tués ? Hugo Ndaba : « Nous avons beaucoup pleuré, mais nous ne savons pas pourquoi c’est arrivé. » Les populations du grand Kasaï, divisé en cinq provinces depuis une réforme en 2015, se mêlaient à Mayi Munene. Luba, Pende ou Tchokwe, les habitants vivaient de l’exploitation du manioc et des diamants, ainsi que de la proximité avec la frontière angolaise. En paix depuis l’indépendance, en 1960, ils ne s’attendaient pas à des décapitations, à des incendies et à des pillages.
Un déplacé du Kasaï, en RDC, réfugié dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, le 3 juin 2017. | JOHN WESSELS/AFP
« C’est une guerre tribale »
« On entendait parler d’une guerre, mais elle semblait loin de chez nous », dit Jean-Pierre Kisuka, un exploitant de diamants de Lubami Manga. Ce village voisin de Mayi Munene a été attaqué lui aussi en avril. Tshimbulu, le territoire de Kamwina Nsapu, est certes à plusieurs centaines de kilomètres de là. Mais, en seulement dix mois, le conflit a contaminé les cinq provinces, jusqu’alors épargnées par les violences connues en RDC depuis la fin des années 1990.
L’attaque de Mayi Munene ressemble à tant d’autres racontées par les déplacés. Ce jour d’avril, une quinzaine d’attaquants arrivent en moto dans le village. Hugo Ndaba raconte : « Ils sont allés chez le chef du village pour qu’il se rallie à eux. Il a refusé, donc ils l’ont décapité. Ils ont ordonné à la population de ne pas partir. » Le père de Jamal est quand même allé à la rivière, non pour fuir, mais pour travailler : il avait du gravier à tamiser, de quoi trouver des diamants à revendre. Lorsque son épouse est venue le chercher, tous deux sont tombés sur des miliciens.
Hugo Ndaba insiste pour raconter la suite des atrocités. Jamal écoute en silence. A Mayi Munene comme à Lubami Manga, les assaillants, armés de machettes et de bâtons, portaient des bandeaux rouges, parlaient le tshiluba, la langue des Luba, et s’en prenaient aux fétiches des Pende : c’étaient donc « des miliciens de Kamwina Nsapu ». Ici et là à Kikwit, le même discours, répété à satiété, se répand comme une dangereuse traînée de poudre : « C’est une guerre tribale, car les Luba tuent les non-Luba. » Le camp d’en face dit évidemment l’inverse, puisque depuis plusieurs semaines des attaques ont lieu contre les uns et les autres.
Des sacs remplis de têtes
Aux frustrations sociales d’une région très pauvre, malgré ses diamants, s’est ajoutée l’agitation politique, les élections promises en novembre 2016 n’ayant jamais eu lieu et l’espoir qu’elles se tiennent en 2017 s’éloignant chaque jour un peu plus. Dans ce fief de l’opposition, le phénomène Kamwina Nsapu a ouvert la boîte de Pandore : dans l’attente d’une sortie de crise sont réapparues de vieilles querelles de terres et pour le contrôle du pouvoir coutumier. « Avant, on vivait ensemble. Maintenant, chaque camp s’est armé et veut vivre avec les siens », dit une femme de Tshikapa.
« Nos amis luba sont des traîtres, ils se réjouissaient d’apprendre que les miliciens approchaient », se convainc Jean-Pierre Kisuka, qui a tout laissé derrière lui pour revenir dans sa province d’origine. Peu importe que de nombreux Luba aient perdu les leurs et fui eux aussi ; peu importe que, menées par des jeunes gens armés de bric et de broc, nombre d’attaques ciblent l’Etat et certains commerçants ou religieux assimilés au régime de Joseph Kabila. « Le premier jour, les miliciens ont rassemblé la population et ont dit qu’ils venaient pour nous libérer, poursuit Jean-Pierre Kisuka. Ils sont revenus plus nombreux le lendemain et ont instauré un couvre-feu. Puis ils ont tué des gens. »
A Kikwit, chacun a son mort et son histoire. Les récits des atrocités et des rites d’invulnérabilité des miliciens se succèdent, venant de partout avec un étrange air de normalité. Tel, parlant avec ses deux enfants sur les genoux, a dû apporter aux miliciens plusieurs sacs remplis de têtes humaines, dont celle de sa femme : « Ils les jettent dans la tshiota, le feu sacré, et se nourrissent de sang. » Telle autre, des tresses et un sourire poli, a vu son mari mourir : « Tout le monde a fui, même les prêtres et les militaires. Ce sont des combattants à fétiches, le sang ne sort pas de leur peau. » Une quinzaine de miliciens, dit-elle pourtant, auraient été tués par l’armée, épaulée par des civils.
« Chacun venge les siens, même les militaires »
Le repas arrive enfin, interrompant le silence de la foule qui se met à picorer des boules de pâte de manioc. A quelques mètres de Jamal, un grand jeune homme se cache sous un bonnet. Trésor Kimukedi a perdu ses parents à Tshikapa. « Il y a aussi des miliciens qui imitent les Kamwina Nsapu, prévient-il. Chacun venge les siens : les Luba, les Pende, les Tchokwe et même certains militaires. »
Soudain, un homme perdu dans une immense chemise bleue apparaît à l’entrée de la cour. Les yeux exorbités, le crâne noyé de sueur, il s’avance à pas furtifs et découvre la scène. Il dit qu’il vient de Lubile, un village à côté de Tshikapa. Il a dû donner 4 000 francs congolais (2,40 euros) à des piroguiers pour traverser la rivière, 8 000 à un camion. « Tous les villages ont été attaqués l’un après l’autre. Je ne pouvais que fuir », dit-il. Sept membres de sa famille ont été tués. Autour, des femmes écoutent et y reconnaissent d’anciens voisins. Le cou tendu vers l’assiette qu’on lui sert, l’homme dévore les boules de manioc jusqu’à la dernière miette. Il n’a que 32 ans, mais les vieux lui cèdent une chaise en plastique : peu d’hommes arrivent vivants du Kasaï.
Le feu couve-t-il encore ? « Les miliciens reviendront et l’armée combattra », disent les survivants de ce conflit brutal et déjà long, mais désespérément insaisissable. Les anciens habitants de Mayi Munene, de Lubami Manga et de Lubile ne connaissaient pas la guerre. Ils s’y sont déjà habitués.