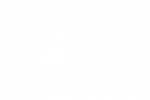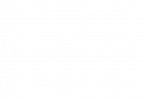En France et en Allemagne, la social-démocratie en mal de renouveau

En France et en Allemagne, la social-démocratie en mal de renouveau
Editorial. Le PS français et le SPD allemand sont confrontés au même défi : leur capacité à occuper le pouvoir sans perdre leur identité ni leur crédibilité
Le chef du SPD allemand Martin Schultz, à gauche, et Benoît Hamon, candidat socialiste à l’élection présidentielle française 2017, à Berlin, le 28 mars. | ODD ANDERSEN / AFP
Editorial du « Monde ». Pour les sociaux-démocrates européens, l’exercice du pouvoir est souvent redoutable. Le PS français, qui réunissait son conseil national, à Paris, samedi 24 juin, et le SPD allemand, qui tenait son congrès, dimanche, à Dortmund, en font aujourd’hui l’expérience. Certes, les deux partis sont dans des situations fort différentes : après une série de débâcles historiques aux différents scrutins qui se sont succédé, en France, depuis 2014, le PS est dans un état de mort clinique ; à trois mois des élections législatives qui auront lieu en Allemagne le 24 septembre, le SPD semble assuré, sinon de l’emporter, du moins de rester le deuxième parti politique du pays, derrière la CDU d’Angela Merkel, avec qui il gouverne depuis 2013.
En apparence, donc, rien de comparable entre les deux formations. Eliminé dès le premier tour de la présidentielle avant d’être balayé aux législatives, décapité et réduit à un groupe parlementaire famélique, le PS n’a pas seulement perdu la majorité à l’Assemblée nationale : aujourd’hui, il ne paraît même plus en mesure de se faire entendre dans l’opposition.
A l’inverse, malgré les défaites qu’il a subies aux trois élections régionales organisées depuis le début de l’année, et quoique son président, Martin Schulz, ait peu de chance de devenir chancelier à l’automne, le SPD demeure un grand parti de gouvernement, dont nul n’imagine la disparition à court ou à moyen terme.
En dépit de ces grandes différences, les deux partis sont confrontés au même défi : celui de l’exercice du pouvoir et de la capacité à l’occuper sans perdre, d’un côté, son identité, et, de l’autre, sa crédibilité.
Un exercice du pouvoir qui s’est révélé redoutable
En France, les cinq ans que le PS a passés aux affaires sous l’égide de François Hollande l’ont littéralement pulvérisé, creusant un fossé qui paraît infranchissable entre ceux qui sont prêts à participer, même sous condition, à la majorité du nouveau président de la République Emmanuel Macron, et les autres qui, à l’inverse, se reconnaissent dans l’opposition incarnée par Jean-Luc Mélenchon, le chef de La France insoumise.
En Allemagne, les quatre ans qui viennent de s’écouler ont été, pour le SPD, nettement moins violents. Mais, s’ils ne l’ont pas fait éclater, ils l’ont néanmoins affaibli : condamné à jouer la force d’appoint au sein d’un gouvernement dirigé par Angela Merkel, le parti de Martin Schulz a ainsi vu son identité se diluer peu à peu et certaines franges de son électorat traditionnel se détourner de lui. De telle sorte que, dans son cas aussi, l’exercice du pouvoir s’est révélé redoutable.
Quoique de façon moins pressante et moins brutale, les questions qui travaillent les sociaux-démocrates allemands sont, au fond, assez proches, de celles que se posent les socialistes français. Comment gouverner durablement sans être accusé par sa base électorale de perdre son âme ? Comment, à l’inverse, se régénérer idéologiquement et sociologiquement sans se condamner au confort d’une posture tribunicienne à la lisière du pouvoir ?
En France comme en Allemagne, la tentation existe chez certains, aujourd’hui, de s’inspirer des récents progrès électoraux du travailliste britannique Jeremy Corbyn pour trouver une voie de salut à une social-démocratie en crise ou en proie au doute. Reste à savoir si cet exemple, qui peut être séduisant pour conquérir le pouvoir, est le plus pertinent pour apprendre à l’exercer. Rien n’est moins sûr.