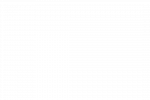Le Tchad et l’âge du « low-tech »

Le Tchad et l’âge du « low-tech »
Par Gaël Giraud
Les technologies de pointe ne sont pas la panacée du développement, soutient l’économiste en chef de l’Agence française de développement, Gaël Giraud.
Quelles sont les priorités du Tchad sur le moyen terme ? On l’a dit, la sécurité alimentaire y est devenue un enjeu vital. La tragédie que traverse aujourd’hui la Corne de l’Afrique témoigne de ce que la désertification et l’érosion des sols induits par le dérèglement climatique sont susceptibles d’avoir, dès à présent, des conséquences dramatiques, qui ne pourront que s’aggraver aux cours des prochaines décennies.
Quels sont les atouts naturels dont dispose le Tchad pour y échapper ? L’un des taux d’ensoleillement les plus élevés de la planète et des ressources aquifères souterraines abondantes, trace lointaine du fait qu’avant l’ère néolithique, le désert et la savane tchadienne étaient… une mer.
Une manière de combiner ces deux atouts pourrait consister à déployer un programme d’électrification des zones habitées du pays, reposant sur du photovoltaïque décentralisé. Des lampadaires (et même des feux rouges) ont été installés au cours des dernières années à N’Djamena, Moundou et Sarh, notamment le long de la route goudronnée qui, grâce à l’Union européenne et à la Banque africaine de développement, relie désormais la capitale du pays N’gambaye à l’ancienne capitale l’Oubangi-Chari.
Electrification
La chute du coût du photovoltaïque (environ 0,8 euro par kilowattheure, aujourd’hui) en fait une solution capable de concurrencer le thermique fossile. Pour rentabiliser un tel projet d’électrification, il conviendrait de le coupler à l’installation de stations de pompage capables d’apporter, toute l’année, l’eau nécessaire à une agriculture intensive.
Dans un pays dont le taux d’alphabétisation reste inférieur à 38 % et où 860 mères meurent pour 100 000 naissances vivantes, l’électrification permettrait aussi d’améliorer considérablement l’impact des projets liés à l’éducation et à la santé materno-infantile que l’Agence française de développement soutient déjà depuis de nombreuses années : grâce à l’électricité, les enfants peuvent étudier la nuit tombée (au-delà de 18h30) et les maternités et hôpitaux ne dépendent plus de groupes électrogènes et d’approvisionnement en pétrole.
Quant à l’agriculture intensive, il convient de la penser en relation avec le bétail très abondant qui circule le long de la frontière avec le désert du nord : 90 millions de têtes. Les excréments des zébus fournissent un excellent compost qui, aujourd’hui, n’est pas utilisé. Par ailleurs, les rizières installées autour de la ville de Bongor, grâce à un programme financé par Taïwan, montrent que l’on peut cultiver efficacement du riz. Surtout, il conviendrait de rechercher des solutions agricoles intensives en savoir-faire et peu exigeantes en technologie, à l’instar des techniques de riziculture intensives mises au point, à Madagascar, par Henri de Laulanié (un jésuite et agronome français). Ces dernières permettent d’obtenir trois récoltes par an tout en restant peu gourmandes en eau et sans exiger le moindre matériel sophistiqué.
Hôpital de brousse
L’expérience montre en effet que, dans les pays où sévit un dénuement analogue à celui que connaissent la majorité des populations tchadiennes, les dispositifs agricoles et de santé sont d’autant plus durables qu’ils ne mobilisent pas de technologies high-tech pour lesquelles, tôt ou tard, les pièces de rechange (ou le savoir-faire pour les réinstaller) feraient défaut. Il en va ainsi, par exemple, de l’extraordinaire hôpital de brousse, à Goundi, ouvert en pays Toumak, il y a plus de quarante ans, par le jésuite italien Angelo Gherardi.
Là-bas, on opère tous les jours avec de la Bétadine et des solutés fabriqués sur place, en se servant uniquement des renseignements fournis par des échographies (lesquelles sont développées in situ, au moyen de machines dépourvues de tout circuit électronique). Faute de disposer de réserves de sang suffisantes, on pratique des auto-transfusions sur les patients. On recoud avec du fil de pêche stérilisé dans des autoclaves dont l’ingéniosité des utilisateurs est parvenue à repousser l’obsolescence programmée de cinq ans à sept ou huit ans…
A l’origine, ces techniques de chirurgie ont été élaborées grâce au savoir-faire d’un médecin espagnol, qui opérait durant la guerre civile de 1936, venu enseigner à son fils, le jésuite espagnol François Cortadellas, l’art de sauver des vies en milieu précaire. Goundi, tout comme le CHU du Bon Samaritain à N’djamena et l’hôpital qui s’ouvre, à présent, à Biobé, dans une région du sud-est particulièrement enclavée (à laquelle il est impossible d’accéder en saison des pluies autrement qu’en pirogue), sont la preuve qu’il est possible de trouver des solutions, dans la durée, aux maux qui affectent les populations sahéliennes les plus démunies.
On aurait tort d’assimiler ce type de chirurgie low-tech à une aide médicale de seconde zone, qui cantonnerait la médecine high-tech aux pays plus riches. Le Sahel est un grand cimetière de projets technologiques grandioses qui n’ont pas résisté à l’épreuve du réel. Cette destinée tragique des rêves techno-scientifiques élaborés en Occident finit même par nourrir un business : cinquante autoclaves attendent sous bâche à N’Djamena la panne des machines actuellement en fonctionnement dans le pays.
Thèse provocante
La transition vers des sociétés post-carbones — qu’il faut achever à l’échelle planétaire avant la décennie 2070 si nous voulons honorer l’objectif des 2 °C de la COP 21 — exige que nous mesurions avec soin notre usage des métaux et, plus généralement, des ressources minières non renouvelables. Les recherches menées à l’AFD et à la Chaire énergie et prospérité montrent que le cuivre, par exemple, devrait atteindre son pic d’extraction à l’échelle mondiale dans trois, tout au plus quatre, décennies.
Or les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont plus gourmandes en cuivre que ne le sont les installations associées aux hydrocarbures. Le passage au tout photovoltaïque ou éolien suppose que l’on prenne en compte cette dimension matérielle décisive de la transition. La thèse provocante de Philippe Bihouix, selon qui riches et pauvres s’achemineraient vers un âge du low-tech trouve peut-être, ici, un début de confirmation. Elle fait écho à l’excellent rapport coordonné par le chimiste italien Ugo Bardi pour le Club de Rome, qui tente d’alerter la communauté internationale sur la raréfaction des ressources minières à l’échelle mondiale, mais n’a reçu à ce jour qu’un écho très modeste.
Quoi qu’il en soit, la résilience d’un pays comme le Tchad exige, à coup sûr, de se défaire d’un imaginaire qui, souvent, croit résoudre tous les problèmes de développement grâce au high-tech. Certes, la téléphonie mobile permet aujourd’hui de donner accès à la microfinance à des populations qui en étaient jusqu’ici écartées. Mais on sait bien que la microfinance elle-même conduit parfois à des pratiques de surendettement privé catastrophiques. La technologie peut donc conduire au pire si elle n’est pas accompagnée d’une véritable réflexion sur la gouvernance de sa mise en œuvre. En outre, s’il n’y a pas de station de pompage dans une zone, ou si elle est en panne, le fait qu’un agriculteur puisse télécharger une application qui lui indique où sont les sources d’eau les plus proches ne lui sera d’aucune utilité. Peut-être le Tchad invente-t-il aujourd’hui le style d’un monde « bas carbone » et low-tech auquel l’ensemble de nos sociétés aura à se convertir prochainement, au Nord comme au Sud ?
Gaël Giraud est économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD).