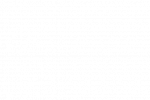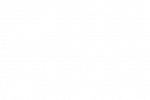Haute mer : « On ne veut pas transformer les océans en aquarium »

Haute mer : « On ne veut pas transformer les océans en aquarium »
Propos recueillis par Martine Valo
Serge Ségura, l’ambassadeur français pour les océans, participe aux négociations internationales sur un futur traité de conservation de la biodiversité en dehors des zones maritimes régies par les Etats.
La haute mer représente presque 60 % des océans, elle forme un monde complexe et mal connu au-delà des zones maritimes sous juridictions nationales. Aujourd’hui soumise à son tour aux contaminations massives d’hydrocarbures, polluants organochlorés, métaux, plastiques…, elle n’a droit à aucune protection particulière. Lors du sommet Rio+20, en 2012, les Etats s’étaient engagés à la doter d’un traité international contraignant afin de préserver sa biodiversité et le fonctionnement de ses écosystèmes qui rendent aux humains plus de services qu’ils ne le croient. Serge Ségura, qui représente la France dans ce processus, analyse l’état des négociations.
Depuis quand la France a-t-elle un ambassadeur pour les océans ?
La fonction a été créée en septembre 2015, peu avant la COP21 de Paris. Il était temps de « maritimiser » l’état d’esprit de nos diplomates, car les océans sont devenus de véritables enjeux diplomatiques, environnementaux, économiques…
Quel bilan tirez-vous de la Conférence organisée en juin par l’Organisation des nations unies sur l’objectif du développement durable : « Conserver et exploiter de manière durable les océans » ?
Cette conférence marque la naissance d’une communauté des océans, comme la COP21 l’a fait pour le climat. D’abord les Etats ont réussi à se mettre d’accord sur ce qu’ils appellent un « Appel à l’action » à l’horizon 2020-2030. Et cela a été un succès populaire : entre 8 000 et 10 000 personnes sont venues : représentants d’Etats, ONG, milieux d’affaires – pas suffisamment –, pêcheurs et surtout scientifiques.
Le lien entre océan et climat vous paraît-il suffisamment pris en compte dans cet appel à l’action ?
Nous, les Français, aurions aimé que la référence à l’Accord de Paris soit plus nette. Or on a eu du mal à la faire figurer. Même au sein de l’ONU cela n’a pas été évident. C’est inquiétant. Cependant, en réaction à la décision du président Trump, la plupart des pays, même ceux plutôt tièdes, ont tenu à rappeler, lors de cette conférence, leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Personne ne peut nier ce phénomène. Les Etats insulaires, qui représentent désormais un groupe bien constitué au sein de l’ONU, l’ont rappelé avec force. J’ai été impressionné par la parole des élus des petites îles du Pacifique venus témoigner de la montée des eaux et de la multiplication des cyclones. On voyait que cela les prenait aux tripes.
Cependant, il n’y a pas que la question du climat. J’aurais aimé faire avancer l’idée d’économie bleue – un concept français et européen dont nous ne sommes pas parvenus à imposer la terminologie. Il s’agit de l’économie maritime dans son ensemble, mais dans un état d’esprit de développement durable. Pour une entreprise, cela signifie avoir en permanence conscience de l’atteinte à l’environnement que son activité va produire et tâcher d’en restreindre les impacts ou de les réparer. Elle doit aussi permettre de sortir de la pauvreté à l’échelle mondiale : offrir des salaires corrects, l’égalité des genres, refuser le travail des enfants… Tous les secteurs sont concernés, des énergies renouvelables au démantèlement des navires, à l’exploitation du pétrole dans les fonds marins.
Un autre rendez-vous international se profile sur la haute mer cette fois, quels sont les enjeux ?
Les Etats ont engagé un processus pour aboutir à un « accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité au-delà des zones maritimes sous juridiction nationale », (Beyond Biodiversity National Juridiction). On parle de haute mer et de biodiversité, les deux termes comptent. Cela signifie qu’on ne veut pas transformer les océans en aquarium, mais qu’on souhaite continuer à utiliser leurs ressources pour répondre aux besoins de l’homme, sans les épuiser.
Le dernier des quatre comités préparatoires à cet accord se tient du 10 au 21 juillet. Une recommandation adressée de l’Assemblée générale des Nations unies, qui débute en septembre, devrait suivre. La négociation pour un traité international pourrait alors démarrer. Celui-ci complétera la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay. Cette Convention [signée en 1982] n’aborde l’environnement que succinctement. On découvre à présent d’autres problèmes que les marées noires, fréquentes à l’époque : plastique, produits chimiques, méthodes de pêche dangereuses pour l’écosystème – comme la capture au cyanure de poissons pour l’aquariophilie par exemple.
A quoi ressemblent ces comités préparatoires ?
Jusqu’à présent ils reposent surtout sur des échanges entre le groupe des 77 – les pays en développement avec la Chine – d’une part, et l’Union européenne d’autre part. L’Europe voulait qu’on travaille sur les outils de protection, en premier lieu sur les aires marines protégées, et sur les études d’impact environnemental pour les activités en haute mer. Les pays en développement ont dit : d’accord à condition que vous acceptiez de vous pencher sérieusement sur les ressources génétiques marines et le transfert de technologies en faveur de l’aide au développement.
Ils ont toujours considéré que les océans devraient être un patrimoine commun de l’humanité. Ils sont parvenus à l’imposer pour tout ce qui touche aux ressources minérales des grands fonds marins au-delà des zones sous juridiction nationale. Une organisation a été créée pour ça : l’Autorité internationale des fonds marins qui siège en Jamaïque. A terme, quand il y aura de l’exploitation, il est prévu que 1 % des bénéfices soient reversés en faveur des pays moins avancés.
Ces derniers veulent à présent élargir la notion juridique de « Patrimoine commun de l’humanité » qui figure dans la Convention de Montego Bay, aux autres éventuels profits tirés des océans, en particulier à l’utilisation des ressources marines génétiques pour l’alimentation, la pharmacie, la cosmétique… Cela entraînerait, entre autres, une gestion commune et une répartition des bénéfices. Est-ce envisageable avec le coût très important de recherches et d’échec supporté par les entreprises ? Nous, Français, comme l’Union européenne, n’y sommes pas favorables. En revanche nous sommes pour le partage des bénéfices.
On pourrait néanmoins avoir dans le préambule de l’accord une référence au fait que les océans constituent un « bien commun ». Ce concept-là est plutôt philosophique. Il fait ressortir la responsabilité des Etats à veiller à la protection de l’écosystème marin. Pourtant, même au niveau de l’Union européenne, il ne fait pas l’unanimité. Pas encore.
La Convention de Montego Bay a demandé vingt ans de négociations. Pensez-vous que ce sera aussi long pour cet accord ?
Montego Bay est un chef-d’œuvre ! J’espère cependant que cela sera plus rapide. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Veut-on un accord très détaillé qui prendra dix ans ou un accord-cadre ? Il reste des sceptiques : les Etats-Unis, les Russes, les Norvégiens, les Islandais à cause de lignes rouges sur la pêche. Si on veut les avoir à bord avec nous, il ne faut pas trop rentrer dans le détail.
On pourrait imaginer une COP de la haute mer où on avancerait progressivement. Le protocole de Madrid sur l’Antarctique de 1991 est un bon exemple. Il définit les grands principes de protection de l’environnement dans cette région du monde, et prévoit six annexes qui ont fait l’objet de ratification à part. Quinze ans plus tard, elles sont toutes en vigueur.