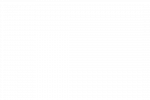Démantèlement du camp de Gdeim Izik : la défense des Sahraouis dénonce un « procès politique »

Démantèlement du camp de Gdeim Izik : la défense des Sahraouis dénonce un « procès politique »
Propos recueillis par Elena Blum
Vingt-cinq militants viennent d’être condamnés pour le « meurtre » d’onze membres des forces de l’ordre marocaines en novembre 2010.
Le 13 mars 2017, devant la cour de Sale, près de Rabat, où s’est déroulé le procès des 25 Sahraouis accusés du « meurtre » de 11 policiers lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik en novembre 2010. | FADEL SENNA/AFP
Le camp de Gdeim Izik, crée en octobre 2010, a été violemment démantelé par les forces de l’ordre marocaines un mois plus tard, le 8 novembre. Situé à 12 km de Laayoune, la ville principale du Sahara occidental annexé par le Maroc en 1975, le camp avait été édifié dans le désert pour protester contre les mauvaises conditions socio-économiques, et a compté jusqu’à 15 000 personnes. Les affrontements qui ont accompagné son évacuation furent les plus graves depuis le cessez-le-feu de 1991 : onze membres des forces de l’ordre et deux civils furent tués.
Les autorités marocaines ont alors procédé à une vague d’arrestations au cours de laquelle des centaines des Sahraouis ont été molestés. Vingt-cinq d’entre eux, dont l’un est en fuite, ont été inculpés pour le « meurtre » des policiers. Un tribunal militaire a prononcé en 2013 des peines de prison allant jusqu’à la perpétuité, avant que la Cour de cassation n’annule cette décision en juillet 2016. Les accusés, leurs proches et plusieurs associations internationales de défense des droits de l’homme avaient à l’époque dénoncé « de graves irrégularités » dans la procédure, estimant notamment que les aveux des prévenus avaient été extorqués par la force. La cour d’appel de Rabat a été désignée pour rejuger l’affaire, et le procès s’est tenu en mars 2017.
Ingrid Metton est l’un des trois avocats français qui ont défendu les accusés du procès de Gdeim Izik. Elle dénonce un « système judiciaire défaillant », et un procès au cours duquel, selon elle, le droit à la défense n’a pas été respecté.
Pour quelle raison la Cour de cassation a-t-elle annulé la décision du tribunal militaire ?
Ingrid Metton Il n’y avait aucune preuve matérielle des meurtres, le chiffre même du nombre de morts est passé de neuf à onze, et on n’a jamais obtenu le nom des victimes. C’est-à-dire qu’en 2013, 24 personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu’à la perpétuité sans aucune preuve et sans l’identité des victimes. Cela peut paraître incongru, mais, au niveau du droit, c’est une aberration totale. On ne peut pas condamner quelqu’un pour meurtre sans preuve.
Si la Cour de cassation s’est enfin prononcée au bout de trois ans, c’est parce qu’il y a eu des pressions faites au niveau international. Notamment, mon cabinet, qui a saisi le Comité contre la torture des Nations unies dans le cas d’un des accusés, M. Naama Asfari. Il a été reconnu qu’il avait été condamné par le tribunal militaire uniquement sur la base d’aveux obtenus sous la torture, ce qui est évidemment formellement interdit.
Comment s’est déroulé le procès ?
Dans des conditions extrêmement difficiles. L’exercice du droit de la défense a été rendu très compliqué, que ce soit pour les avocats de la défense marocains, qui étaient coupés sans cesse, ou pour les avocats français. Nous avons souhaité soumettre plusieurs pièces à la cour, qui ont été systématiquement rejetées pour des motifs fallacieux.
Le document était rejeté parce qu’il n’était pas en arabe, alors que la partie civile produisait des documents en français. De plus, nos conclusions, traduites en arabe, étaient aussi rejetées, par exemple parce qu’il aurait fallu que ce soit l’avocat marocain chez lequel on était domiciliés à Rabat qui les remette au président, et pas nous. Des règles procédurales qui n’ont pas lieu d’être étaient systématiquement inventées.
Et finalement, un jour, les prisonniers et les avocats marocains de la défense ont décidé de se retirer du procès, ils ne voulaient plus participer à cette mascarade. Ma consœur, Me Olfa Ouleg, et moi, nous avons voulu adresser un dernier mot à la cour, car nous avions produit des contre-expertises et nous voulions leur remettre la décision du Comité contre la torture traduite en arabe.
Le président nous a interdit de prendre la parole, ce qui en fait est le plus grand affront qu’on puisse faire à la défense. Le métier d’avocat est justement de porter la parole de son client, et là nous ne pouvions plus le faire. Il nous a retiré de la défense d’office, nous avons protesté, et il a demandé à la police de nous évacuer. Ça a été très violent, très brutal.
En quoi ce procès est emblématique du conflit au Sahara occidental ?
Ce procès n’est pas une surprise quand on voit comment le royaume du Maroc traite la question sahraouie et réprime durement toute personne qui reste à la marge. Il est emblématique parce que toutes les personnes qui ont été arrêtées sont des militants : certains étaient militants pour l’autodétermination, et beaucoup avaient pour métier de documenter les violations des droits humains dans le Sahara.
C’est un procès politique. La façon dont ils ont été traités et réprimés n’est que l’expression dans le cadre de la justice de la répression dont sont victimes les Sahraouis. Le Maroc est coutumier des procès expéditifs sur des questions qui le dérangent.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Les prisonniers se sont pourvus en cassation. L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) a saisi trois rapporteurs de l’ONU. Un rapporteur spécial pour la torture, un rapporteur spécial sur la dépendance des avocats et le rapporteur spécial sur la question des militants des droits de l’homme et des prisonniers politiques.
Nous examinons toutes les pistes, pour saisir les instances internationales. Puisque la justice n’est pas correctement rendue, le Maroc ne laisse pas d’autre choix aux prisonniers que d’aller faire valoir leurs droits ailleurs. Mais je suis optimiste sur la force et le courage des prisonniers. Ce qui est sûr pour moi, c’est qu’il n’y a pas d’autre issue possible, à terme, que la libération des prisonniers de Gdeim Izik.