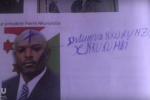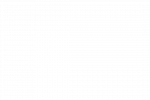« Les blogueurs africains, entre urgence d’écrire et peur de la page blanche »

« Les blogueurs africains, entre urgence d’écrire et peur de la page blanche »
Par Abdourahman Waberi (chroniqueur Le Monde Afrique)
Lors d’un atelier, notre chroniqueur a recueilli les témoignages de jeunes plumes du continent qui savent combien la pratique du journalisme peut être risquée.
Ils se prénomment Jeff, Spageon, Didier, Armel, Franck, Dacia, Esther, Kadiatou, Philippe, Rodriguez ou Magloire. Ils sont entre 26 et 35 ans, viennent du Burundi, de la République démocratique du Congo (RDC) ou de Côte d’Ivoire. Ils sont blogueurs, journalistes ou consultants. Certains sont débutants, d’autres chevronnés, comme Esther Nsapu, qui dispose d’un compte Twitter bien suivi. Ils ont assisté un atelier d’écriture que j’ai eu le privilège d’animer, à Abidjan, du 27 au 29 juillet, en marge de bien tièdes Jeux de la Francophonie.
J’ai été sensible à leur esprit vivace, à leur dynamisme, à leur candeur. Pendant les quelques jours passés avec eux, j’ai partagé leurs mots, leurs rêves et leurs frustrations. Sous les éclats de rire, nous avons déambulé ensemble dans les rues d’Abidjan et slalomé entre les étals d’étoffes et de légumes du grand marché d’Adjamé, l’un des endroits les plus populeux de la capitale économique ivoirienne.
Nos discussions ont porté sur les pratiques d’écriture, la peur de la page blanche, la pertinence d’un adjectif. Je leur ai proposé des exercices inspirés de Raymond Queneau et de Georges Perec. Ils écrivent en français mais aussi en kirundi, à l’instar de Spageon Ngabo.
Ruser avec la censure
Dans leurs articles composés souvent dans l’urgence et déposés sur les plateformes Habari RDC et Yaba Burundi, ils vous font toucher du doigt le chapelet de la vie quotidienne qui s’égrène à Goma, à Lubumbashi ou à Bujumbura. Ils ne sont pas dupes du rapport de forces sur le terrain. Ils savent au plus profond de leur être combien la pratique du journalisme est fort risquée dans la région des Grands Lacs.
Armel Uwikunze, blogueur :
« J’écris parce qu’il m’est impossible de rester silencieux. Silencieux face à la descente aux enfers de mon pays, le Burundi, face à mes rêves d’un avenir radieux pour mon pays, qui s’éloignent de jour en jour. J’écris aussi parce que c’est la seule arme que je sais manier et parce que la guerre des idées est la seule sorte de violence que je tolère. »
Discrets et subtils, ils ont appris à ruser avec la censure et éviter l’œil inquisiteur des autorités locales et nationales.
Franck Boni, blogueur et consultant :
« Dans la situation de crise qu’a connue mon pays, la Côte d’Ivoire, écrire sur la situation de l’époque, c’était s’exposer au courroux des belligérants… Pour ma part, j’ai produit des articles sous anonymat, seul moyen de contourner la censure de la peur. L’usage d’une tournure ironique permet d’éviter l’affrontement direct ou même de brouiller les pistes. »
Ils ont en réserve beaucoup de fraîcheur et évoluent au sein de collectifs, au contraire de leurs confrères se disant influenceurs, qui prônent l’individualisme. Ces derniers sont à la famille des blogueurs ce que les sapeurs sont à la scène artistique africaine : creux, prévisibles et bavards. En étalant leurs petits tas d’émois sur la blogosphère à coups de hashtags rageurs, de graphiques flatteurs et de vidéos nombrilistes, les influenceurs ne changent en rien l’ordre établi à Dakar, à Cocody ou à Conakry.
Dialogue et préjugés
A mille lieues des spasmes des influenceurs, les blogueurs rencontrés à Abidjan travaillent dans des conditions autrement périlleuses. Ils rendent compte des régions peu accessibles, d’où leur précieuse contribution.
Didier Makal, journaliste et assistant à l’université de Lubumbashi :
« Nos critiques sur le processus d’identification dans le Nord-Kivu, dans le très meurtri territoire de Beni, enclavé, ont obligé un député à mettre la pression sur les autorités administratives et sur la Commission électorale afin de permettre à nos compatriotes de s’enregistrer et d’espérer se donner la chance d’être représentés dans les parlements. »
S’ils rencontrent des défis, il leur arrive aussi de recevoir des marques d’attention de la part de leurs premiers lecteurs, leurs voisins ou leurs jeunes compatriotes. Avec ces derniers, quand le dialogue s’engage, les préjugés peuvent tomber.
Spageon Nagbo, blogueur et éditeur en kirundi :
« Un de mes lecteurs m’a dit un jour qu’il était surpris par la différence entre l’image que renvoie mon blog et celle qu’il avait en face de lui, sous ses yeux… Or je considère que l’interprétation d’un message dépend davantage du lecteur que de l’auteur. Alors, dans une situation de crise, ceci peut faire de nous des personnes à risque. »
Certains d’entre eux sont déjà parents, ils ont tous la tête sur les épaules. Je ne serais pas étonné de les retrouver en position de leadership au Kivu ou ailleurs. Souhaitons-leur bonne route.
Abdourahman A. Waberi est né en 1965 dans l’actuelle République de Djibouti. Il vit entre Paris et les Etats-Unis, où il a enseigné les littératures francophones aux Claremont Colleges (Californie). Il est aujourd’hui professeur à George-Washington University. Auteur, entre autres, d’Aux Etats-Unis d’Afrique (éd. J.-C. Lattès, 2006) et de La Divine Chanson (éd. Zulma, 2015). En 2000, Abdourahman Waberi avait écrit un ouvrage à mi-chemin entre fiction et méditation sur le génocide rwandais, Moisson de crânes (ed. Le Serpent à plumes), qui vient d’être traduit en anglais, Harvest of Skulls (Indiana University Press, 2017).